Année académique 2018-2019

Samedi 22 juin 2019 : journée foraine à Saint-Antonin-Noble-Val
Communication longue d’Émilie Nadal, Un enlumineur toulousain pour la « Chanson de la croisade » ? Nouvelles pistes
Lire le compte-rendu
À 11 h 30 à l’Hôtel de Ville,
le Bureau et les membres de la Société Archéologique du Midi de la France remettront solennellement au maire de Saint-Antonin-Noble-Val, Monsieur Gérard Agam, la médaille d’argent décernée le 4 juin dernier à la municipalité pour l’acquisition de la maison Muratet.
Nous rencontrerons des membres de la Société des Amis du Vieux Saint-Antonin, et l’après-midi sera consacrée à la redécouverte des maisons médiévales de Saint-Antonin, qui nous permettra de prendre connaissance des avancées de la recherche. S’il ne sera pas possible de visiter la maison Muratet en raison de son mauvais état actuel, nous pourrons en revanche examiner en détail la maison du 6 rue Cayssac, en vente actuellement.
Cette visite sera aussi l’occasion de s’interroger sur le devenir d’un patrimoine civil médiéval particulièrement nombreux et remarquable, et sur les moyens de le faire connaître et de le conserver.


En présence de membres du conseil municipal, de la Société des Amis du Vieux Saint-Antonin, de la Société archéologique du Midi de la France, d’amis et de M. Gilles Muratet, Émilie Nadal, présidente de la Société archéologique du Midi de la France, remet solennellement au maire de Saint-Antonin-Noble-Val, Monsieur Gérard Agam, la médaille d’argent décernée le 4 juin dernier à la municipalité pour l’acquisition de la maison Muratet :
« C’est un honneur et un plaisir pour la Société archéologique du Midi de la France, d’être présente aujourd’hui pour remettre la médaille d’argent de notre société à la municipalité de Saint-Antonin-Noble-Val.
Depuis plus de 188 ans, la Société archéologique du Midi de la France encourage toutes les actions en faveur de la protection et de la sauvegarde du patrimoine d’Occitanie. Récemment nous avons apporté notre soutien à l’Association des amis de l’abbaye de Grandselve qui a su créer un petit musée autour des restes de l’abbaye. Quelques mois plus tôt, c’est la municipalité de La Salvetat Saint-Gilles qui a été récompensée pour avoir su acquérir et entreprendre le sauvetage du château des comtes de Toulouse, qui est actuellement toujours en cours de restauration.
C’est dans cette lignée que nous sommes réunis aujourd’hui pour remettre à la municipalité de Saint-Antonin-Noble-Val représenté par M. le Maire, cette médaille. La raison en est simple. La municipalité a récemment fait l’acquisition de la Maison Muratet. Remarquable maison médiévale, remarquable au premier titre pour la fraîcheur de ses peintures, représentant une cavalcade de chevaliers et des tentures médiévales en trompe-l’œil, remarquable aussi pour la conservation de la maison elle-même, puisque les maisons médiévales conservées ne sont pas si courantes et méritent qu’on en prenne soin.
Cette médaille ne vient pas comme un couronnement, pour marquer l’accomplissement d’une action de protection patrimoniale qui serait achevée. C’est au contraire un stimulant, un encouragement à poursuivre les actions en faveur de nos vieux monuments. Tous ne bénéficient pas de l’exposition médiatique de Notre-Dame de Paris, c’est pourquoi c’est l’engagement local de tous qui permettra leur sauvegarde et leur préservation pour les générations à venir. En saluant l’action de Saint-Antonin-Noble-Val, nous espérons susciter d’autres politiques locales allant dans le même sens.
C’est ainsi que j’ai l’honneur, M. le Maire, de vous remettre au nom de la Société archéologique, cette médaille d’argent qui vient saluer l’engagement et l’action de votre municipalité en faveur du patrimoine. »
Le maire de Saint-Antonin remercie la Société pour cette distinction qui honore la municipalité. Il la reçoit comme la reconnaissance du travail effectué par la commune pour le patrimoine dans son ensemble et souligne l’importance des investissements mobilisés pour la restauration de l’hôtel de ville.
Il dresse ensuite un bref historique de l’acquisition de la maison Muratet. Une société immobilière avait acheté la maison pour y faire des appartements il y a plusieurs années, mais le projet n’avait pas abouti. Le temps passant, l’état de l’édifice s’est dégradé considérablement, ce qui suscitait l’inquiétude de la commune. Cependant, celle-ci ne pouvait émettre d’arrêté de péril, le danger imminent étant avéré pour les intérieurs mais pas pour les élévations extérieures donnant sur la voie publique. La municipalité et les monuments historiques (la maison est classée au titre des monuments historiques par arrêté du 23 novembre 1989) ont été confrontés de concert à une situation financière et juridique complexe. Finalement, la saisie par la banque portant le financement de l’opération immobilière a accéléré la résolution du problème. Une vente aux enchères a eu lieu et la mairie s’est portée acquéreur en exerçant son droit de préemption pour 63 000 euros.
En parallèle, la commune fait réaliser une étude pour établir le projet scientifique et culturel du musée de la ville, jusque-là abrité dans la maison dite « maison romane ». Le projet, en cours de rédaction, inclut la maison Muratet dans le futur espace muséal. Il s’agit d’une démarche longue, qui comprend le déplacement des collections, actuellement inventoriées et conditionnées dans l’attente de leur redéploiement.
Actuellement, des travaux pour établir un cheminement mis en sécurité, afin que les entreprises puissent travailler dans la maison, sont menés sous la houlette de Pierre Yves Caillault, architecte en chef des monuments historiques. Dans quelques mois les travaux pourront débuter, avec la perspective de l’intégration de la maison restaurée dans l’espace muséal défini par le projet scientifique et culturel en cours.
Le maire souligne enfin la cohérence de l’action de la municipalité. La Ville de Saint-Antonin porte en effet un projet de Site Patrimonial Remarquable avec les communes de Bruniquel, Montricoux, Caylus, Saint-Antonin, et Penne dans le Tarn. Dans ce cadre, le centre de Saint-Antonin est appelé à faire l’objet d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur dans les prochaines années.
L’après-midi est consacré à une visite de la maison du n° 6 rue Cayssac ainsi qu’à une rapide découverte de la ville.
La maison du n° 6 rue Cayssac est présentée par son propriétaire, M. Le Maréchal, ainsi que par Alexia Aleyrangues, chargée d’étude de la mission d’inventaire du patrimoine du Pays Midi-Quercy. Outre la notice réalisée dans le cadre de l’inventaire général, la maison a fait l’objet d’une étude effectuée par les étudiants de l’école de Chaillot à l’occasion d’un séminaire de terrain en 2011 et publiée dans le Congrès archéologique de Tarn-et-Garonne en 2014.
La maison est implantée en cœur d’îlot et ses façades sont enchâssées dans un tissu très dense. Le commanditaire en est peut-être Guillaume de Laporte, mentionné dans un acte de 1272. Cette date est cohérente avec les décors observés, ainsi qu’avec l’étude dendrochronologique qui a conclu à une date d’abattage à peu près similaire pour les différents bois analysés, aux environs de 1265-1270.
La maison est remarquable par l’exceptionnel état de conservation de ses structures et de ses décors médiévaux, elle n’a subi que peu de modifications après la fin du Moyen Âge. Elle possédait au moins neuf fenêtres géminées : deux sont intactes, mais les traces des autres sont incontestables. Les deux chapiteaux en place présentent des décors de feuillages naturalistes disposés en deux couronnes sur un tailloir élancé. Ses dispositions intérieures sont largement conservées : les aménagements muraux, dont des latrines aux deux étages, ménagées dans le passage entre deux corps de bâtiments ; les enduits peints aux motifs de faux appareil et de faux marbre du XIIIe siècle ainsi que des enduits à faux appareil de la fin du Moyen Âge, et enfin une partie des planchers ainsi qu’une cloison en pan-de-bois du XIIIe siècle, datés par dendrochronologie. Des vestiges de sa couverture initiale en lauzes de calcaire sont également encore en place au sommet de l’élévation sud.
La visite de Saint-Antonin permet ensuite de découvrir quelques-uns de ses édifices les plus significatifs. La ville est un exceptionnel conservatoire de maisons médiévales, comme le rappelait Pierre Garrigou Grandchamp dans sa présentation pour le congrès de la Société française d’archéologie (voir Congrès archéologique de Tarn-et-Garonne, 2014). Il ainsi dénombré 150 maisons antérieures à la guerre de Cent ans.
L’attention se porte en premier lieu sur les maisons du XIIe siècle. Il est rappelé qu’à cette période la ville semble déjà constituée autour de l’abbaye bénédictine fondée au IXe siècle au confluent de l’Aveyron et de la Bonnette. Un acte de partage de la vicomté de Saint-Antonin de 1155 en donne les grands contours et en cite les principaux éléments constitutifs.
L’étude de la maison dite « maison romane », par Maurice Scellès (voir en dernier lieu la publication en ligne de sa conférence donnée pour la Société des amis du vieux Saint-antonin en 2018 : http://savsa.net/wp-content/uploads/2019/01/Maison_romane_bulletin-2018.pdf), a permis notamment d’en situer la construction vers 1150. Maison de justice avant de devenir maison consulaire, remarquable par la qualité de sa sculpture et la cohérence du programme iconographique, par les bacini incrustés dans sa façade et ses colonnettes de bronze… elle constitue aussi un jalon important pour la datation de maisons dont la mise en œuvre est semblable à celle de son élévation arrière, avec arc monolithes et en moellons équarris tandis que la façade sur la place est en pierre de taille.
Pierre Garrigou Grandchamp signale que les maisons ainsi datées du XIIe siècle sont au nombre de six actuellement. Elles sont caractérisées principalement par leurs ouvertures, fenêtres et arcades, couvertes d’arcs monolithes en plein-cintre. La maison située à l’angle de la rue Cayssac et de la rue du Pont-de-l’Aveyron a particulièrement retenu l’attention par la présence en rez-de-chaussée d’une ouverture bouchée qui semble avoir été une fenêtre géminée et dont la présence à ce niveau sur rue interroge.
Rue Guilhem-Peyre, l’observation des maisons des n° 14 et 16 est l’occasion de présenter les grandes lignes de l’architecture civile de Saint-Antonin au XIIIe siècle : des élévations à deux étages, plus un comble ouvert le plus souvent postérieur, des façades en moyen ou grand appareil de pierre de taille, percées de grandes arcades brisées au rez-de-chaussée et de fenêtres géminées à oculi sur cordons régnants aux étages, avec des portes-bannes à anneaux parfois conservés. Les modifications les plus couramment apportées à la fin du Moyen Âge sont l’introduction de l’escalier en vis derrière une porte en neuve en façade et la transformation des fenêtres géminées en fenêtres à croisée en conservant les modénatures des premières.
La déambulation dans la ville permet ensuite d’observer les deux seules maisons pourvues de fenêtres à réseaux sur la place de la Halle, à l’entrée de la rue de la Porte-Rodanèze et de s’interroger sur l’absence d’architecture du XIVe siècle à Saint-Antonin.
Devant le 6 de la rue de la Pélisserie, Alexia Aleyrangues explique que c’est à la suite de la demande de l’architecte des bâtiments de France, qui souhaitait avoir des précisions sur le dessin des arcades disparues du rez-de-chaussée, qu’une rapide étude en a été faite, en moins d’une journée. Toutes les divisions intérieures et les enduits avaient d’ores et déjà disparus, néanmoins la plupart des éléments du XIIIe siècle ont pu être restitués. Des dessins ont ensuite été produits par le service de l’UDAP afin de procéder à leur localisation. Le plus souvent, c’est à l’occasion de l’examen des projets de travaux présentés par les propriétaires que des observations ponctuelles, limitées à quelques photographies et à l’ouverture d’une notice inventaire, peuvent être faites. Il faut en outre rappeler que le service du patrimoine du Pays Midi-Quercy assure le même suivi à Caylus, Puylaroque, Bruniquel, Caussade, etc. Plusieurs personnes se demandent si ces bourgs qui possèdent un patrimoine architectural aussi riche et semblable n’auraient pas intérêt à se doter d’un service commun, la mutualisation des moyens leur permettant de disposer de personnels à même de conduire des études archéologiques et de mettre les résultats de leurs investigations à disposition du public.
Rue Droite, un exemple de maison avec une façade en pan-de-bois est présenté par Anne-Laure Napoléone. Très comparable à une maison de La Canourgue en Lozère, la structure de la façade est faite de poteaux formant les encadrements des fenêtres à croisées et portant chacun une des solives de plancher de l’étage supérieur. A.-L. Napoléone souligne cette particularité qui suppose que la façade n’était pas montée au sol, comme cela est souvent le cas pour le pan-de-bois, mais directement en élévation.
L’observation des plusieurs maisons comportant des modillons romans en façade a fait naître une nouvelle hypothèse. Pierre Garrigou Grandchamp a exposé que les modillons de la façade de la maison n° 56 rue Droite sont en remploi, mais qu’ils seraient vraisemblablement dans leur emplacement initial au-dessus du premier étage, à porter l’encorbellement d’un étage en pan-de-bois, comme sur la maison n°1 place de Payrols. Cependant, après avoir fait un rapide inventaire des modillons romans visibles depuis la voie publique et remployés dans les façades des maisons, Daniel Cazes, qui souligne la qualité de leur sculpture, propose d’y voir plutôt les vestiges en remploi d’un portail roman de l’abbatiale. Il suggère qu’une étude complète des modillons soit réalisée, en établissant des parallèles avec les collections lapidaires du musée, pour examiner plus avant cette hypothèse.

Samedi 22 juin 2019 : journée foraine à Saint-Antonin-Noble-Val
Communication longue de Jean-Luc Boudartchouk : « Histoire et archéologie des Goths de Toulouse ».
Communication brève de Daniel Cazes « A propos de l’histoire de l’art wisigothique à Toulouse et ailleurs ».
Lire le compte-rendu
 Des hypothèses avancées récemment sur l’ancienne église de la Daurade à Toulouse et tout un questionnement, surtout dans la péninsule Ibérique mais aussi dans le Midi de la France, sur la nature d’un art wisigothique susceptible de s’être déployé, de Toulouse à Tolède, du Ve au VIIIe siècle, paraissent mériter quelques commentaires, dans l’attente d’une synthèse sur le sujet. Cette dernière est encore prématurée et sans doute y reviendrons-nous plus tard et plus longuement au sein de notre Société. Il nous semble cependant utile de rappeler brièvement, en coordination avec les recherches exposées précédemment par Jean-Luc Boudartchouk, certains principes pour aider à l’identification d’une telle création artistique.
Des hypothèses avancées récemment sur l’ancienne église de la Daurade à Toulouse et tout un questionnement, surtout dans la péninsule Ibérique mais aussi dans le Midi de la France, sur la nature d’un art wisigothique susceptible de s’être déployé, de Toulouse à Tolède, du Ve au VIIIe siècle, paraissent mériter quelques commentaires, dans l’attente d’une synthèse sur le sujet. Cette dernière est encore prématurée et sans doute y reviendrons-nous plus tard et plus longuement au sein de notre Société. Il nous semble cependant utile de rappeler brièvement, en coordination avec les recherches exposées précédemment par Jean-Luc Boudartchouk, certains principes pour aider à l’identification d’une telle création artistique.
« Les Goths, après leur entrée en Gaule en 412/413, s’installent rapidement à Toulouse, qu’il tiennent déjà avant 417. Ils y demeureront jusqu’au printemps 508, date où la conquête franque met un terme au royaume des Goths de Gaule, entité politique dont Tolosa était depuis longtemps la capitale. Le réexamen des données textuelles et l’apport récent de l’archéologie permettent de préciser la vision que l’on peut avoir, désormais, de la capitale des Goths et de ses environs ».
Clôture de l’année académique.
Présents : Mme Nadal, Présidente, MM. Ahlsell de Toulza, Trésorier, Cabau, Secrétaire général, Mme Napoléone Secrétaire-adjointe, M. Péligry, Bibliothécaire-archiviste ; Mmes Bessis, Cazes, Fournié, Haruna-Czaplicki, Jaoul, Merlet-Bagnéris, Vallée-Roche ; MM. Balty, Boudartchouk, Cazes, Garland, Garrigou Grandchamp, Macé, Peyrusse, Scellès, Sournia, Surmonne, Testard, membres titulaires ; Mmes Balty, Dumoulin, Jiménez, Queixalós, Viers ; MM. Darles, Landes, Laurière, Molet, Penent, Rigault, Suzzoni, membres correspondants.
Excusé : Philippe Gardes.
Invitée : Mme Alexia Aleyrangues, chargée de mission de l’Inventaire en pays de Quercy.
La Présidente fait circuler les six exemplaires de la revue Forum offerts à la Société par notre confrère Daniel Cazes (temes d’historia i d’arqueologia tarragonines) et nous présente un nouvel ouvrage d’André Czeski, Montségur, nouveau regard, histoire, archéologie, études sur le site, envoyé par les éditions 3 R pour un éventuel compte rendu. Elle donne ensuite lecture d’une lettre de candidature émanée de Mme Catherine Letouzey-Rety.
La parole est ensuite donnée à Jean-Luc Boudartchouk pour une communication longue intitulée Histoire et archéologie des Goths à Toulouse (413-508).
Émilie Nadal propose d’enchaîner avec le second exposé, une communication courte de Daniel Cazes : À propos de l’art wisigothique à Toulouse et ailleurs.
La Présidente remercie nos deux confrères et demande à Jean-Luc Boudartchouk des précisions au sujet des prétentions des Wisigoths sur l’église Saint-Sernin évoquées dans sa communication. À l’arrivée des Wisigoths à Toulouse, répond-il, il existe bien un édifice sur la tombe de saint Saturnin. Les deux textes mentionnés montrent qu’ils s’intéressaient à la puissance tutélaire du saint toulousain, et peut-être ont-ils voulu récupérer « sa » basilique, mais le récit qui en est fait à cette époque présente quelques difficultés d’interprétation. Il est probable que les relations ont été tendues entre les deux hiérarchies religieuses (nicéenne et arienne) ; cependant, les deux communautés avaient la même dévotion à Saturnin – rappelons qu’il existe deux tombes gothes à Saint-Sernin. Il y avait donc surtout convergence des enjeux de pouvoir. Maurice Scellès se demande si l’on connaît des exemples d’édifices religieux réutilisés par les Wisigoths. Non, répond Jean-Luc Boudartchouk. Mais s’il y avait un évêque arien, il y avait forcément une église cathédrale quelque part, réquisitionnée ou construite à ce moment-là. Émilie Nadal demande encore quels sont les éléments qui permettent d’attribuer des origines wisigothiques à l’église de la Daurade. Daniel Cazes précise tout d’abord que ce n’est pas un roi qui fait construire une église, mais un évêque. Quitterie Cazes continue en évoquant l’historiographie des Wisigoths qui, à l’instar de celle des Cathares, a produit une littérature abondante et pas toujours fiable d’un point de vue scientifique. Christian Darles revient sur la gravure de l’édifice publiée par dom Martin en 1727 et s’interroge sur l’oculus qui perce la voûte en son centre. Selon Daniel Cazes, la planche est sommaire, et elle ne permet pas de savoir de quand date cette voûte ; l’oculus situé à l’aplomb de l’autel a pu être aménagé pour faire passer les cordes permettant de sonner les cloches. Patrice Cabau précise que Jacques Martin, né à Fanjeaux en 1684, entré à 24 ans dans la Congrégation de Saint-Maur, prononça en 1709 ses vœux à la Daurade ; il partit plus tard pour Saint-Germain des Prés, et la mention « Envoyé de Toulouse » portée par la gravure montre qu’il avait dû conserver des relations dans le prieuré toulousain. Maurice Scellès rappelle que la gravure ne figure pas les passages et Daniel Cazes précise que si les trois registres sont sûrs, la forme des arcs est moins certaine. Christian Landes se demande enfin si la comparaison des plans apporte des informations quant à la dimension des pans coupés de l’édifice. Oui, répond Daniel Cazes, mais ils n’apportent pas d’indications sur la coupole.
Émilie Nadal donne à nouveau la parole à Jean-Luc Boudartchouk, qui se fait le porte-parole de Philippe Gardes pour une question d’actualité : Léon Joulin avait raison. La fortification gauloise de Vieille-Toulouse.
À une question de Louis Peyrusse concernant l’existence d’autres traces d’occupation gauloise dans la zone indiquée, notre confrère répond que l’on a connaissance de puits, autrefois dits funéraires, d’habitations et d’activités artisanales. Il précise encore que le rempart repéré constitue un monument dont le système est complexe mais cohérent. Christian Darles se demande s’il ne peut s’agir d’un rempart médiéval. Jean-Luc Boudartchouk répond que les reprises de cette époque sont bien connues et que les deux ensembles ont été bien différenciés. Laurent Macé demande quels sont les équivalents connus et si cela permet de faire de cette agglomération la capitale des Volques. Notre confrère cite les exemples du Mont-Beuvray, de Manching, en plus de ceux connus en Europe centrale, et il confirme que les dimensions du site en font certainement une grande capitale, à l’échelle d’un des peuples majeurs du sud de la France, ce qui explique la façon dont on en parle dans les textes anciens.
Une seconde question d’actualité est présentée par notre consœur Marie-Vallée Roche : L’apport de l’étude épigraphique à la datation de l’autel de Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault).
Lors de la table ronde qui s’est tenue en août 2002 autour de l’autel médiéval et de la fondation de l’abbaye de Gellone, Cécile Treffort avait étudié deux inscriptions, gravées, l’une sur la tranche droite de l’autel, l’autre sur la dalle latérale gauche, indiquant chacune une date, pour la première : « p(ri)ma die aug(us)ti », et pour la seconde : « die .II. aug(us)ti ». Deux dates donc, 1er et 2 août, gravée d’une écriture similaire, dont on peut penser qu’elles sont contemporaines. L’absence de vocable et la discrétion des inscriptions ne permettent probablement pas d’y voir une date de consécration. D’ailleurs, ces dates ne correspondent nullement à la consécration de la basilique Saint-Sauveur, qui a eu lieu le 14 décembre 805, ni à celle de la nouvelle basilique, le 30 septembre 1039. L’événement auquel se rapportent ces inscriptions reste donc mystérieux. Quant à leur datation, « malgré une écriture en minuscules carolines, l’écartement net entre les mots et la présence d’un signe diacritique sur le i n’apparaissent ni dans les inscriptions ni dans les manuscrits avant la seconde moitié du XIe siècle. » [1].
La table d’autel comportait-elle d’autres « graffitis », comme c’est le cas sur de nombreuses tables d’autel dans la région ? Une observation minutieuse révèle qu’une notable partie de sa surface a été abrasée, rendant probablement impossible toute réelle étude épigraphique. On peut rapprocher cet état de celui de l’autel de Saint-Pierre de Lauriol (conservée aujourd’hui au musée d’Aix-en-Provence) dont la table a été abrasée au XXe s. ne permettant plus d’y lire les signatures relevées au XIXe s. par l’abbé Barges.
Néanmoins subsiste en dehors de cette surface un nom qui se détache très clairement, car il a été profondément gravé : on peut lire WIR. Cette inscription est surprenante, car il semble s’agir d’un nom/racine germanique, jusqu’à présent inconnu dans les « graffitis » du Midi de la France et de la Catalogne. Le W est-il un M à l’envers ? Mir est en effet un nom bien attesté localement. Cependant, si les confusions graphiques existent dans ce type d’inscriptions, il n’existe actuellement aucun exemple d’une confusion M/W. L’épigraphiste catalan Salvador Alavedra, qui a recensé 82 formes gravées du M sur les autels de Catalogne, n’en connaît aucune qui permettrait la confusion avec un W. [2].
La technique utilisée (l’usage du poinçon pour délimiter les extrémités des lettres, voire leur point central, en préalable au tracé lui-même) et la forme des lettres elles-mêmes rapproche cette écriture de celles de certains signataires de Minerve (Hérault), personnages attestés dans le dernier tiers du IXe siècle [3]. Certes, une datation par le style d’écriture est toujours aléatoire ; il conviendrait donc de replacer cette inscription dans un vaste corpus de signatures d’autels pour vérifier si la remarque est pertinente. Mais s’il s’agit bien d’un nom de personne, sa forme germanique renvoie au haut Moyen Âge, et son caractère simple montre qu’il n’est pas postérieur au début du XIe siècle. D’ailleurs tous les graffiti sur tables d’autel dans le Midi de la France étudiés jusqu’à présent sont antérieurs à la réforme grégorienne [4].
Cette inscription est sans doute à mettre en relation avec les graffiti que l’on peut voir aujourd’hui sur les colonnes du cloître. Ce type de signatures se trouve toujours dans le sanctuaire à proximité de l’autel et des reliques. À Saint-Vincent de Bielle (Pyrénées-Atlantiques) les quatre colonnes engagées de la maçonnerie de l’abside reconstruite au XVIe s. sont couvertes de « graffitis » : elles devaient être à l’origine destinées à soutenir le baldaquin d’un ciborium [5]. Les colonnes et chapiteaux de la crypte de Montmajour (Bouches-du-Rhône) comportent plus d’une centaine de noms gravés [6]. Le fragment de colonne en marbre blanc visible dans l’église de Minerve, graffité comme l’autel, pourrait être un pied d’autel ou un morceau de ciborium. Si l’on se réfère à tous ces exemples, les colonnes du cloître de Saint-Guilhem sont un réemploi ; elles devaient être à l’origine situées dans le sanctuaire, à proximité d’un autel reliquaire.
Emmanuel Garland trouve curieux que les inscriptions décrites n’aient pas été copiées depuis le XIIe siècle, mais il reconnaît qu’il y a souvent de grands mystères, comme celui l’épitaphe de Saint-Bernard [?], dont l’écriture est carolingienne et que les textes ne mentionnent pas avant la fin du XIe siècle. Notre consœur confirme que l’on peut en effet trouver plusieurs arguments à ce silence des sources et précise que pour l’instant elle ne prétend rien faire de plus que d’ouvrir le dossier.
La Présidente nous informe que le fragment d’un bréviaire de chœur d’Agen daté de 1300, que nous avions présenté en question d’actualité lors d’une séance précédente, a finalement été acquis par la Bibliothèque municipale d’Agen. Le feuillet concerné est lié à saint Augustin et on sait que l’ouvrage avait été commandé par Bertrand de Got.
Émilie Nadal donne enfin la parole à Maurice Scellès pour une dernière question d’actualité portant sur des Demeures médiévales de la ville de Saint-Antonin-Noble-Val. Il nous annonce que la maison Muratet, dans laquelle fut trouvé un décor peint appliqué sur une cloison en pans de bois datée par dendrochronologie de 1250 environ, a été acquise par la Mairie avec un projet qui reste à définir. On pense à la création d’un musée éclaté éventuellement mis en place sous la direction de la Communauté de Communes. Maurice Scellès propose à l’assemblée d’attribuer une médaille à la municipalité pour l’acquisition de cette demeure. En évoquant l’exemple de Grandselve et de La Salvetat-Saint-Gilles, Daniel Cazes insiste sur l’utilité de l’attribution de ces médailles. Maurice Scellès attire cependant notre attention sur la maison de la rue de Cayssac, toujours à Saint-Antonin-Noble-Val. En effet, cette demeure, qui a livré de nombreux vestiges intéressants, est actuellement mise en vente pour la somme de 50 000 euros. Notre invitée, Alexia Aleyrangues, chargée de mission de l’Inventaire en pays de Quercy, nous présente l’édifice.
Maurice Scellès demande ce qu’il est possible de faire de cette maison peu accessible et peu aménageable pour l’habitation. Il pense en revanche que dans le cadre d’un projet de musée éclaté, elle pourrait trouver sa place. Cependant, il est peu probable qu’après l’acquisition de la maison Muratet la municipalité puisse acheter cet édifice. Pourtant, les problèmes d’aménagement de cette demeure se poseront toujours, pense-t-il, jusqu’à ce qu’elle tombe dans le domaine public. Que peut faire la S.A.M.F. ? Elle peut l’acheter, mais la charge d’entretien est trop importante. Il est possible de solliciter la Société des Amis du Vieux Saint-Antonin lors de notre visite le 22 juin, mais il est préférable d’en débattre entre nous auparavant. Daniel Cazes rappelle que le problème touche la France de façon générale, et demande quelle commune a un programme pour son patrimoine ; il prend pour exemple les démarches infructueuses qu’il avait effectuées pour la demeure sise au n° 7 de la place Saint-Sernin ; le problème, poursuit-il, est que les élus n’ont pas conscience de l’existence et de la valeur de ce patrimoine. Quitterie Cazes précise que la situation peut être différente entre les grandes et les petites villes. En effet, pour ces dernières, le patrimoine peut être une chance, un atout pour le tourisme. Elle ajoute que la S.A.M.F. peut acheter la maison et la donner à la Mairie, mais il n’est pas sûr que celle-ci en veuille. Pierre Garrigou Grandchamp approuve ce que vient de dire notre consœur et note que cet édifice a un gros défaut dans son état actuel : le rez-de-chaussée appartient à une autre maison. Il pense par ailleurs que la parcelle médiévale devait s’étendre jusqu’à la place. Pour revenir aux problèmes de gestion du patrimoine, il déclare qu’il faut opérer une sorte de révolution auprès des élus en faisant comprendre qu’un bâtiment est un document exceptionnel au même titre qu’un parchemin. Il évoque enfin le système de fonds de dotation mis en place à Cluny il y a quelques années, qui a permis d’acheter une maison romane, de financer des fouilles et des restaurations. Cette entreprise a suscité un grand intérêt de la part du public, mais il est nécessaire ajoute-t-il qu’il y ait des acteurs sur place. Alexia Aleyrangues déclare que la Société des Amis du Vieux Saint-Antonin est intéressée, mais qu’elle manque d’expérience. Il est certain cependant que la municipalité, déjà engagée pour la maison Muratet, ne peut guère faire plus. Il est nécessaire de faire comprendre à la Mairie que l’on peut procéder par étapes, ajoute Maurice Scellès : le plus important est de mettre l’édifice hors d’eau ; on peut attendre pour le reste que les fonds soient récoltés. Louis Peyrusse conclut qu’il est donc important que l’Association des Amis du Vieux Saint-Antonin connaisse l’utilisation du fonds de dotation à Cluny. Maurice Scellès précise qu’il a déjà eu un contact avec le Président de cette association, mais qu’il voulait au préalable que nous en discutions entre membres de la Société. Christian Landes ajoute enfin que le problème se pose pour tout le patrimoine et pense qu’il y a une cassure entre le pouvoir et le public ; il faudrait selon lui commencer par éduquer le pouvoir, et il faudrait que l’amateur du patrimoine ait un statut.

Séance foraine du 28 mai 2019
Séance foraine :Visite de la Maison Seilhan en compagnie de Claire Rousseau.
Lire le compte-rendu
 Berceau de l’ordre des Prêcheurs en 1215, puis Maison de l’inquisition au cours du 13e siècle, ce lieu abrite de nombreuses œuvres qui témoigne de l’histoire médiévale et moderne des dominicains à Toulouse.
Berceau de l’ordre des Prêcheurs en 1215, puis Maison de l’inquisition au cours du 13e siècle, ce lieu abrite de nombreuses œuvres qui témoigne de l’histoire médiévale et moderne des dominicains à Toulouse.

Séance du 14 mai 2019 (séance privée)
Communication longue de Magali Vène et Aurélia Cohendy : « Un nouveau livre d’heures du Maître des Heures de San Marino (Toulouse, vers 1470) ».
Lire le compte-rendu
Questions diverses : Emmanuel Garland, « Information sur le projet de restauration de l’église de Saint-Calixte de Cazaux.
Appel à communication pour l’année 2019-2020 : Le programme de l’année 2019-2020 se remplit rapidement ! Si vous souhaitez intervenir, veuillez adresser dès que possible et avant la fin du mois de mai vos propositions de communication pour l’année 2019-2020 au bureau samf@societearcheologiquedumidi.fr ou directement à la présidente emilienadal@gmail.com. En précisant la durée souhaitée (brève, courte, longue), le titre et le moment dans le calendrier (de novembre à juin 2020).
Présents : Mmes Nadal, Présidente, MM. Ahlsell de Toulza, Trésorier, Cabau, Secrétaire général, Mme Napoléone, Secrétaire-adjointe, Péligry, Bibliothécaire-archiviste ; Mmes Cassagnes-Brouquet, Cazes, Czerniak, Fournié, Haruna-Czaplicki ; MM. Garland, Julien, Lassure, Peyrusse, Scellès, Sournia, membres titulaires ; Mmes Dumoulin, Vène, MM. Penent, Pousthomis, Rigault, Suzzoni, membres correspondants.
Excusés : Mmes Balty, Galés, Merlet-Bagnéris, Pradalier et Sénard, MM. Balty, Cazes, Garrigou Grandchamp, Macé et Surmonne.
Invitée : Mme Aurélia Cohendy.
Au titre des courriers reçus, la Présidente nous annonce que nous est parvenue une réponse à la lettre que nous avions envoyée à la Mairie au sujet des arbres plantés autour de Saint-Sernin et des épitaphes dégradées enchâssées dans les murs nord de la basilique. Ce courrier se veut rassurant quant aux problèmes que nous avions soulevés.
Émilie Nadal donne ensuite la parole à Maurice Scellès, qui nous présente un cliché ancien de Bretenoux acheté sur le site ebay. Celui-ci montre un édifice ouvert au rez-de-chaussée par une porte en arc brisé aujourd’hui disparue. Notre confrère fait don de ce cliché à la Société.
La Secrétaire-adjointe donne enfin lecture du procès-verbal de la séance du 30 avril, adopté par l’assemblée.
La Présidente donne la parole à Aurélia Cohendy et à Magali Vène pour une communication longue : Un nouveau livre d’heures du Maître des Heures de San Marino (Toulouse vers 1470).
Émilie Nadal remercie les conférencières et se réjouit de cette collaboration réussie entre professionnels et universitaires. Elle demande comment est situé le maître de San Marino dans le reste de la production toulousaine de cette époque et si ses commanditaires sont connus. Aurélia Cohendy met en avant le livre d’heures de Jean de Colombe. En effet, cet ouvrage a été vu à Toulouse, où il a pu servir de modèle aux artistes. Cependant, aucun nom de commanditaire n’est aujourd’hui connu. Magali Vène fait remarquer que cet artiste travaille en outre avec des imprimeurs et que la collaboration avec les libraires est connue par les textes. Louis Peyrusse est frappé par la qualité inégale des décors, ce qui trahit l’intervention de plusieurs mains. Sophie Cassagnes-Brouquet rappelle qu’il y avait en général plusieurs intervenants dans un atelier et qu’il est possible de distinguer trois mains sur une seule page : une pour les bordures, une pour les scènes et une troisième pour les lettrines. Maurice Scellès voudrait savoir si des variations entre les mains sont constatées sur une même page ou seulement dans des manuscrits distincts. Dans le cas du Maître de San Marino, Aurélia Cohendy précise qu’il s’agit surtout de différences marquées entre plusieurs manuscrits, en fonction du caractère plus ou moins luxueux de la commande. Pascal Julien note que cette notion d’atelier est difficile à appréhender et s’intéresse à l’illustration représentant sainte Suzanne. Si elle figure sur le livre d’heures, selon lui, cela indique que sa dévotion est actée. En effet, ajoute Michelle Fournié, les restes de la sainte ont été exhaussés en 1496 à Saint-Sernin, après qu’un prêtre bordelais les ait vus en rêve (comme l’indique le dossier publié dans l’ouvrage de Nicolas Bertrand). Emmanuel Garland note les dimensions réduites du livre d’heures, qui auraient imposé selon lui un traitement décoratif adapté ; il demande si tous les manuscrits donnés en comparaisons sont de taille similaire. Il lui est répondu que c’est effectivement le cas. Évoquant une enluminure présentée, Bernard Pousthomis s’interroge sur la façon dont les peintres modernisaient un manuscrit. Les conférencières répondent que les visages sont par exemple repeints, vraisemblablement après qu’on a gratté la surface du parchemin. Sophie Cassagnes-Brouquet note que le renard et la poule que l’on a vus figurés sur les enluminures exposées sont des motifs à la mode à cette époque. Maurice Scellès s’interroge enfin sur la présence de la fileuse dans les scènes d’Annonciation. Emmanuel Garland répond qu’elle est en effet représentée dans cette scène dès le IVe siècle.
La Présidente donne ensuite la parole à notre confrère Emmanuel Garland pour une information brève au sujet du projet de restauration qui touche actuellement l’église Saint-Calixte de Cazaux-Fréchet (Haute-Pyrénées).
Un espoir sérieux renaît à Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors, petite commune de moins de 50 habitants sise à l’extrémité de la vallée du Louron, sur la route du col de Peyresourde. Parmi son patrimoine religieux, l’église Saint-Calixte, classée Monument Historique en 1944, recèle de nombreuses œuvres intéressantes : des peintures murales romanes, d’autres des XVe et XVIe siècles, un plafond à la française, un retable de Marc Ferrère, etc. À l’instigation de Dominique Galaup, son maire, et de la DRAC Occitanie, un fonds de soutien a récemment été créé pour permettre la restauration du monument et tout particulièrement de ses peintures murales. Le projet a été retenu par la Fondation du Patrimoine et, suite au Loto du Patrimoine organisé, une enveloppe de 50 000 euros lui a été octroyée. Un appel d’offre a été lancé pour une étude préalable. L’association « Saint-Calixte, mil ans et après » qui, depuis une vingtaine d’années, s’était mobilisée pour permettre à l’église de passer l’épreuve du temps et d’être ouverte aux visiteurs l’été, a dévolu ses actifs patiemment accumulés au fil des années au fonds de soutien. Les conditions semblent désormais réunies pour que Saint-Calixte puisse enfin bénéficier des travaux et de la mise en valeur qu’elle mérite.
Bernard Pousthomis demande si l’appel d’offre des travaux concerne uniquement le décor peint. En effet, poursuit-il, le cul-de-four étant fissuré, il serait inutile de restaurer les peintures sans renforcer l’architecture. Emmanuel Garland avoue que le projet n’est pas encore très clair, mais il espère voir des travaux entrepris prochainement.
Dans le cadre d’une seconde information, Maurice Scellès montre à l’assemblée une brique taillée en tore provenant d’une voussure d’une fenêtre de la tour d’Arles à Caussade, trouvée dans le comblement d’une cheminée. Il fait don de cette brique à la Société.

Séance du 30 avril 2019 (séance privée)
Communication longue de Frédéric Loppe et Astrid Huser : « La maison consulaire du Bourg à Narbonne (Aude) : histoire et évolution architecturale (XIIIe-XIXe siècles) ».
Lire le compte-rendu
En 2011, un diagnostic archéologique de l’INRAP au n°7 rue Benjamin Crémieux à Narbonne (Aude) a confirmé la présence de vestiges de l’ancienne maison consulaire du Bourg, datée du milieu du XIIIe siècle. La nature et la qualité de la construction ont motivé son classement MH en 2013 et la prescription d’une étude du bâti avant travaux en 2015 (ALC Archéologie). Ces recherches ont permis de restituer un vaste bâtiment d’environ 24 m de long sur 13 m de large, dont le rez-de-chaussée divisé par deux refends était occupé par des boutiques s’ouvrant probablement sur la rue par de grandes arcades aujourd’hui disparues. Le premier étage, d’un seul tenant, était orné de peintures et couvert d’une toiture à fermes apparentes probablement décorée s’élevant à 8 m. Il était éclairé côté sud par six vastes baies géminées de 5 m de haut surmontées d’un arc-larmier aujourd’hui bûché. Elles étaient surplombées d’une corniche à modillons sculptés, pour certains en remploi. Aux XVIIe puis XIXe siècles, cet ensemble a subi d’importantes transformations qui ont profondément dénaturé les maçonneries d’origine (destruction des baies médiévales, percement de portes et de fenêtres, divisions, etc.). Peu connue, cette maison consulaire constitue toutefois un témoin exceptionnel d’architecture civile qui n’a pratiquement pas d’équivalents en France, hormis la maison romane de Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn-et-Garonne ; milieu XIIe siècle) ou l’aula du palais consulaire d’Arles (Bouches-du-Rhône ; fin XIIe-début XIIIe siècles).


Présents : MM. Ahlsell de Toulza, Trésorier, Cabau, Secrétaire général, Mme Napoléone, Secrétaire-adjointe, M. Péligry, Bibliothécaire-archiviste ; Mmes Bessis, Pradalier-Schlumberger, Vallée-Roche, MM. Peyrusse, Scellès, Sournia, Surmonne, Testard, Tollon, membres titulaires ; Mmes Joy, Pilloix, Viers, M. Loppe, membres correspondants.
Excusés : Mmes Balty, Cazes, Czerniak, Fournié, Jaoul, Lamazou-Duplan, Nadal, Sénard, Watin-Grandchamp ; MM. Balty, Cazes, Catalo, Darles, Garland, Garrigou Grandchamp.
Patrice Cabau énonce la liste des membres excusés et, en l’absence de notre Présidente et de notre Directrice de publication, s’apprête à animer la séance. Il demande à la Secrétaire-adjointe de lire le procès-verbal de la dernière séance, qui est adopté après quelques modifications.
Puis il donne la parole à notre confrère Frédéric Loppe pour sa communication, intitulée La maison consulaire du Bourg à Narbonne : histoire de son évolution du XIIIe au XIXe siècle.
Patrice Cabau remercie notre confrère pour la présentation de cet édifice exceptionnel. Il demande quel est le terme employé pour le désigner dans les sources médiévales et s’il existait un bâtiment équivalent dans la Cité de Narbonne. Frédéric Loppe répond ne pas savoir quel est le mot utilisé dans les sources et confirme que deux maisons consulaires existaient bien au milieu du XIIIe siècle : une dans la Cité et une autre dans le Bourg. Patrice Cabau demande encore si à l’occasion de la fusion des deux maisons dans le Bourg à la fin du XIIIe siècle, des agrandissements furent opérés sur l’édifice présenté. Le conférencier rappelle que les travaux d’investigations qu’il a menés avec Astrid Huser se sont limités à une petite partie du corps de bâtiment sud, mais il assure que dans cette portion de l’édifice aucune trace de reprise du bâtiment n’a été relevée. Louis Peyrusse s’interroge sur les éventuelles procédures effectuées pour la protection d’un tel bâtiment. Le conférencier dit que la parcelle étudiée a été classée, ainsi que toutes celles jadis occupée par le bâtiment médiéval. Bernard Sournia voudrait savoir si la salle du premier étage occupait toute la surface de l’aile sud et où se trouvait l’accès. La salle avait effectivement la superficie du corps de bâtiment méridional, confirme Frédéric Loppe, qui suppose que l’on y accédait par la cour située au Nord, ouverte sur les quais par une porte cochère, bien que les sources ne soient pas très claires sur l’emplacement de l’accès principal.
Maurice Scellès fait remarquer en effet qu’une porte cochère indique plutôt un accès pour les chevaux et que l’entrée piétonne pouvait se trouver ailleurs. Il se dit par ailleurs très étonné par la hauteur considérable des fenêtres du premier étage, et constate que les arcs restitués au rez-de-chaussée paraissent du coup trop petits. Puis il pose plusieurs questions : Est-on sûr de la vocation marchande du rez-de-chaussée, l’escalier ne pouvait-il se trouver à cet endroit, les fenêtres sont-elles bien celles de 1250 ou celles du bâtiment qui a réuni les deux maisons consulaires ? Il remarque encore que la poutre qui a été datée de 1250 par des analyses de dendrochronologie n’a pas été trouvée en place ; pour assurer la datation haute proposée par l’étude, il faudrait soumettre le décor qu’elle a conservé au jugement de spécialistes. Il faudrait pouvoir enfin comparer la maison consulaire à un ou deux édifices, car dans l’état actuel des recherches effectuées, il reste difficile de savoir si l’on a affaire à l’édifice de 1250 ou à celui qui a réuni les deux bâtiments à la fin du XIIIe siècle.
Louis Peyrusse s’enquiert du projet qui a généré l’étude présentée. Frédéric Loppe nous informe que des logements sociaux doivent être aménagés dans cette parcelle, mais que ces travaux prévus depuis longtemps n’ont toujours pas commencé. Catherine Viers note que le classement a sans doute permis de faire connaître le potentiel de l’édifice, ce qui justifie sans doute le retard des travaux. Maurice Scellès se demande quel projet permettra de mettre en valeur ce bâtiment classé. Frédéric Loppe regrette que la Mairie n’ait pas profité de l’occasion pour acquérir la parcelle et amorcer un projet qui aurait pu à terme s’étendre à toutes les autres.
Guy Ahlsell de Toulza voudrait savoir comment se présente aujourd’hui la partie nord de l’ancienne maison consulaire et combien de niveaux ont été aménagés sur la cour. Le conférencier répond que toute cette partie, élevée sur deux étages au-dessus d’un rez-de-chaussée, est enduite et seuls les modillons et la corniche qui soutenaient la toiture médiévale sont actuellement visibles. Bernard Sournia s’interroge justement sur la façon dont la toiture s’articulait au-dessus de cette corniche et demande s’il a été trouvé des édifices conservant une structure similaire. Le conférencier avoue n’avoir rien repéré de comparable au cours de ses recherches.
Diane Joy s’informe sur l’établissement d’un secteur sauvegardé dans la ville de Narbonne. Frédéric Loppe confirme son existence, mais il déclare que la décision du propriétaire du bâtiment reste déterminante. Maurice Scellès et Patrice Cabau pensent qu’une volonté municipale peut être décisive et questionnent le conférencier sur les informations données à la Mairie, les contacts qu’il a pu avoir avec elle ainsi qu’avec l’Architecte des Bâtiments de France. Frédéric Loppe affirme qu’aucune occasion de rencontre ne s’est présentée durant l’étude. Maurice Scellès lui conseille de proposer à la Mairie de Narbonne une visite de l’édifice ou une communication et considère comme essentiel de publier l’étude pour signaler ce bâtiment à la communauté scientifique.

Séance du 16 avril 2019 (séance privée)
Communication longue de Christian Darles et Jean-Michel Lassure : « Le site du Turas à Dunes (Tarn-et-Garonne) : analyse architecturale et présentation du mobilier archéologique ».
Lire le compte-rendu
 La tour du “ Turas” est établie à 2,5 km au sud-ouest de la bastide de Dunes (Tarn-et-Garonne), sur un promontoire dominant la vallée de l’Auroue. Des travaux de consolidation réalisés en 1988-89 par la commune qui venait de l’acquérir ont révélé qu’elle appartenait un petit château dont la période d’occupation se situe entre le XIIIe et le milieu du XIVe siècle. Un puits dans lequel, selon la légende, se seraient précipités des Templiers pour échapper aux Anglais, a été retrouvé à cette occasion. Creusé dans le calcaire, il mesure 2,50 m de diamètre à son ouverture pour une profondeur de 10 m. Son remplissage était constitué uniquement par de terre cendreuse et des galets. Un abondant matériel archéologique trouvé pendant les travaux se rapporte à la construction (éléments de huisserie, serrures et clés), aux occupations des habitants (outillage agricole et artisanal, céramiques) et à leur habillement (boucles de ceinture en alliage cuivreux doré et émaillé). Le site a aussi livré des témoignages liés à des activités religieuses (fragments d’un encensoir avec décor ajouré représentant des griffons), administratives (deux matrices de sceaux) et militaires (boulets de catapulte et carreaux d’arbalète).
La tour du “ Turas” est établie à 2,5 km au sud-ouest de la bastide de Dunes (Tarn-et-Garonne), sur un promontoire dominant la vallée de l’Auroue. Des travaux de consolidation réalisés en 1988-89 par la commune qui venait de l’acquérir ont révélé qu’elle appartenait un petit château dont la période d’occupation se situe entre le XIIIe et le milieu du XIVe siècle. Un puits dans lequel, selon la légende, se seraient précipités des Templiers pour échapper aux Anglais, a été retrouvé à cette occasion. Creusé dans le calcaire, il mesure 2,50 m de diamètre à son ouverture pour une profondeur de 10 m. Son remplissage était constitué uniquement par de terre cendreuse et des galets. Un abondant matériel archéologique trouvé pendant les travaux se rapporte à la construction (éléments de huisserie, serrures et clés), aux occupations des habitants (outillage agricole et artisanal, céramiques) et à leur habillement (boucles de ceinture en alliage cuivreux doré et émaillé). Le site a aussi livré des témoignages liés à des activités religieuses (fragments d’un encensoir avec décor ajouré représentant des griffons), administratives (deux matrices de sceaux) et militaires (boulets de catapulte et carreaux d’arbalète).
Questions diverses :
Françoise Merlet-Bagnéris : « Jules Ganot, créateur de la médaille de la Société archéologique : formation, choix de carrière ».
Présents : Mme Nadal, Présidente, MM. Ahlsell de Toulza, Trésorier, Cabau, Secrétaire général, Mme Napoléone, Secrétaire-adjointe, M. Péligry, Bibliothécaire-archiviste ; Mmes Haruna-Czaplicki, Jaoul, Merlet-Bagnéris, Watin-Grandchamp, MM. Balty, Cazes, Garland, Lassure, Peyrusse, Scellès, Testard, membres titulaires ; Mme Balty, MM. Darles, Pousthomis, Suzzoni, membres correspondants.
Excusés : Mmes Bessis, Cazes, Queixalós, Sénard et Vène, MM. Garrigou Grandchamp, Marquebielle, Penent, Sournia et Tollon.
La Présidente ouvre la séance en évoquant l’incendie de Notre-Dame de Paris survenu la veille. Elle souligne le sentiment de sidération ressenti par tous, même si l’état de l’édifice paraît ce matin moins grave que ce que l’on craignait. Les grands monuments traversent en effet les siècles et nous paraissent éternels. On se rend compte en fait qu’un simple incendie peut les faire disparaître. Émilie Nadal nous propose quelques secondes de recueillement.
Christian Darles signale que les spécialistes restent pessimistes et craignent l’effondrement de l’édifice à cause du plomb qui a fondu et qui pèse toujours sur les voûtes. Guy Ahlsell de Toulza ajoute que les voûtes n’ont que 25 cm d’épaisseur et qu’en plus du plomb elles ont reçu beaucoup d’eau, ce qui peut contribuer à les fragiliser. Il cite l’exemple de l’incendie de la cathédrale de Chartres.
Daniel Cazes se demande comment est organisée la sécurité dans le cadre d’un édifice pareil. D’après les informations qu’il a pu recueillir, une équipe de sécurité à donné l’alarme à 18 heures 20, les pompiers sont arrivés 20 minutes après, l’incendie avait déjà pris une grande ampleur ; selon lui, quelque chose n’a pas fonctionné. Il explique ensuite que dans un cas pareil, lorsque l’alarme est donnée, une équipe fait la visite complète du monument pour effectuer ce qu’on appelle une levée de doute. Pour redonner un peu d’optimisme à la discussion qui s’est engagée, Louis Peyrusse rappelle que les voûtes de la cathédrale de Nantes ont résisté à l’incendie qui a emporté sa charpente en 1972.
Il est ensuite procédé à la lecture du procès-verbal de la dernière séance, qui est adopté.
Émilie Nadal donne enfin la parole à Christian Darles et à Jean-Michel Lassure pour une communication longue intitulée Le site de Turas à Dunes (canton d’Auvillar, Tarn-et-Garonne). Intervention archéologique.
Elle remercie nos deux confrères pour cette présentation intéressante et demande si les objets dont il a été question ont été récupérés. Jean-Michel Lassure précise que la mairie de Dunes avait acheté le site et y a entrepris des travaux de décaissement, déversant les terres dans un champ voisin. L’équipe a donc effectué un travail de récolte dans ces déblais. D’autres objets ont été trouvés dans un puits ; tout a été déposé à la mairie. Maurice Scellès demande s’il a été trouvé des tessons modernes. Jean-Michel Lassure répond que le matériel est homogène d’un point de vue chronologique. Louis Peyrusse émet des doutes, car selon lui les fers à bœufs qui ont été présentés sont tardifs. Christian Darles ajoute que la tour se rattache aux modèles gascons décrits par Gilles Séraphin avec un rez-de-chaussée aveugle et une porte ouverte au premier étage nécessitant l’usage d’un escalier ou d’une échelle. Daniel Cazes revient sur les objets très intéressants qui ont été présentés, actuellement stockés dans les locaux de la mairie. Ils mériteraient selon lui de bénéficier des conditions de conservation d’un musée. Maurice Scellès pense qu’ils sont en effet en danger de dégradation voire de disparition ; il évoque le cas des objets rares du Musée de Minerve qui, faute de moyens corrects de conservation, sont actuellement en train de se détériorer. La solution serait peut-être de créer des musées départementaux. Daniel Cazes renchérit en évoquant les objets qui ont été jadis déposés à la mairie de Martres-Tolosane et qui ont aujourd’hui disparu. Bernard Pousthomis demande enfin s’il existe des textes sur la fondation du site. Jean-Michel Lassure répond qu’il n’y a rien à sa connaissance.
Dans le cadre des questions diverses, la Présidente donne la parole à Françoise Merlet-Bagnéris, qui nous rend compte de ses recherches sur Jean Ganot, créateur de notre médaille.
Jean Ganot (1838 ?-1900…)
- Jean Ganot, graveur, domicilié à Toulouse, 9 rue Saint-Rome. Il pourrait être né vers 1838, aurait eu 10 ans en 1848, serait rentré à l’École des Beaux-Arts et des Sciences Industrielles qui suivait alors le règlement donné par Gaillard (importance du dessin identique pour toutes les sections). Contexte : la ville de Toulouse est très favorable au développement des arts et métiers à partir de 1827 : salons, et des centaines d’exposants. À partir de 1836, l’École des Beaux-Arts (située dans l’ancien couvent des Augustins) ajoute la mention « Sciences Industrielles » à son nom. L’enseignement regroupe plus de 300 enfants à partir de l’âge de 11 ans, divisés en groupes de 10 sous la direction d’un moniteur. Cours de 6 à 8 h du matin l’été, de 6 à 8 h du soir l’hiver, avant d’aller travailler comme apprenti chez un patron. (ou de 11 à 13 h.). On distingue deux pratiques chez les sculpteurs : la sculpture statuaire pratiquée par les futurs artistes, et la sculpture d’ornement liée à l’art industriel : doreurs, fondeurs, ciseleurs, orfèvres, bijoutiers, ferblantiers, graveurs… Il s’agit bien d’une gravure sur métal issue du dessin, sans travail sur le volume. 1858 : Jean Ganot, ancien élève, maîtrise parfaitement cette gravure sur métal : il mentionne dans une lettre de candidature au poste de professeur la création d’une plaque d’adresse au burin, récompensée par une médaille d’or de 1re classe à l’exposition de Toulouse de 1858. Il est candidat en 1869 à la succession de M. Chambarron, graveur, professeur titulaire de la classe de gravure sur bois mentionnée durant un an (1868-1869). Dans une lettre du 25 février 1869, Jean Ganot prend pour preuve de sa science de graveur sur métal en citant la médaille de la Société archéologique du Midi, et celle de l’Académie des Sciences. Il s’agit de gravures sur métal, et en volume, ce qui ne convainc pas le jury : le matériel de l’atelier est-il adapté ? est-il trop « artiste » par rapport à un enseignement d’art appliqué destiné aux ouvriers et qui recrute de nombreux candidats ? Jean Ganot n’est pas reçu en tant que professeur. Pourtant, une classe de gravure sur bois et cuivre est ajoutée en 1869 à l’École des Beaux-Arts.
- Jules Ganot, son fils, naît en 1863. Jean Ganot aurait pu avoir 25 ans (?) lorsque Jules est né. Jules sera élève également à l’École des Beaux-Arts et des Sciences Industrielles, obtiendra le prix d’encouragement en dessin et solide au trait en classe de ronde-bosse et antique, et le 2e prix de tête d’après l’antique en classe de ronde-bosse et d’antique. Il vit toujours rue Saint-Rome, où il travaille dans l’atelier familial. En 1882, il va à Paris et entre dans l’atelier d’Alexandre Falguière durant un an, puis revient à Toulouse pour y pratiquer la gravure industrielle, bénéficiant de nombreuses commandes. L’École déménageant quai de la Daurade, Jean est alors recruté en 1896 et y enseignera jusqu’à sa mort. En 1900, il avait fondé l’atelier de gravure en médaille.
Jules Ganot (1863-1933)
- Jules Ganot, fils de Jean Ganot, naît à Toulouse le 26 décembre 1863. (Réforme du dessin appliquée à partir de 1863.) En 1870 sont instituées deux sections artistiques : cours d’éléments du dessin et de ronde-bosse, et cours de dessin graphique et d’ornement. Il entre à l’École en 1874. Parallèlement à l’enseignement suivi dès l’enfance dans l’atelier de son père, il suit les cours de dessin et obtient en 1879 le prix d’encouragement en dessin et solide au trait en classe de ronde-bosse et antique, et le 2e prix ex aequo de tête d’après l’antique en classe ronde-bosse et d’antique. Il est donc très compétent dans ces formations. Pas de prix de modèle vivant ni d’ornement. 1882 : il va à Paris et se présente au concours d’entrée à l’École nationale des Beaux-Arts. Il y est reçu directement. Il rentre dans l’atelier de sculpture d’Alexandre Falguière (Toulouse 1831-Paris 1900), nommé à l’École nationale des Beaux-Arts de Paris la même année, et qui a dû proposer à Ganot de le rejoindre. Il y fréquente les ateliers de peinture et de sculpture du maître, mais pas son atelier de gravure, inutile. Il reste un an à Paris, puis revient à Toulouse sans avoir désiré poursuivre des études à l’É.N.B.-A. pour obtenir un diplôme parisien. Il y retrouve l’atelier paternel de la rue Saint-Rome où il choisit de pratiquer la gravure industrielle, en collaboration avec un autre graveur toulousain : Payrau. Ils réalisent des cachets, des chiffres, des lettres, des plaques, etc. Dès 1884, la Ville de Toulouse le charge de l’exécution de divers travaux comme des en-têtes de courriers, des libellés, et quelques sceaux. Production abondante et de qualité en travaux de taille-douce, eau-forte, taille d’épargne, ciselure… pour le commerce et l’industrie. Travail en atelier et vie professionnelle assurée par des commandes officielles et privées. Il pose sa candidature au poste de professeur suppléant de la classe de gravure de l’École des Beaux-Arts et des Sciences Industrielles, section en développement constant. Il y intervient à partir du 30 avril 1896, fonde l’atelier de gravure en médaille en 1900, est nommé professeur-adjoint de gravure sur bois et cuivre en 1905, et est titularisé en mars 1909. En 1890, on comptait 600 élèves en section Arts Industriels, en 1906, on en comptait 900. Appui de Jean-Paul Laurens comme directeur de l’École (depuis Paris) de 1893 jusqu’en 1902, relayé sur place par Joseph Galinier (sous-directeur en 1893, puis directeur en 1906), puis Henri Rachou (1906-1933), avec l’appui d’Honoré Serres, maire de 1893 à 1905, qui développe artisanat et commerce. Plein accord avec la politique artistique locale liée au développement de l’industrie et du commerce local. 1914 : affirmation de cette option de l’École : fondation d’un atelier de gravure industrielle, et d’un atelier en gravure industrielle et arts appliqués jusqu’en 1921. Insistance sur cette pratique et sa pédagogie : il rédige une proposition d’enseignement : les élèves suivraient 4 années d’études « normales » c’est-à-dire 2 heures de cours par jour, accompagnés de travaux pratiques très longs le reste de la journée. Mais cette formation rencontre des limites : regrettant l’impossibilité d’obtenir un « coin » définitif avec le matériel de l’École faute de moyens financiers, il propose de baser son enseignement sur l’étude de certains bas-reliefs et de médailles de l’Antiquité et de la Renaissance ainsi que de certains maîtres contemporains : pour lui, l’étude et l’interprétation des figures d’antiques ou de modèle vivant sont des préalables indispensables à l’enseignement dans une école d’art et des sciences industrielles. Il relie le travail de médaille au travail du sculpteur, car à ses yeux la pratique du modelage et du bas-relief sont seuls capables de déboucher sur une gravure de qualité. Exemple d’équilibre entre la pratique artistique et la pratique industrielle, qui sera poursuivi par les enseignants suivants. Il meurt le 25 décembre 1933. Dernier descendant d’une lignée de graveurs. Ses engagements en dehors de l’École : Officier d’infanterie de réserve pendant plusieurs années. 1886 : Il figure parmi les membres fondateurs de l’Union artistique de Toulouse lors d’une de ses expositions. 17 janvier 1914 : il figure parmi les membres d’honneur pour la création d’un monument en l’honneur de Falguière, en compagnie d’autres ex-élèves soutenus par le maître à Paris à partir de 1882, et qui ont mené de brillantes carrières. Bibliographie : ISDAT, fonds ancien, dossier n° 160.
Maurice Scellès demande à notre consœur en quelle année Jules, fils de Jean Ganot, est devenu professeur. Celle-ci répond qu’il a fréquenté l’atelier de Falguière, qu’il est ensuite resté un an à Paris, avant de revenir à Toulouse pour faire de la gravure industrielle. Il occupe un poste de professeur à partir de 1905 et obtient sa titularisation en 1909. Maurice Scellès remercie notre consœur d’avoir découvert la clé de l’énigme posée par notre médaille car les numismates venus enquêter à la Société sur son histoire n’ont trouvé que le nom de Berdaulat, orfèvre de son métier. Louis Peyrusse ajoute que Berdaulat a acheté le modèle de la médaille à Ganot ; c’est la raison pour laquelle on retrouve son nom gravé sur l’avers aux côté des initiales de Jean Ganot. La double signature s’explique donc, reprend Maurice Scellès, Berdaulat étant l’éditeur. Guy Ahlsell de Toulza nous apprend que l’atelier de Berdaulat se trouvait au rez-de-chaussée de l’immeuble où il habite et qu’il y a retrouvé, à l’occasion de travaux de rénovation de ce niveau, de nombreux objets dont deux plaques de cuivre. Il a par ailleurs laissé son monogramme sur une porte du XVIIe siècle.
Daniel Cazes nous livre une dernière information concernant le palais de Via à Cahors, qui faisait, jusqu’à il y a peu de temps, l’objet d’un projet de réhabilitation. La Ville désirerait se porter acquéreuse, souhaitant que le bâtiment soit ouvert à la population et à l’hébergement, et elle a fait un appel à projet dans ce sens. Le palais ayant servi de prison, la DRAC a donné son accord pour opérer des démolitions des parties datant des XIXe et XXe siècles. Maurice Scellès propose d’adresser une lettre de félicitations et d’encouragements au maire de Cahors ; une médaille pourra lui être remise lorsque le projet sera affiné.

Séance du 02 avril 2019 (séance privée)
Communication courte de Bruno Tollon : « La table d’attente ».
Lire le compte-rendu
L’expression m’est apparue dans un marché passé devant notaire en janvier 1574 et n’a cessé de m’intriguer. Elle est présente chez Serlio comme chez Philibert Delorme. L’étude va porter sur les variations auxquelles elle a donné lieu. L’usage, attesté très tôt à Toulouse, a marqué toute la production architecturale du temps, dont celle de Dominique Bachelier. De quoi susciter quelques réflexions sur l’intérêt de cette pratique.


Communication courte de Jean Catalo : « La question de la faïence de Montauban sur le site archéologique 8 Allées Empereur ». ».
La région montalbanaise a connu un développement spectaculaire des faïenceries à la fin du XVIIIe siècle : à Montauban, Ardus ou Nègrepelisse… Les travaux de l’érudit Edouard Forestié, en 1876, sur ces manufactures servent encore de références pour les collectionneurs et les musées. Cependant, l’identification des produits de ces faïenceries reste très aléatoire. L’archéologie, jusqu’ici, n’avait pas non plus livré d’éléments de comparaisons, ou des données susceptibles d’illustrer cette activité des manufactures montalbanaises. En 2016, la fouille préventive du site aux 8 Allées Empereur à Montauban, dirigée par Laurent Grimbert (Inrap), a été l’occasion d’aborder cette question par la découverte d’ensembles de céramiques d’époque moderne. Il s’agit de deux lots de poteries totalisant 2560 fragments. Leur examen a permis de rappeler, une nouvelle fois, l’intérêt de la confrontation entre sources documentaires et vestiges archéologiques.
L’archéologie, jusqu’ici, n’avait pas non plus livré d’éléments de comparaisons, ou des données susceptibles d’illustrer cette activité des manufactures montalbanaises. En 2016, la fouille préventive du site aux 8 Allées Empereur à Montauban, dirigée par Laurent Grimbert (Inrap), a été l’occasion d’aborder cette question par la découverte d’ensembles de céramiques d’époque moderne. Il s’agit de deux lots de poteries totalisant 2560 fragments. Leur examen a permis de rappeler, une nouvelle fois, l’intérêt de la confrontation entre sources documentaires et vestiges archéologiques.
Présents : Mmes Nadal, Présidente, Sénard, Directrice, MM. Ahlsell de Toulza, Trésorier, Cabau, Secrétaire général, Mme Napoléone, Secrétaire-adjointe, M. Péligry, Bibliothécaire-archiviste ; Mmes Bessis, Haruna-Czaplicki ; MM. Catalo, Cazes, Peyrusse, Scellès, Surmonne, Tollon, membres titulaires ; Mme Bossoutrot-Rebière, MM. Penent, Rebière, Suzzoni, membres correspondants.
Excusés : Mmes Cazes, Czerniak, Galés et Queixalós ; MM. Garland, Garrigou Grandchamp, Julien et Marquebielle.
La Présidente ouvre la séance et commence par faire état de la correspondance reçue par la Société.
C’est d’abord une lettre de M. François Baratte, professeur émérite à la Sorbonne, l’un des relecteurs de nos Mémoires, qui nous félicite pour la qualité du dernier volume paru (tome 76) et nous fait part de son adhésion au projet de la S.A.M.F. pour le réaménagement de la place Saint-Sernin.
C’est ensuite un courrier de M. Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, qui sollicite notre avis au sujet de l’abattage de deux arbres et de trois arbustes situés au chevet de la basilique Saint-Sernin.
Daniel Cazes intervient pour rappeler que divers arbres anciens ou d’intérêt botanique ont déjà disparu pendant les travaux et que notre Société a déjà indiqué la solution, d’ailleurs préconisée par plusieurs architectes en chef des Monuments Historiques, au problème que pose l’humidité des murs de la basilique : il s’agit de créer un drain au pied des maçonneries ; mais cela imposerait de faire des fouilles, ce dont la municipalité ne veut pas.
La Présidente fait circuler le petit catalogue, procuré par Louis Peyrusse, des titres publiés par les Éditions midi-pyrénéennes dans la collection « Cette année-là à Toulouse », puis elle présente cinq ouvrages offerts à notre bibliothèque par des membres de la Société :![]() dons de Maurice Scellès : Paul Ourliac, Les Pays de Garonne vers l’an Mil ; Livre des miracles de Saint-Gilles (texte et traduction) ; Edmond Albe et Jean Rocacher, Les miracles de Notre-Dame de Rocamadour ;
dons de Maurice Scellès : Paul Ourliac, Les Pays de Garonne vers l’an Mil ; Livre des miracles de Saint-Gilles (texte et traduction) ; Edmond Albe et Jean Rocacher, Les miracles de Notre-Dame de Rocamadour ;![]() don d’Émilie Nadal : Les cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa, tome XLIX (2018), Les grandes abbayes et l’art roman ;
don d’Émilie Nadal : Les cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa, tome XLIX (2018), Les grandes abbayes et l’art roman ;![]() don d’Hiromi Haruna-Czaplicki : Le bréviaire d’amour (Matfre Ermengaud de Béziers), traduction française d’Henri Barthès, 2018.
don d’Hiromi Haruna-Czaplicki : Le bréviaire d’amour (Matfre Ermengaud de Béziers), traduction française d’Henri Barthès, 2018.
Émilie Nadal donne ensuite la parole à Jean Catalo pour une communication courte : La question de la faïence de Montauban sur un site archéologique.
La Présidente remercie notre confrère pour cette présentation intéressante et demande si cette fosse dépotoir est celle d’une maison particulière et pourquoi, lorsqu’un objet est cassé, on ne retrouve pas tous les morceaux. Il est difficile de dire si une fosse correspond aux rejets d’une famille en particulier, répond Jean Catalo, et les objets cassés peuvent avoir une seconde vie, être réparés ou servir à autre chose.
Louis Peyrusse note que le site se situe hors les murs et demande au conférencier si la céramique donne une indication sur le niveau social des habitants de ce quartier. Cette zone se trouve dans un faubourg qui borde directement le centre, répond Jean Catalo ; c’est un quartier à la mode et en pleine expansion : il ne faut donc pas s’attendre forcément à y trouver des gens pauvres. De plus, précise-t-il, on a découvert des morceaux de faïence de très bonne qualité, mais en très petite quantité. La faïence décorée est certainement celle que l’on montre sur les vaisseliers, mais on ne l’utilise pas, ce qui statistiquement l’expose moins à la casse. Enfin, à cette époque, les faïenceries locales déclinent, car elles ne peuvent plus faire face à la concurrence des grands centres.
Maurice Scellès rappelle qu’Édouard Forestié avait récupéré un certain nombre d’objets dans une fabrique abandonnée. Avait-il également récolté des pièces ? Oui, répond Jean Catalo, mais il les avait attribuées à des fabriques extérieures. Et notre confrère de reprendre : Doit-on conclure qu’Édouard Forestié avait « inventé » une faïencerie montalbanaise ? L’identification des faïenceries reste très difficile répond le conférencier ; elle paraît plus aisée quand les pièces sont décorées, bien qu’il y ait de nombreuses copies. Qu’en est-il de la récolte de ce type de faïence dans les autres sites fouillés à Montauban demande enfin Maurice Scellès ? Il n’y a pas eu beaucoup de fouilles ni de récolte (deux morceaux uniquement), bien qu’on y fasse attention aujourd’hui, répond Jean Catalo, qui conclut en signalant qu’il n’y a pas de faïence montalbanaise au Musée Paul-Dupuy.
Guy Ahlsell de Toulza est étonné de cette représentation restreinte de la faïence et se demande où elle est passée. Le conférencier répond que le marché de la faïence est limité et qu’il faut considérer cette vaisselle comme exceptionnelle. Il prend l’exemple des pots à pharmacie, dont on ne trouve aucun fragment en fouille.
Jean-Louis Rebière demande enfin si des carreaux vernissés ont été trouvés. Jean Catalo répond que des vestiges ont en effet été récoltés, mais qu’il s’agit de productions de Martres-Tolosane.
Émilie Nadal donne enfin la parole à Bruno Tollon pour une seconde communication courte : La table d’attente de la Renaissance .
La Présidente remercie notre confrère pour cet exposé et demande ce qui était représenté sur ces tables. Il pouvait y avoir plusieurs choses répond Bruno Tollon : des invocations, des dates, des écus ou des citations bibliques.
Dans le cadre des questions diverses, la parole est à Anne Bossoutrot-Rebière pour une présentation des restaurations des peintures du bras nord du transept de la basilique Saint-Sernin, présentation qui vise à apporter des réponses précises aux questions posées par Virginie Czerniak lors de la séance précédente.
La peinture du bras nord du transept de la basilique Saint-Sernin de Toulouse :
une restauration raisonnée
La restauration des peintures murales du bras nord du transept s’est inscrite dans un projet plus important traitant du massif occidental, tant ses salles intérieures que ses élévations et toitures, la façade nord de la basilique et l’assainissement de deux chapelles des cryptes.
La restauration des peintures du bras nord du transept, première opération de ce programme, fut engagée en juillet 2018 pour s’achever en février 2019. Ce chantier a fait suite à un important diagnostic qui nous avait été commandé par la Ville de Toulouse, soutenue par la conservation régionale des Monuments Historiques. Ces dernières souhaitaient en effet, en ce qui concerne la peinture murale, assurer sa bonne conservation, et la rendre plus lisible par le public, puisqu’une lente opacification de la peinture en altérait l’observation.
Les conditions de la commande et les objectifs
C’est donc en 2016 qu’un diagnostic fut entrepris par une équipe pluridisciplinaire qui comprenait, outre les deux architectes auteurs de cet article, le bureau d’investigations archéologiques Hadès, B.M.I. (Brizot-Masse Ingéniérie) bureau d’études structures, Anne Liégey, restauratrice de sculptures, Marie-Lys de Castelbajac, conservateur-restaurateur de peintures murales accompagnée du LERM (Laboratoire Etudes Recherche Matériaux) pour les analyses de peintures en laboratoire, et enfin Laurent Taillandier, économiste de la construction.
Un comité scientifique et technique fut mis en place dès le début de cette étude, qui en a suivi le parcours et les investigations ainsi que tous les développements. Le comité scientifique réuni par la Ville de Toulouse et était constitué d’Olivier Poisson, inspecteur général des Patrimoines, de Marie-Anne Sire, inspectrice générale des Monuments Historiques, de Marie-Suzanne de Ponthaud, inspectrice générale des Monuments Historiques, de représentants de la DRAC (Laurent Barrenechea, conservateur régional des Monuments Historiques, Catherine Gaich, conservatrice des Monuments Historiques), de représentants des services d’architecture et d’urbanisme de la Ville, des conservateurs des musées de la Ville (Axel Hemery, Charlotte Riou, Evelyne Ugaglia puis Laure Barthet, Marie Bonnabel), de la responsable de l’atelier de restauration des musées (Sophie Reynard-Dubis) et du Père Gallois. Ont également participé à ce comité scientifique, Andreas Hartmann-Virnich, professeur d’Histoire de l’Art et d’Archéologie du Moyen Âge à l’Université Aix-Marseille, ainsi que Jean Deilhes, historien de l’Art.
En ce qui concerne la peinture murale du bras nord du transept, l’objectif de ce diagnostic et du projet de restauration était double : d’une part assurer à ces peintures de bonnes conditions de conservation, et d’autre part en améliorer la lecture. En effet, il avait été constaté depuis quelque temps déjà une lente opacification des peintures, qui se recouvraient d’un léger voile blanc.
L’étude des peintures murales et de leur opacification
Notre étude de diagnostic a permis, à l’issue d’un constat d’état de conservation des peintures, de comprendre que le fixatif employé par Pierre Bellin lors de la découverte de cette œuvre peinte en 1973, était à l’origine de l’apparition de ce voile. Des investigations physico-chimiques ont été entreprises pour déterminer quel était ce produit. Nous n’avons pu le définir, sa composition ne répondant à aucun fixatif répertorié aujourd’hui. De plus, les archives que nous avons consultées ne nous ont pas livré de rapport de restauration émanant de Pierre Bellin. Les dossiers d’Yves Boiret, architecte en chef des Monuments Historiques qui avait alors en charge la basilique, ne comportaient qu’un dossier plus tardif relatif aux peintures du chœur.
Il a également été mis en évidence que ce fixatif avait été appliqué sur une peinture qui n’avait pas été nettoyée ni totalement mise au jour. Ainsi, poussière, dépôts des enduits et restes de badigeon avaient- ils été emprisonnés dans ce traitement de surface, contribuant à estomper la lisibilité de la peinture. Une très présente intervention de mise au ton fut alors menée sur les enduits de rebouchage et les solins.
Dans le cadre de notre diagnostic des essais d’allègement du fixatif, de nettoyage, de dérestauration, de réintégration picturale ont été réalisés et présentés au comité scientifique.
À l’issue de ces études, nous avons pu, sur la base des résultats acquis, définir un protocole de restauration et des objectifs de présentation validés par l’ensemble des parties.
Il est enfin apparu que l’état de conservation des peintures variait considérablement suivant les zones observées.
La restauration et la déontologie d’intervention
La restauration des peintures murales du bras nord du transept visait donc un triple objectif, d’une part la conservation (faire cesser le progression du blanchiment auquel nous assistions), d’autre part la mise au jour de l’entièreté de l’œuvre et enfin la restitution de la lisibilité de ce remarquable programme théologique et iconographique, sans jamais trahir l’œuvre romane primitive. L’intervention a donc été complexe pour mener à bien cette restauration qui a conjugué conservation, dérestauration et finition d’une restauration entamée il y a quarante-cinq ans pour transmettre cet ensemble pictural exceptionnel.
Pour cela, les opérations mises en œuvre ont été les suivantes : tout d’abord, un dépoussiérage à la brosse douce, suivi d’un allègement du fixatif et d’une opération de nettoyage. Les restes d’enduit et de badigeon ont été ôtés au bistouri sous loupe binoculaire. Les peintures ainsi dégagées montraient un grand nombre de lacunes ainsi que des zones extrêmement usées.
Un long et délicat travail de réflexion, au cas par cas, sur la surface picturale, a permis de déterminer les nécessités ponctuelles d’intervention pour permettre une lecture qui ne soit pas entravée par des heurts trop importants. Lorsque nous avions des lacunes sur toute l’épaisseur de l’enduit, laissant apparaître à vif la maçonnerie du support, ce qui constituait un véritable accident dans la peinture, il a été considéré comme nécessaire d’atténuer cette présence. Ainsi avons-nous procédé au comblement des grandes lacunes. Cette intervention a été réalisée de façon à remettre ces lacunes en très léger déport de la surface picturale. L’enduit appliqué a été maintenu apparent, de teintes neutres pour rétablir une continuité de lecture.
Les nombreuses petites lacunes dues au piquage de l’enduit avaient été reprises en 1974 par Pierre Bellin à l’enduit de chaux et de sable sans chercher une parfaite remise à niveau du support. Ils ont été conservés en l’état. Des ajustements ont été faits au droit des solins trop larges et débordants.
Ces multiples piquages réalisés pour l’accroche du nouveau corps d’enduit destiné à masquer la peinture murale, ont été atténués et réaccordés en ton local.
Des réintégrations chromatiques ont également été effectuées, permettant de ne pas avoir l’œil arrêté par des accidents de lisibilité et d’harmoniser les passages entre l’œuvre originelle et les mutilations de la peinture murale, tout en maintenant discernables nos interventions à l’examen rapproché. Ces réintégrations ont été réalisées en glacis d’aquarelle.
L’objectif final de cette restauration était de donner une lecture évidente et apaisée de la peinture, et d’estomper ce qui pouvait embrouiller visuellement l’œuvre peinte. Le travail des restaurateurs a été minutieusement conduit, pas à pas, s’interrogeant sur la pertinence de chaque geste afin de présenter la peinture originelle dans sa totale intégrité.
Le déroulement du chantier
Le chantier a duré sept mois, les échafaudages ayant été déposés à la fin du mois de février. La restauration a été réalisée par l’Atelier 32 et par Marie-Lys de Castelbajac.
Les travaux ont été entrepris en procédant de haut en bas suivant les différentes phases techniques. La voûte a donc été traitée dans un premier temps, les intrados des quatre arcs ensuite, puis les différents registres peints du mur, du tympan jusqu’au sol.
Quelques secteurs ont été l’objet d’une réflexion tout à fait particulière. Ainsi en a-t-il été de l’agneau pascal. La présence très marquée d’un repentir de sinopia (dessin préparatoire) formant par un important arc de cercle brun brochant sur l’arc-en-ciel, a amené l’ensemble du comité scientifique et des restaurateurs à s’interroger sur son plein maintien à la vue. En effet, maintenir ce repentir risquant de perturber la lecture de l’œuvre peinte, puisque le peintre de l’époque romane avait soigneusement recouvert ce repentir, que l’usure a fait réapparaître. Il a été décidé par l’ensemble du comité scientifique de recouvrir d’un voile d’aquarelle ce tracé primitif dans un ton d’accompagnement de la peinture, afin de respecter le geste de l’auteur de cette œuvre qui avait masqué ce premier tracé erroné. Ainsi, à vision rapprochée ou bien en prêtant une attention particulière à distance, le repentir reste visible, bien qu’ayant été estompé.
Le grand raffinement iconographique qui avait été conçu pour figurer l’agneau pascal pâtissait de la présence de ce premier tracé. Son atténuation permet de mieux appréhender le contenu théologique élaboré de ce symbole christique.
Les traitements de nettoyage seuls ont parfois amené à une spectaculaire mise en évidence de certains éléments de la composition. Nous avons dit plus haut en effet, d’une part que les niveaux d’usure étaient très variables d’une zone à l’autre, et d’autre part que le fixatif mis en œuvre par Pierre Bellin avait emprisonné des dépôts divers. C’est ainsi que le simple nettoyage de la figure de saint Jean-Baptiste et de son vêtement a révélé la très grande subtilité graphique et colorée de cette figure, qui nous est parvenue particulièrement bien conservée. Aucune retouche n’a été apportée sur cette figure, excepté la réintégration en ton local des lacunes de piquetage.
En conclusion
Nous avons privilégié dans la restauration qui a été conduite de façon collégiale la maîtrise de la composition du peintre de l’époque romane plutôt que de mettre en évidence ses premières hésitations ou bien les altérations qui pouvaient gêner la lecture de son œuvre. Notre intervention, très mesurée, a mis en valeur les parties qui ont été très bien conservées, les faisant ressortir au détriment des parties plus usées. Ceci constitue la vérité de l’œuvre, car nous ne sommes, en effet, en aucun cas intervenus sur les zones plus usées, dans un total respect de la composition telle qu’elle nous est parvenue. Il est prévu, maintenant que cette peinture a été restaurée, l’étude d’un éclairage adapté qui permettra, de façon sensible et mesurée, de mettre en valeur cette remarquable peinture romane du début du XIIe siècle.
Jean-Louis Rebière, architecte en chef des Monuments Historiques,
et Anne Bossoutrot, architecte du Patrimoine.
Émilie Nadal remercie notre consœur et regrette que les restaurations aient masqué le repentir dans le dessin de l’agneau figuré au centre de la voûte. Mme Bossoutrot-Rebière répond que ce choix a été fait par le comité scientifique en fonction des tendances actuelles sur la restauration des peintures murales. Maurice Scellès s’étonne que des années de réflexion aient amené au choix de masquer ce repeint et regrette que le comité n’ait pas intégré de spécialistes internationaux. Notre consœur répond que la DRAC et la Mairie ont constitué ce comité, et que le contrat était de rendre ces peintures lisibles : ce contrat est donc rempli. Jean-Louis Rebière ajoute que ce repentir était apparu en 1973 parce que le décapage « énergique » des maçonneries avait fait disparaître la couche picturale supérieure de l’enduit. Il a donc été décidé de redonner la qualité initiale du message.

Séance du 19 mars 2019 (séance privée)
Communication courte de Magali Vène & Thomas Falmagne, « Naissance d’un fonds : plus de 400 nouveaux fragments manuscrits identifiés à la Bibliothèque municipale de Toulouse » .
Lire le compte-rendu
Le recensement des fragments à la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine de Toulouse a été mené en deux phases différentes, dans les reliures de manuscrits et d’incunables d’une part et dans les reliures d’ouvrages imprimés du XVIe siècle de l’autre.
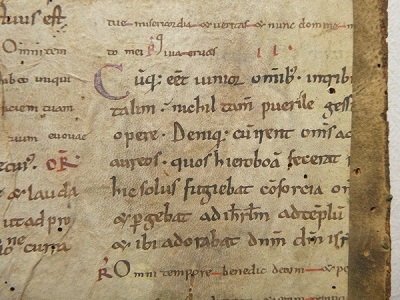
Plus de 400 unités codicologiques différentes ont pu être ainsi isolées à ce jour et réparties selon la provenance des livres-hôtes. Je propose, après avoir exposé la démarche, de présenter les grandes catégories de sources concernées par les fragments, puis de montrer, qu’à côté du cas des Dominicains qui a fait l’objet d’une publication particulière, il existe d’autres fonds qui concentrent à certaines périodes plusieurs manuscrits démembrés, principalement les Augustins et les Franciscains. Je dirai ensuite un mot de la documentation restante qui a sans doute davantage à voir avec les manuscrits dépecés dans les cercles des imprimeurs-relieurs qu’avec l’histoire des bibliothèques toulousaines.
Communication courte d’Émilie Nadal : « La bibliothèque des dominicains de Toulouse : catalogue des imprimés conservés ».
En plus des 126 manuscrits provenant de la bibliothèque des dominicains de Toulouse, il a été possible de repérer dans le fond de la Bibliothèque municipale plus de 1100 titres imprimés entre 1470 et 1783, ayant également appartenu aux dominicains.
 Usages des livres, dominicains bibliophiles, marques de propriété diverses, recette de tisanes… cette collection, bien que partielle, donne un aperçu remarquable sur la vie du couvent et sur les usages du livre au fil des siècles .
Usages des livres, dominicains bibliophiles, marques de propriété diverses, recette de tisanes… cette collection, bien que partielle, donne un aperçu remarquable sur la vie du couvent et sur les usages du livre au fil des siècles .
légende illustration Nadal : Quelques imprimés de la bibliothèque des dominicains de Toulouse, avec leur étiquette caractéristique.
Présents : Mme Nadal, Présidente, MM. Ahlsell de Toulza, Trésorier, Cabau, Secrétaire général, Mme Napoléone, Secrétaire-adjointe, M. Péligry, Bibliothécaire-archiviste ; Mmes Andrieu, Bessis, Czerniak, Fournié, Haruna-Czaplicki, Jaoul, Pradalier-Schlumberger, MM. Cazes, Garland, Garrigou Grandchamp, Peyrusse, Sournia, Stouffs, Surmonne, Testard, membres titulaires ; MM. Marquebielle, Mattalia, Penent, Rigault, Suzzoni, membres correspondants.
Excusés : Mmes Balty, Cazes, Sénard et Vène, MM. Balty, Scellès et Tollon.
Invités : M. Thomas Falmagne (Bibliothèque Nationale du Luxembourg), Mme Imma Lorès (professeur à l’Université de Lérida).
La Présidente donne la parole à Louis Peyrusse pour la lecture d’un texte en hommage à Jacques Bousquet, membre libre de notre Société, décédé il y a quinze jours :
Jacques Bousquet (1923-2019)
Le 26 février dernier, on annonçait à Rodez la mort de notre confrère Jacques Bousquet dans sa 96e année. Le Rouergue perd un de ses enfants les plus attachés à leur province natale. Né en 1923, il fait ses études à Rodez et à Toulouse avant d’intégrer l’École des chartes et de suivre en parallèle l’enseignement de l’École du Louvre. Sorti premier de sa promotion, il passe trois ans au palais Farnèse à l’École française de Rome (1948-1950). Il soutient à son retour devant l’École du Louvre une thèse très neuve : Recherches sur le séjour des peintres français à Rome au XVIIe siècle, qui est toujours utilisée. L’auteur, partant des stati d’anime des fonds de l’Académie de Saint-Luc, de Saint-Louis des Français, documente les artistes, travail qui retentit sur l’histoire sociale et la connaissance précise des carrières.
De retour à Rodez, il devient archiviste en chef et le reste jusqu’en 1967. Il installe un musée pédagogique des archives pour lequel il rédige un guide copieux de 324 pages. Grâce à l’entregent de Jean Alazard, doyen de la Faculté des Lettres et conservateur du Musée des Beaux-arts d’Alger, il est nommé à titre bénévole conservateur du Musée Denys Puech, fait affecter à Rodez des œuvres de la Récupération artistique et développe, autant que faire se peut, le fonds régional, mais pas seulement. Jean Alazard, qui sollicite des dons pour le Musée d’Alger, se fait accompagner dans les ateliers d’artistes par Jacques Bousquet qui, à son tour, en sollicite pour Rodez.
Même si le musée dépourvu de tout moyen vivotait, Jacques Bousquet reçut comme une gifle la transformation de l’établissement en musée d’art contemporain sans qu’on daigne l’en prévenir ni lui adresser une lettre de remerciement pour le travail accompli.
Son travail d’archiviste à Rodez a été très abondant. On peut en juger par les articles donnés à la Revue du Rouergue dirigée par Pierre Carrère. On peut y lire les prémices d’une étude sur la sculpture entre Rouergue et Albigeois au XVe siècle.
Mais Jacques Bousquet n’est pas un érudit confiné dans son dépôt d’archives. Son goût très vif pour l’art lui fait organiser des expositions, même dans des lieux inattendus, comme en 1961 dans la Foire-Exposition du pays rouergat : un pavillon des arts accueillait 162 œuvres de 59 artistes rouergats et autres, allant de l’art traditionnel à l’abstraction sage (sans Soulages).
Dans l’hôtel des archives naissent trois ouvrages. Une publication de textes, dans la tradition chartiste, Enquête sur les commodités du Rouergue en 1552 (Privat, 1969). Un montage savant de textes, tirés d’un procès pour la fixation de l’impôt dû par la province, occupe 113 pages contre 127 pages d’« introduction » qui constitue en fait un vigoureux plaidoyer pour la reconnaissance d’un pays ouvert, non enclavé.
Jacques Bousquet utilise la dialectique savante entre texte et note infra-paginale, note dans laquelle s’avance parfois l’idée essentielle. Viennent ensuite deux thèses d’État sous la direction de Marcel Durliat, soutenues à Toulouse en 1972 : La sculpture à Conques au XIIe siècle, un millier de pages et la thèse complémentaire, qui n’était plus obligatoire, Le Rouergue aux XIe et XIIe siècles. Les pouvoirs, leurs rapports, leurs domaines. Pour l’auteur, cette dernière étude devait servir l’histoire de l’art : la montagne avait connu un âge d’or avec de vastes troupeaux, elle était animée de courants d’échanges, conditions favorables à la création artistique. La thèse principale, très polémique envers les datations de son directeur, remontait fortement la chronologie des ateliers de Conques, remettant l’abbaye en accord temporel avec les grands centres créateurs. Parenthèse : la thèse fut très mal reçue, mais je constate que dans la monographie publiée par le Congrès archéologique de l’Aveyron en 2009, Henri Pradalier et Eliane Vergnolle ne sont plus très loin des dates de Jacques Bousquet, pas plus que notre lauréat de 2019, M. Lei Huang.
Jacques Bousquet est nommé en 1967 chargé d’enseignement, puis professeur d’histoire de l’art médiéval à l’Université de Montpellier. Il y arrive avec les turbulences de mai 1968 et la difficulté d’un métier nouveau alors qu’est déjà installé à l’université Paul-Valéry un médiéviste reconnu, Robert Saint-Jean. Bousquet y enseigne durant vingt ans jusqu’en 1986, donnant beaucoup d’études (surtout des thématiques formelles) aux Journées romanes de Saint-Michel de Cuxa, sans déserter pour autant l’érudition rouergate, une trentaine de communications à la Société des lettres, sciences et arts de l’Aveyron. Depuis la maison de retraite ruthénoise, il écrivit à 89 ans pour un site électronique Artifex in opere une réflexion sur sa surprenante carrière.
Jacques Bousquet fut un grand savant, passionné par l’archive, rouergate ou romaine, passionné par le Rouergue dont il regrettait qu’il ne fût pas apprécié à sa juste place, la première. Chaleureux, volubile, il s’intéressait à tous les domaines, de la préhistoire aux caravagesques, des sculpteurs romans et gothiques à Denys Puech, au graveur Viala ou aux tableaux du XIXe siècle envoyés à la cathédrale de Rodez. Regrettons qu’il ait été trahi par l’édition. La thèse de l’École du Louvre déposée dans deux bibliothèques en 1951, utilisée par tous les chercheurs internationaux, n’a été imprimée qu’en 1970, grâce à des amis réunis dans une association ad hoc. L’étude sur Conques, photocopiée par l’Atelier des thèses de Lille III, fut condamnée à une diffusion confidentielle. Le Rouergue aux XIe et XIIe siècles fut édité dans les « Archives historiques du Rouergue » en 1992-1994 par la vaillante Société des lettres, sciences et arts de l’Aveyron. Vingt ans après.
Aujourd’hui, avec la diffusion des textes par l’internet, le rayonnement de Jacques Bouquet aurait été sans doute plus grand, et toujours mérité.
Émilie Nadal présente ensuite un dépliant publié par la mairie de Cahors sur les chantiers archéologiques menés dans la ville en 2018, que l’auteur, notre consœur Anaïs Charrier, donne à la bibliothèque de la Société.
Au titre des courriers reçus, elle nous signale la tenue d’un colloque sur le monachisme féminin qui se tiendra les 4 et 5 avril prochains à la Bibliothèque des études méridionales, rue du Taur. Elle nous donne également lecture d’un courrier qui nous a été enfin adressé par le Président de l’Académie des Arts et des Sciences de Carcassonne, confirmant que le logo de leur Société a bien été changé, mettant ainsi fin au contentieux qui nous opposait. Elle donne enfin la parole à la Secrétaire-adjointe pour la lecture du procès-verbal de la dernière séance, qui est adopté.
La Présidente introduit la première communication courte du jour, Naissance d’un fonds : plus de quatre cents nouveaux fragments manuscrits identifiés à la B.E.P. de Toulouse, en lisant le texte de présentation de Magali Vène, malheureusement empêchée ce soir, puis elle donne la parole à Thomas Falmagne.
Elle remercie le conférencier pour son exposé passionnant, témoignant d’un travail spectaculaire. Guy Ahlsell de Toulza s’étonne de voir que trois mots suffisent à reconnaître un texte. Thomas Falmagne répond que de nombreuses bases de données sont désormais disponibles, permettant très souvent de retrouver la source textuelle. Les textes les plus difficiles à reconnaître sont les écrits juridiques et médicaux, mais au moins est-il possible de savoir de quoi ils traitent. On peut effectuer une analyse fine ou globale, poursuit-il, passer plus ou moins de temps, mais le type de texte peut être facilement défini car la typologie est assez simple.
Dans un ensemble de manuscrits comme celui de Toulouse, il reste environ dix pour cent de fragments non exploitables. Louis Peyrusse remarque les comparaisons effectuées par le conférencier entre les fonds de Toulouse et du Luxembourg et demande si ce type de travail a été fait ailleurs. Thomas Falmagne dit avoir effectué ce type de recherche aux archives de Trèves, de Bar-le-Duc, sur l’ensemble des sources cisterciennes de Clairvaux et sur celles conservées à Troyes. Il mentionne également des entités provenant de différentes bibliothèques municipales, à Paris, ainsi que les sources de Cadouin et de Périgueux. Il note la raréfaction dans le sud de la France des registres susceptibles d’avoir réutilisé des manuscrits. Il précise enfin que les reliures sont rarement défaites et que les analyses sont faites sur les ouvrages tels qu’ils sont.
La Présidente, Emilie Nadal, enchaîne sur une communication courte dont elle est l’auteur : La bibliothèque des Dominicains de Toulouse. Catalogue des imprimés conservés. .
Thomas Falmagne relève quelques particularités du catalogue Laqueille, divisé en deux parties : celle de droite n’a de rayons que de A à D, et celle de gauche, jusqu’à S uniquement. Il propose de vérifier si les livres enchaînés sont les seuls à figurer dans le catalogue, car il lui paraît étonnant de constater l’absence de certains ouvrages dans cette liste.
Au titre des questions diverses Hiromi Haruna-Czaplicki nous présente La bible enluminée en quatre volumes de Moissac , inconnue, conservée à la BNF de Paris : manuscrit latin 37, fin XIIIe-début XIVe s.
Émilie Nadal remercie notre consœur et, devant les nombreuses pistes que présente ce document, estime qu’elle aurait matière à faire une communication longue suivi d’un article intéressant. Thomas Falmagne s’étonne que la conférencière limite son corpus aux bibles et demande si les artistes n’ont pas pu intervenir sur d’autres types de manuscrits. Hiromi Haruna-Czaplicki répond que ce choix facilite l’étude stylistique.
Une seconde intervention a été sollicitée par notre consœur Virginie Czerniak au sujet des restaurations effectuées sur les peintures murales du croisillon nord du transept de Saint-Sernin et récemment achevées : Les peintures romanes de Saint-Sernin de Toulouse : une restauration qui laisse perplexe.
La restauration d’une œuvre d’art, qu’elle soit mobilière ou monumentale, ancienne ou contemporaine, ne doit jamais être considérée comme une opération anodine.
Toucher une œuvre, intervenir sur sa matérialité, c’est toujours prendre le risque de la dénaturer, de trahir la création initiale. Il conviendrait donc, dans une sorte d’absolu idéal, de le faire toujours avec la plus stricte prudence et en mobilisant toutes les compétences requises (restaurateur, historien de l’art, architecte et techniciens des matériaux et de l’environnement) dans le respect de l’œuvre telle qu’elle nous a été léguée, marquée par les altérations du temps et d’éventuels accidents. Un professionnel de la restauration compétent devrait dresser son protocole d’intervention après consultation de ces multiples forces vives et de leurs connaissances spécifiques, en s’interrogeant sur le bienfondé de son action, car une restauration peut ne pas se révéler forcément nécessaire. La pertinence des regards croisés est l’unique garantie d’une opération respectueuse de l’intégrité de l’œuvre que l’on se doit de pérenniser en veillant à réfléchir puis à appliquer des mesures de conservation destinées à prévenir d’éventuelles dégradations ultérieures. Une restauration peut viser l’embellissement, mais elle doit aussi s’appliquer à la conservation.
Il nous revient malheureusement de constater que la restauration des peintures du croisillon nord du transept de la basilique Saint-Sernin qui vient de s’achever (les échafaudages ont été démontés vers le 15 février) ne répond en rien à ce cahier des charges utopique. La collégialité ne fut pas de mise, alors même que deux historiennes de l’art, une suisse et une française, travaillent sur ces peintures [1]. On ne peut que le déplorer car leur expertise aurait évité la perte d’un témoignage exceptionnel du travail du peintre des années 1120-1130, un magnifique repentir, c’est-à-dire une erreur du peintre corrigée par ses soins, témoignage ô combien émouvant du geste créatif et de la dimension empirique de la création picturale en ce début du XIIe siècle. Il est tout aussi regrettable que l’on ait gâché l’équilibre général de la composition peinte en soulignant de manière outrancière – sur quels critères ? Nul ne le sait – certaines parties des figures au détriment de l’ensemble. Par ailleurs, il ne nous est pas donné de savoir si l’on s’est interrogé sur les causes des altérations et les conditions de conservation actuelles.
Nous restons donc perplexes devant le déroulement de cette opération et ses résultats. La conservatrice du Musée Saint-Raymond expliquait que cette intervention n’avait pas pour but de recréer la peinture mais « de la nettoyer simplement du brouillard du temps » [2]. Cette restauration, sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte en chef des monuments historiques n’a réussi qu’à brouiller la lecture archéologique de ces peintures, témoignages précieux de la décoration picturale d’origine de la grande basilique romane.
Michèle Pradalier-Schlumberger s’étonne de l’absence de comité constitué préalablement à ces restaurations alors qu’il en avait été formé un avant la restauration de la porte Miègeville. Daniel Cazes rappelle qu’il avait formé ce comité scientifique de haute lutte. Concernant la restauration des peintures du croisillon nord de Saint-Sernin, il recommande la prudence du jugement, tout en précisant que cette intervention est réversible. Il faut en tout cas, selon lui, replacer ce travail dans le contexte général du dossier actuel de Saint-Sernin : le plus grand monument de Toulouse et ses abords sont traités en fonction de considérations financières et électorales. On se demande à quoi sert la DRAC si elle n’exige ni ne favorise la constitution d’un véritable comité scientifique pour cette restauration. Il précise enfin que la commande passée par la Ville et le Musée Saint-Raymond aux architectes et restaurateurs était de rendre ces peintures plus lisibles par le public. On ne peut donc leur faire grief d’avoir réalisé une restauration en ce sens, dans la mesure où la déontologie professionnelle a été respectée. Pour Virginie Czerniak, les agents de la DRAC ne sont pas assez spécialisés pour suivre un tel chantier.
Louis Peyrusse rappelle que les restaurations de Pierre Bellin s’étaient limitées à une consolidation et au bouchement des piquetages, et qu’il n’avait effectué aucune retouche.

Séance publique du 24 mars 2019
Lire le compte-rendu
16 h, Hôtel d’Assézat, salle Clémence Isaure, 31000 Toulouse
Allocution de la Présidente
Remise des prix du concours 2019
M. Lei Huang, prix de Champreux
pour sa thèse : L’abbatiale Sainte-Foy de Conques (XIe-XIIe siècles), Université de Paris 1 –Panthéon Sorbonne, 2018.
M. Jean Berger, prix de Clausade
pour sa thèse : Droit, société et parenté en Auvergne médiévale (VIe-XIVe) : les écritures de la basilique Saint-Julien de Brioude, Université de Lyon 3 – Jean Moulin, 2016.
Mme Laura Viaut, prix de Clausade
pour sa thèse : « Fecimus concordiam ». Les mécanismes de gestion des conflits dans l’espace aquitain au Haut Moyen Âge (VIIIe-XIIe s.), Université de Limoges, 2018.
Mme Pauline Bouchaud, prix spécial de la S.A.M.F.
pour sa thèse : Le chanoine limousin Étienne Maleu († 1322), historien de son église, École Pratique des Hautes Études, 2018.
Mme Margaux Lemaire, prix spécial de la S.A.M.F.
pour son mémoire de Master 2 : La famille Barrau. Parenté et réseaux à Toulouse (XIIe-XIIIe s.), Université de Toulouse 2 – Jean Jaurès, 2018.
Mme Célia Oulad el Kaïd, prix spécial de la S.A.M.F.
pour son mémoire de Master 1 : L’exploitation des matières osseuses au paléolithique inférieur et moyen : l’exemple de la grotte du noisetier (Fréchet-Aure, Hautes-Pyrénées), Université de Toulouse 2 – Jean Jaurès, 2016.
Conférence de Benjamin MARQUEBIELLE :
« La longue histoire de la recherche en Préhistoire : Le Mésolithique dans le Midi de la France ».
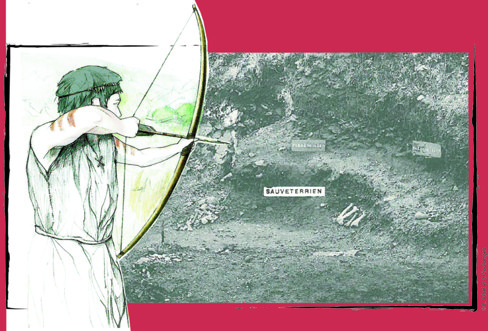

Séance du 05 mars 2019 (séance privée)
Communication longue de Bruno Tollon : « La fenêtre méridionale à la Renaissance ».
Lire le compte-rendu
 Mettre en avant le rôle de la baie dans l’architecture méridionale à l’époque de la Renaissance c’est faire le constat de l’apport plastique essentiel joué par les portes et les fenêtres dans l’organisation des façades par opposition à la travée rythmée. Partant, leur rôle majeur dans la définition de la Renaissance méridionale.
Mettre en avant le rôle de la baie dans l’architecture méridionale à l’époque de la Renaissance c’est faire le constat de l’apport plastique essentiel joué par les portes et les fenêtres dans l’organisation des façades par opposition à la travée rythmée. Partant, leur rôle majeur dans la définition de la Renaissance méridionale.
Présents : Mmes Nadal, Présidente, Sénard, Directrice, MM. Ahlsell de Toulza, Trésorier, Cabau, Secrétaire général, Mme Napoléone Secrétaire-adjointe ; Mmes Andrieu, Bessis, Pradalier-Schlumberger ; MM. Balty, Cazes, Garland, Garrigou Grandchamp, Peyrusse, Scellès, Sournia, Surmonne, Testard, Tollon, membres titulaires ; Mmes Balty, Dumoulin, Muños ; M. Rigault, membres correspondants.
Excusés : M. Péligry, Bibliothécaire-archiviste ; Mmes Cazes, Czerniak, Galés et Jaoul.
La Présidente présente à l’assemblée l’affiche, créée par Maurice Scellès, annonçant la séance publique du 24 mars, et elle invite chaque membre à en prendre, ainsi que des cartons d’invitation, pour les diffuser largement. Puis elle fait circuler le programme des journées de Saint-Michel-de-Cuxa, qui ont pour thème cette année L’image à l’époque romane. Elle donne ensuite lecture d’une lettre envoyée par Patrick Leroux, relecteur extérieur de nos Mémoires, qui nous transmet par ce courrier des félicitations pour notre publication, en particulier pour le dernier volume, qu’il vient de recevoir.
Deux ouvrages édités par l’Inventaire Occitanie nous sont donnés par Maurice Scellès : Saint-Sever-de-Rustan et L’art de la guerre.
Émilie Nadal donne ensuite la parole à Michèle Pradalier pour la lecture du rapport sur l’ouvrage de Pierre Funk, Les grandes heures de Notre-Dame du Bourg de Rabastens, présenté au concours de notre Société :
L’ouvrage de Pierre Funk, Les Grandes Heures de Notre-Dame du Bourg de Rabastens a été publié à l’occasion de l’exposition, dont Pierre Funk a été commissaire, organisée au Musée du Pays rabastinois de juin à novembre 2018. Le beau livre qui en a résulté, édité par la maison Escourbiac, se présente en deux parties, une première partie thématique et un catalogue de 230 œuvres judicieusement choisies, accompagnées de notices abondantes.
La première partie fait la synthèse d’une historiographie très riche, dont les nombreuses publications de Guy Ahlsell de Toulza, et retrace l’histoire de l’église de Rabastens depuis le prieuré bénédictin de Saint-Amans rattaché à Moissac jusqu’à l’installation, au XIIe siècle, d’une église au centre du bourg neuf. La reconstruction de l’église au XIIIe siècle commença par une nef unique qui en fit un jalon essentiel du gothique méridional et se poursuivit en 1318 par l’ajout d’un vaste chœur entouré de chapelles. Les grandes dates de l’histoire de Notre-Dame du Bourg sont la création d’un chapitre en 1547 et son rattachement au collège des Jésuites de Toulouse en 1583. L’église souffrit des guerres de religion et de la Révolution, le XIXe siècle fut donc le temps des restaurations, de César Daly pour la façade, de Louis-Victor Gesta pour les vitraux et de Joseph Engalière pour les peintures murales gothiques redécouvertes sous les badigeons.
L’étude archéologique de l’église est convaincante. Notons celle du très complexe massif occidental, avec également de bonnes observations sur la chronologie des voûtes de la nef, et de la structure du chœur. L’auteur analyse les chapelles du chœur et les peintures murales, distinguant les parties authentiques et les restaurations ; il donne cependant moins de place aux vitraux. Il a par contre particulièrement développé la reconstitution de la chapelle d’axe et de ses autels successifs, depuis le maître-autel à deux étages du XVe siècle, orné d’un retable d’albâtre dont les plaques sont conservées au Musée des Augustins et qui figuraient dans l’exposition. Véritable « sanctuaire dans le sanctuaire », la chapelle d’axe recevait tous les deux ans les cérémonies de l’Assomption de la Vierge, dites du Montement, dont Pierre Funk analyse la machinerie. Il s’appuie sur un dessin de 1911 conservé à la médiathèque de l’architecture et du patrimoine et présent dans l’exposition, pour décrire le délicat mécanisme construit au XVIe siècle : autour de la statue de la Vierge, deux grandes roues de bois portant 14 figurants costumés en anges tournaient en sens inverse, le tout monté par un système d’élévation avec vis et poulies particulièrement complexe.
L’auteur rappelle la richesse et la longévité de la confrérie du Montement, fondée au XIIIe siècle et qui qui dura jusqu’à la Révolution. L’un des points forts de l’exposition a été la présentation du très célèbre diptyque de Rabastens, prêté par le musée de Périgueux, un petit retable gothique de parchemin collé sur bois représentant quatre scènes sous des remplages, deux scènes de la Passion du Christ, la Flagellation et la Crucifixion, et deux scènes mariales, la Dormition et le Couronnement de la Vierge. Peint par un peintre toulousain, le diptyque rappelle par son inscription la fondation de la Confrérie de l’Assomption de la Vierge en 1286.
Les chapelles de la nef, moins connues, ont fait l’objet d’une enquête attentive portant sur leur histoire, leurs aménagements, peintures et mobilier. L’auteur s’est livré à un inventaire très documenté de l’orfèvrerie et l’exposition rend compte de la richesse de ces objets provenant du trésor et pour quelques œuvres, du Musée. Statues et tableaux (en particulier le beau Saint Jérôme dans le désert du Musée) ont figuré dans l’exposition et l’auteur s’est attaché au regroupement d’une importante collection de manuscrits et de livres provenant de la bibliothèque prieurale, puis canoniale.
Il faut enfin noter que l’auteur ne s’est pas contenté de l’étude stricte de l’église Notre-Dame, mais qu’il a élargi son propos aux bâtiments claustraux et aux paroisses rurales : Saint-Amans de Pratméja, une église préromane dont il a fait une monographie très réussie, Saint-Jean de Puycheval et Saint-Pierre de la Peyrière.
En conclusion, on ne peut que louer l’exceptionnel catalogue de l’exposition rabastinoise. Grâce à la grande érudition de Pierre Funk et à sa grande curiosité, on sait désormais tout sur Notre-Dame du Bourg, son orgue, ses tableaux, ses statues, son mobilier, ses ornements liturgiques, son trésor (même les pièces volées), ses cloches, son luminaire… Ce livre me semble tout à fait mériter d’être distingué et récompensé par une médaille d’argent de la Société archéologique du Midi de la France.
La Présidente propose de remettre une médaille d’argent à Pierre Funk pour saluer son travail. La proposition soumise au vote est acceptée à l’unanimité.
Elle donne ensuite la parole à la Secrétaire-adjointe pour la lecture des procès-verbaux des deux dernières séances, qui sont adoptés après quelques modifications.
Émilie Nadal nous annonce ensuite qu’elle vient d’apprendre le décès de Jacques Bousquet, membre libre de notre société. Nous lui rendrons hommage à la séance prochaine.
Puis elle donne la parole à notre confrère Bruno Tollon pour une communication longue intitulée La fenêtre dans la Renaissance méridionale.
La présidente remercie le conférencier pour sa présentation intéressante, puis elle donne la parole à Bernard Sournia. Celui-ci déclare qu’il y a longtemps, réfléchissant sur la grande façade à l’antique du château d’Uzès, il a eu à se pencher sur quelques compositions apparentées, languedociennes ou provençales, des années 1540, et il remercie Bruno Tollon de s’en être rappelé dans sa communication. Il était alors surtout intrigué et intéressé par la position paradoxale de ces maîtres maçons et architectes locaux qui connaissaient manifestement par cœur leurs traités vitruviens, mais qui entremêlaient ce répertoire de citations tirées des antiquités romaines de Nîmes ou Arles, en privilégiant dans ces modèles ce qu’ils trouvaient de plus capricieux et de moins canonique, tel l’ordre dorico-corinthien d’Arles, comme s’ils avaient voulu inventer une alternative nationale, inspirée des sources disponibles sur place, aux normes des théoriciens d’outre Alpes. Il n’a pas approfondi cette intuition, dit-t-il enfin, mais pense qu’il y aurait matière à creuser la question. Bruno Tollon approuve ces remarques et ajoute que l’on a par exemple tendance à se référer à la vis étroite du Vitruve du XVIIe siècle, reprise par tous les manuels, alors que la liberté était très grande et le goût de la variation témoigne de l’imagination des artistes. Il faut donc résister, conclut-il, au classement et à la simplification exigée par la pédagogie pour présenter l’art de la Renaissance. Olivier Testard revient sur la Maison des trois nourrices de Narbonne dont la fenêtre et la façade principale ont été évoquées, et il précise que c’est selon lui la vision d’angle qui a été privilégiée sur cet édifice : il n’y a donc pas de hiérarchie entre les deux façades. Pierre Garrigou Grandchamp dit que cet exposé lui a évoqué de nombreux parallèles dans une région plus élargie au Nord, jusqu’à Périgueux et Clermont-Ferrand. Bruno Tollon avoue avoir limité sa zone d’étude, mais il confirme que l’on pourrait aussi multiplier les exemples en Provence et en Espagne. Olivier Testard revient sur le bail à besogne de Bachelier pour l’hôtel de Bagis qui a été mentionné durant la communication. Celui-ci mentionne deux pièces en retour qu’il ne situe pas. Selon Bruno Tollon, Bachelier avait beaucoup de chantiers dont il s’occupait peu ; ces pièces n’auraient sans doute pas été faites. Daniel Cazes demande enfin ce qu’il en est de la conservation des œuvres et des hôtels de la Renaissance à Toulouse, qui lui semblent dans un grave état d’abandon. Les sculptures du portail de l’hôtel de Buet-Bernuy rue de la Pomme, par exemple, sont lamentablement ruinées par la maladie de la pierre et le manque d’entretien. En évoquant les interventions effectuées sur l’hôtel du Vieux-Raisin, il s’indigne de l’utilisation de méthodes abrasives comme le sablage pour le nettoyage, faisant disparaître l’épiderme de la pierre et rendant la sculpture illisible. Toujours dans le même édifice, il rappelle que l’on a remplacé des sculptures par des copies, alors que cela ne s’imposait pas, et que les originaux ont été laissés sur place dans la cour, gisant aux côtés des poubelles. On se demande alors à qui revient le contrôle des Monuments Historiques. Maurice Scellès affirme que la DRAC n’a qu’un rôle de contrôle et qu’il revient à la Municipalité d’agir dans un cas comme celui-ci. Daniel Cazes répond que la DRAC a un rôle de conseil auprès des élus. Maurice Scellès déplore qu’il n’y ait pas de suivi des Monuments Historiques et que les interventions ne soient effectuées que lorsqu’un problème survient. Pierre Garrigou Grandchamp pense qu’il ne faut pas généraliser et dit connaître certains centres urbains où les architectes font des suivis des monuments qu’ils visitent régulièrement. Guy Ahlsell de Toulza pense que nous avons une vision de la DRAC d’il y a 30 ans, avec beaucoup de personnels qui avaient un réel pouvoir, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Daniel Cazes répond que l’organigramme de la DRAC montre qu’il y a toujours beaucoup de personnel.
Émilie Nadal propose de compléter notre site avec une page dédiée aux bâtiments en péril comme nous l’avons fait pour Saint-Sernin, en utilisant des photographies anciennes et récentes pour illustrer la dégradation des édifices. L’idée est largement approuvée par les membres.
La Présidente donne ensuite la parole à Guy Ahlsell de Toulza, qui a représenté notre Société le 27 février dernier, à la journée dédiée à la signature d’une convention entre La Salvetat, la Fondation du Patrimoine et TERREAL, entreprise qui a fait don des tuiles pour la restauration du château. À l’heure actuelle, tout l’édifice est échafaudé, des charpentes et des tuiles sont posées ; deux corps de bâtiments sont hors d’eau. Des poutres peintes ont été découvertes dans les combles, ce qui laisse penser qu’ils étaient habités. On a découvert également de petits carreaux de terre cuite vernissés verts et décorés d’estampages. À ce jour, il reste à remonter l’aile effondrée.

Séance du 19 février 2019 (séance privée)
Lire le compte-rendu
Discussions pour l’attribution des prix du Concours après lecture des rapports sur les 9 travaux reçus.
Nouvelles de la bibliothèque : Grâce à Christian Péligry, notre bibliothécaire-archiviste, le catalogue des 252 manuscrits de la Société archéologique est désormais en ligne sur Calames, et c’est une première nationale pour une société savante ! (http://www.chartes.psl.eu/fr/actualite/numerisation-manuscrits-societe-archeologique-du-midi-france).
Le catalogue des imprimés, avec une recherche très efficace, est toujours ici.

Séance du 05 février 2019 (séance privée)
Communication courte de Benjamin Marquebielle : « Toulouse et la préhistoire : le Midi comme terre de (re)définition du Mésolithique ».
Lire le compte-rendu
Le Midi de la France occupe, dès le milieu du XIXe. siècle, une place centrale dans l’histoire de l’étude de la Préhistoire. Cela s’explique par la concentration en sites préhistoriques (notamment dans les Pyrénées) et par l’activité importante de nombreux chercheurs, archéologues de terrain laïcs ou clercs. Cette activité a amené une émulation intense notamment autour de Toulouse, qui a joué un rôle moteur dans la structuration du paysage scientifique de l’époque en lien avec l’étude de la Préhistoire – E. Cartailhac, membre puis président de la SAMF, est un de ces acteurs, particulièrement actif.
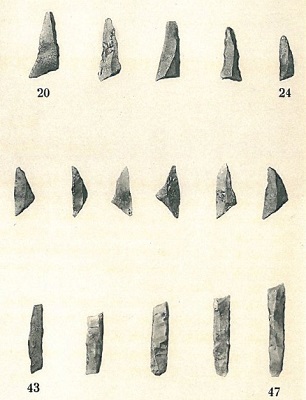 Dès la deuxième moitié du XIXe. siècle, la question se pose des modalités de transition entre le Paléolithique et le Néolithique, avec le passage, très tôt identifié mais mal compris, d’une économie de prédation à une économie de production. Les résultats des travaux d’E. Piette au Mas d’Azil participent à amener des éléments de réponse, en définissant l’Azilien. Mais les méthodes de travail d’alors ne permettent pas d’identifier les vestiges, très fugaces et de petites tailles, de ce que l’on appelle aujourd’hui le Mésolithique. La reconnaissance et la définition de cette période se fera progressivement, tout au long du XXe siècle, notamment grâce à des travaux de terrain dans le Midi. Le Mésolithique, longtemps vu comme une transition, est désormais considéré comme disposant d’une identité propre, et constitue un axe de recherche important des équipes de Préhistoire rattachées à l’université toulousaine, héritage d’une tradition d’étude locale de plusieurs décennies.
Dès la deuxième moitié du XIXe. siècle, la question se pose des modalités de transition entre le Paléolithique et le Néolithique, avec le passage, très tôt identifié mais mal compris, d’une économie de prédation à une économie de production. Les résultats des travaux d’E. Piette au Mas d’Azil participent à amener des éléments de réponse, en définissant l’Azilien. Mais les méthodes de travail d’alors ne permettent pas d’identifier les vestiges, très fugaces et de petites tailles, de ce que l’on appelle aujourd’hui le Mésolithique. La reconnaissance et la définition de cette période se fera progressivement, tout au long du XXe siècle, notamment grâce à des travaux de terrain dans le Midi. Le Mésolithique, longtemps vu comme une transition, est désormais considéré comme disposant d’une identité propre, et constitue un axe de recherche important des équipes de Préhistoire rattachées à l’université toulousaine, héritage d’une tradition d’étude locale de plusieurs décennies.
Communication courte de Marie Vallée-Roche : « Découverte d’un manuscrit inédit à La Livinière (Hérault) : une enquête de 1269 ».
 Il s’agit d’un manuscrit trouvé fin 2017 chez un particulier, partiellement brûlé. Il manque le début et la fin, les lacunes sont considérables. Il se présente comme un volumen dont il reste aujourd’hui deux morceaux, d’une longueur totale de 5,42 mètres de long. On y trouve des dépositions d’habitants de La Livinière au cours d’une enquête demandée en 1269 par des officiers royaux pour instruire un procès qui oppose les seigneurs de la Livinière, c’est-à-dire en l’occurrence les enfants de feu Pierre Lo Singlar, représentés par leur beau-père Guilhem de Ventenac, à des habitants de La Livinière, représenté par l’un des leurs, Bernard Petri.
Il s’agit d’un manuscrit trouvé fin 2017 chez un particulier, partiellement brûlé. Il manque le début et la fin, les lacunes sont considérables. Il se présente comme un volumen dont il reste aujourd’hui deux morceaux, d’une longueur totale de 5,42 mètres de long. On y trouve des dépositions d’habitants de La Livinière au cours d’une enquête demandée en 1269 par des officiers royaux pour instruire un procès qui oppose les seigneurs de la Livinière, c’est-à-dire en l’occurrence les enfants de feu Pierre Lo Singlar, représentés par leur beau-père Guilhem de Ventenac, à des habitants de La Livinière, représenté par l’un des leurs, Bernard Petri.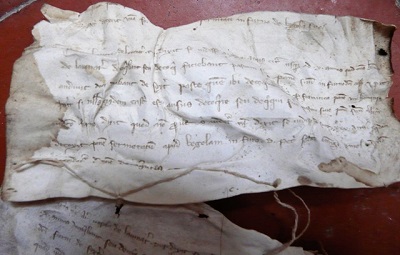 Certains habitants détournent-ils le droit de fournage dû aux seigneurs en cuisant des pains dans leurs propres fours, pour eux et aussi pour d’autres habitants du village ? C’est tout l’objet de cette vaste enquête. Dans le parchemin qui subsiste, on voit défiler 22 témoins, dont 6 femmes. Les témoignages sont recueillis et classés par chapitres, qui correspondent à différentes sessions de dépositions, ce qui permet de confronter les différentes versions que donnent successivement les témoins, afin de détecter les faux témoignages. Il s’agit pour les enquêteurs de déterminer depuis quand les habitants de La Livinière se dispensent d’acquitter le droit de fournage.
Certains habitants détournent-ils le droit de fournage dû aux seigneurs en cuisant des pains dans leurs propres fours, pour eux et aussi pour d’autres habitants du village ? C’est tout l’objet de cette vaste enquête. Dans le parchemin qui subsiste, on voit défiler 22 témoins, dont 6 femmes. Les témoignages sont recueillis et classés par chapitres, qui correspondent à différentes sessions de dépositions, ce qui permet de confronter les différentes versions que donnent successivement les témoins, afin de détecter les faux témoignages. Il s’agit pour les enquêteurs de déterminer depuis quand les habitants de La Livinière se dispensent d’acquitter le droit de fournage.
Malgré ses lacunes, ce document est d’un grand intérêt historique en raison de la destruction des archives du château de Carcassonne pendant la Révolution.
Présents : Mme Nadal, Présidente, MM. Ahlsell de Toulza, Trésorier, Cabau, Secrétaire général, Mme Napoléone, Secrétaire-adjointe, M. Péligry, Bibliothécaire-archiviste ; Mmes Bessis, Cazes, Jaoul, Vallée-Roche ; MM. Cazes, Garrigou Grandchamp, Lassure, Peyrusse, Testard, membres titulaires ; Mme Dumoulin, MM. Foltran, Marquebielle, membres correspondants.
Excusés : Mmes Balty et Sénard, MM. Balty, Garland, Macé, Scellès et Tollon.
Émilie Nadal annonce le décès de notre consœur Marie-Bernadette Bruguière et demande à Louis Peyrusse de lui rendre hommage au nom de la Société :
Marie Bernadette Bruguière (1944-2019)
Nous avons appris le 23 janvier dernier la mort de notre consœur Marie Bernadette Bruguière, à l’âge de 74 ans. Il est sans doute des lieux où son éloge funèbre retentira plus fortement, je songe à l’Université des Sciences sociales et peut-être à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres. S’achève ainsi une longue carrière d’enseignante de l’histoire du Droit et des Institutions à l’Université de Toulouse. Reçue très jeune à l’agrégation des Facultés de Droit, elle a d’abord travaillé à une thèse de doctorat, publiée tardivement : Littérature et droit dans la Gaule du Ve siècle, P.U.F., 1974. Dans la lignée de Pierre Courcelle, elle y analyse les sources littéraires et juridiques du temps. Cet angle de vue a inégalement convaincu les historiens de l’Antiquité tardive. Marie Bernadette Bruguière n’a pas persévéré dans ce champ de recherche. Elle a donc enseigné aux côtés de Germain Sicard, d’Henri Gilles, Jean-Louis Gazzaniga, puis de Jacques Poumarède et d’André Cabanis. Nombre d’entre eux ont siégé dans notre Compagnie.
Dans ses publications, on notera un Manuel d’histoire du droit (avec Sicard et Gilles) et beaucoup d’articles dont l’éclectisme reflète une vaste curiosité, depuis « Le Nouveau Testament et les droits de l’Antiquité » (1975), « Homère a-t-il inventé le régime mixte ? » (2010) à « Jules Verne et la colonisation », « Germanophilie et germanophobie en France au XIXe s. ». On y trouve aussi des hommages, un salut à ses maîtres, Paul Ourliac, Jean Dauvillier, Romuald Szramkiewiecz et des directions de colloque comme Prendre le pouvoir, force et légitimité en 2002. Sa grande originalité est d’avoir proposé une lecture de l’opéra, ce chaudron de sorcière des amours, des interdits, des pulsions, des passions, opéra, vu au-delà de la dramaturgie et de la musicologie, sous le prisme du Droit. Ses collègues et amis lui ont offert en 2014, peu après sa retraite, un volume de mélanges où ont été regroupés ses articles : Opéra, politique et droit, le volume d’hommage le plus inattendu publié par les P.U.S.S., très vite épuisé.
Femme de fortes convictions, elle n’imposait aucune opinion, à la différence de nombre de ses collègues, respectueuse de la liberté de chacun, très attentive à ses étudiants, totalement dévouée à l’institution universitaire. Cette longue carrière de professeur appelle l’éloge provocateur de Fontenelle à propos d’un confrère enseignant : « Il travaillait à se rendre inutile ». À la mesure des nombreuses générations d’étudiants passés par ses cours et ses conseils, c’est là le plus beau des hommages.
Après la lecture de ce texte, la Compagnie observe une minute de silence.
Concernant l’affaire des travaux en cours à Saint-Sernin, notre Présidente nous informe ensuite qu’une réponse à la lettre que nous avions envoyée à Didier Deloume nous est parvenue, et elle en donne lecture. Le document, probablement rédigé par les Services de la DRAC, n’est pas signé par le conservateur ; on ne voit donc pas très bien qui est notre interlocuteur. Quitterie Cazes remarque que le souhait de valorisation du site est évoqué à la fin de la lettre et que l’on pourra peut-être à l’avenir s’appuyer sur cet écrit. En effet, la mise en valeur de la place revient à la Ville et il n’est pas certain qu’elle désire faire de grands investissements dans ce sens.
Émilie Nadal présente ensuite un nouveau volume des Mémoires de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, dans lequel est publié un article de notre confrère Guy Ahlsell de Toulza : « Un nouveau regard sur les hôtels toulousains de la Renaissance » (vol. 180, 19e série, tome IX, 2018, p. 185-193).
Puis elle donne la parole à Benjamin Marquebielle pour une communication courte intitulée : Toulouse et la préhistoire : le Midi comme terre de (re)définition du Mésolithique.
La Présidente remercie notre confrère pour cette communication très intéressante et demande si ce sont bien les données environnementales qui définissent le début de cette période. En effet, confirme Benjamin Marquebielle, le climat se réchauffe et les chronozones botaniques, alignées sur la période géologique de l’Holocène, permettent de reconnaître les sites mésolithiques. Cependant, poursuit-il, les choses ne sont pas aussi simples, les changements commencent bien plus tôt et il reste actuellement difficile de cerner la genèse de cette période, dont peu de sites témoignent. Il n’y a pas de révolution mésolithique, mais c’est une époque qui a vraiment ses caractéristiques propres. Les microlithes que l’on trouve sur les sites étaient fixés sur des supports en bois. Il ne s’agit pas de petites armatures pour petit gibier, mais de plusieurs microlithes montés sur un support en bois qui étaient aussi bien utilisés pour la chasse du gros gibier. Cette technique permettait une meilleure rentabilisation des matériaux de qualités variables et une plus grande souplesse dans la production. Martine Jaoul demande si le changement de végétation a eu des incidences sur la production des outils. Benjamin Marquebielle répond que l’outillage a en effet évolué, mais qu’aucun vestige de bois n’est conservé dans le Midi ; l’artisanat du bois reste donc en grande partie inconnue. Daniel Cazes se dit enchanté par l’exposé que notre confrère a fait l’histoire de la discipline et regrette qu’après les travaux du Museum d’Histoire naturelle de Toulouse, on ait pris le parti de faire disparaître la galerie des cavernes ou de la Préhistoire, alors qu’il s’agit du plus ancien Musée de Préhistoire de France. Benjamin Marquebielle répond qu’il reste malgré tout au Museum une petite pièce consacrée à la Préhistoire, mais le parti a effectivement été pris de montrer les temps géologiques, où l’humanité n’a qu’une part restreinte. Il signale enfin qu’en 2020 la ville de Toulouse accueille un grand congrès intitulé MESO 2020, qui regroupera tous les mésolithiciens d’Europe.
Émilie Nadal donne ensuite la parole à notre consœur Marie Vallée-Roche pour une seconde communication courte : Découverte d’un manuscrit inédit à La Livinière (Hérault) : une enquête de 1269.
La Présidente remercie la conférencière pour l’exposé de l’enquête qu’elle a menée autour de ce document. Marie Vallée-Roche précise qu’elle voudrait encore la poursuivre pour répondre à un certain nombre de questions. Elle s’étonne par exemple du prix élevé du fournage, qui s’élève à 1/6e, ce qui est loin d’être la norme. Quitterie Cazes voudrait savoir s’il existe beaucoup d’enquêtes de ce genre ; la conférencière répond qu’on en trouve un certain nombre, mais pas dans la région. Par ailleurs, ce document est de toute première importance pour le village de La Livinière car c’est le plus ancien document de la commune. Il a sans doute appartenu aux archives municipales et a dû être récupéré par un particulier lorsque celles-ci ont brûlé. Cependant, dans la mesure où il n’existe plus d’inventaire, le fait reste difficile à prouver. Par ailleurs, on ne sait pas ce que peut devenir un tel document dans les mains d’un non spécialiste qui n’a pas conscience de sa valeur scientifique. On peut supposer enfin que d’autres morceaux de ce manuscrit se trouvent disséminés chez d’autres particuliers. La seule façon de préserver le témoignage historique de ce document, déclare Louis Peyrusse, c’est de le publier ; cela pourrait encourager ceux qui ont des documents chez eux à le faire savoir, suggère pour finir Guy Ahlsell de Toulza.
Au titre des questions d’actualité, Daniel Cazes nous apprend le décès, le 22 janvier dernier, de Jean-Maurice Rouquette, ancien conservateur des musées d’Arles.
Jean-Maurice Rouquette (Arles, 1931 – Arles, 2019)
Celui qui fut pour moi le plus grand conservateur du patrimoine du Midi de la France, et peut-être de France, que j’aie connu dans ma vie, Jean-Maurice Rouquette, est décédé à l’âge de 87 ans à Arles, sa ville natale, le mardi 22 janvier 2019. Un hommage exceptionnel, à la mesure de son œuvre, lui a été rendu le vendredi 25 février en l’hôtel de Ville d’Arles, en présence d’une assemblée impressionnante, avant que celle-ci ne se déplace ensuite dans l’église Saint-Trophime voisine pour la messe de funérailles. Tous les conservateurs et archéologues (ses petits, disait-il) qu’il avait mis en place dans les divers musées et monuments de la ville étaient là, prononçant dans la plus grande émotion des paroles qui allaient au cœur. Nombre de chercheurs de l’Université et du C.N.R.S. étaient aussi venus. Au milieu de cette foule silencieuse, comme stupéfaite de la disparition inimaginable d’un homme qui déployait encore une impressionnante activité malgré sa retraite, évoluaient des Arlésiennes en costume traditionnel de deuil.
Viscéralement Arlésien, au point qu’il se présentait habituellement en lançant à ses interlocuteurs : « Rouquette d’Arles », Jean-Maurice Rouquette fut le disciple de l’archéologue Fernand Benoît, et suivit à l’Université d’Aix-en-Provence les enseignements de Georges Duby et de Jean-Rémy Palanque. Il s’y spécialisa dans les domaines de l’histoire de l’art paléochrétien et médiéval. Mais aucune période de l’histoire d’Arles et de sa chère Provence (dont il donna une description éblouissante et mémorable dans le volume I de la Provence romane des éditions Zodiaque, la nuit des temps, 1974) ne lui fut étrangère et l’Antiquité romaine dans son ensemble, partout présente à Arles, le passionnait tout autant. Nommé conservateur des musées d’Arles en 1956, il occupa sans cesse ce poste clef jusqu’en 1995. Parti de peu de chose, il réussit à en multiplier l’action, multiforme, prenant en compte l’ensemble du patrimoine arlésien.
Dès ses débuts, chose assez rare, alors que la ville était pour l’essentiel connue pour ses antiquités romaines et ses richesses médiévales, il se tourna aussi vers l’art contemporain, établissant des relations étroites avec Picasso, organisant des expositions temporaires consacrées aux sculptures de Germaine Richier et de César, ou aux peintures de Nicolas de Staël. Conscient de l’image positive que cela pouvait donner de sa ville, non pas endormie au bord du Rhône, mais ouverte, comme toujours, aux créations artistiques venues d’ailleurs, il fonda en 1970, avec Lucien Clergue, les célèbres « Rencontres internationales de la photographie d’Arles », auxquelles le Toulousain Jean Dieuzaide adhéra immédiatement. Le Musée des Beaux-Arts Réattu, dans l’ancien prieuré de Malte, était alors le centre de son activité. Il le rénova, l’enrichit considérablement et y organisa de nombreuses expositions que l’on venait voir de loin.
Les arts et traditions populaires ne le laissèrent pas indifférent et on lui doit le parc naturel régional et le musée de la Camargue (ce dernier créé à une dizaine de kilomètres d’Arles). Une autre célèbre institution, le Museon Arlaten, attira toute son attention, bien qu’autonome et dépendant d’une commission émanant du Félibrige. Il la défendit toute sa vie, ce qui devrait prochainement déboucher sur sa complète rénovation. Autre institution traditionnelle de la ville, l’Académie d’Arles fut présidée par lui pendant cinquante ans, à partir de 1965. En 2015, il céda cette présidence à l’archéologue de renom Marc Heijmans, qu’il avait accueilli à Arles chaleureusement, comme tant d’autres de ses collaborateurs, entraînés dans son sillage.
C’est à Jean-Maurice Rouquette que l’on doit le développement extraordinaire de l’archéologie dans sa ville, avec la création d’un service spécifique, parfaitement équipé en matériel, salles d’étude, de conditionnement, de restauration des objets découverts de toute sorte. Pour lui, ce patrimoine caché de la ville devait nécessairement remis au jour, à l’occasion des divers travaux urbains ou de fouilles programmées, et le plus souvent possible mis en valeur in situ et rendu accessible au public. Il était à ses yeux aussi important que les monuments et collections déjà reconnus, non seulement comme l’objet des recherches menées par des spécialistes du monde entier, mais parce que « les pierres de nos ancêtres seront le pain de nos enfants » (propos rappelé par le conservateur Claude Sintès). Sa vision du patrimoine, comme partie intégrante de la vie d’une ville et un atout capital pour son image, son tourisme intelligent, avec ses retombées économiques, était vraiment prospective. De nombreux élus le reconnurent lors de l’hommage officiel rendu à Jean-Maurice Rouquette, qui fit d’Arles un laboratoire d’idées dans ce domaine, vers lequel bien d’autres élus français et étrangers ou professionnels du patrimoine tournèrent et tournent encore leurs regards.
Tout cela était le quotidien de notre cher conservateur, qui jamais ne ménagea sa peine pour défendre ses projets, convaincre élus et administrations, associer l’ensemble de la population de sa ville en l’informant sans cesse. Ses conférences, servies par un talent oratoire hors du commun, une langue riche et imagée, des anecdotes fourmillantes de vie, ont laissé partout des souvenirs inoubliables. Chaque fois qu’il vint en donner une à Toulouse, dans le cadre des activités du Musée Saint-Raymond, musée des Antiques, qu’il aimait beaucoup, la salle était pleine à craquer et l’enthousiasme du public débordant.
La réalisation qui sans doute le fit le plus connaître dans le monde entier fut celle du nouveau Musée de l’Arles antique, qu’il fonda en 1988 au bord du Rhône, dans la perspective des vestiges du cirque romain. Il fut inauguré en 1995, en mettant un terme prestigieux à la carrière de Jean-Maurice Rouquette. Ce fut pour lui un projet d’une incroyable envergure, dont il peaufina le programme muséologique avec expérience et talent, le défendant aussi avec acharnement face à tous ceux qui le croyaient pharaonique alors qu’il correspondait strictement aux besoins réels. C’est sur la base de sa réflexion que l’architecte Henri Ciriani put mettre en œuvre l’impressionnant bâtiment du « musée bleu de Jean-Maurice Rouquette ». L’idée qui en sous-tendait la nécessité était de rassembler là toutes les collections archéologiques protohistoriques et romaines (jusque-là dispersées en différents lieux de la ville), enrichies par les nombreuses découvertes faites pendant des années sur le territoire d’Arles, en intégrant au musée non seulement tous les services indispensables (accueil de tous les publics, auditorium, salle d’exposition temporaire, bibliothèque, conservation, documentation, réserves, ateliers…) mais aussi le centre de recherche archéologique avec toutes ses composantes. Chose peu courante, son projet prévoyait aussi les extensions futures du musée, ce qui permit très récemment la greffe parfaitement logique d’une nouvelle galerie consacrée à la navigation sur le Rhône et au commerce. Cette vision dynamique du musée, comparable à celle d’une entreprise ou d’une usine prospères qui augmentent leur activité, rejoignait bien l’idée qui était la sienne que le patrimoine est un enjeu capital pour la vieille Europe de demain.
Rappelons enfin son rôle déterminant dans la restauration des monuments de sa ville (celle de la façade et du cloître de Saint-Trophime notamment), dans le classement d’Arles au patrimoine de l’UNESCO et dans de nombreuses publications. En 2008 il eut l’immense plaisir de voir paraître, réalisé par l’Imprimerie nationale, un ouvrage collectif « monumental » (1300 pages…) dont il avait pris l’initiative et la direction : Arles : histoire, territoires et cultures. Peu de villes bénéficient du privilège d’un tel livre, à la mesure de leur patrimoine, magnifiquement mis en page et illustré.
Tel était ce personnage « solaire, enthousiaste, passionné » (Dominique Séréna, conservateur du Museon Arlaten), « l’âme de sa ville » avec une voix « magnétique, habitée, nourricière, qui en un clin d’œil savait mettre l’auditeur au cœur du récit » (Michèle Moutashar, conservateur des musées d’Arles), qui illustra, au-delà de sa Provence, l’ensemble de notre Midi. Tous ceux qui l’ont approché et connu sont aujourd’hui à la fois honorés de l’avoir rencontré et profondément attristés par son départ vers l’autre rive du Rhône, vers ce cimetière de Trinquetaille où sa forte présence a rejoint celle de tant d’Arlésiens et du martyr chrétien Genès. Tout en s’associant aux condoléances exprimées urbi et orbi, la Société archéologique du Midi de la France se devait de rappeler la stature hors du commun de Jean-Maurice Rouquette, avec une pensée particulière pour son épouse, madame Jacqueline Rouquette, qui, tout au long d’une vie intense, sut le soutenir et partager avec lui une mission si bien remplie.
Daniel Cazes poursuit en nous informant qu’une partie de la muraille des Hauts-Murat s’est effondrée. Celle-ci avait été élevée au XIVe siècle mais les parties hautes dataient du XVIIe. Elle était propriété publique, mais elle avait été cédée à un promoteur qui avait pour projet de construire des logements contre elle. La grue implantée contre les parements a ainsi provoqué l’effondrement du mur. Daniel Cazes craint que la construction de la résidence ne finisse par cacher entièrement la muraille, et que l’on se retrouve ainsi dans le même cas de figure que sur le site de Larrey.

Séance du 22 janvier 2019 (séance privée)
Assemblée générale annuelle. Rapport moral de la présidente. Rapport du bibliothécaire-archiviste.
Rapport du trésorier. Approbation des rapports et quitus au trésorier.
Élections du directeur, du trésorier et du secrétaire-adjoint. Tous les membres titulaires de la Société peuvent présenter leur candidature à ces postes et sont priés d’en faire part assez tôt au Bureau.
Communication courte de Daniel Cazes & Maurice Scellès : « Le réfectoire des Grands-Augustins de Toulouse : un important monument médiéval que l’on ne sut conserver ».
Lire le compte-rendu
L’ancien réfectoire du couvent des ermites augustins de Toulouse fut scandaleusement démoli pendant l’été de 1868, au milieu d’une opinion politique et institutionnelle divisée quant à son éventuelle conservation. Il était un exemple particulièrement remarquable de l’architecture méridionale du XIVe siècle, telle qu’elle s’exprima à travers des bâtiments fonctionnels de toute sorte (salles d’assemblée comtales, royales et épiscopales dites « tinels », nefs pour les constructions navales, dortoirs, réfectoires, celliers des grandes communautés religieuses…) dans les anciens pays languedociens et catalans. Ainsi Toulouse perdit-elle un de ses monuments du moyen-âge les plus intéressants et les plus typés, par ses grandes dimensions et son harmonieux équilibre spatial. Lors des travaux d’aménagement de la salle des sculptures romanes du musée des Augustins dirigés par Denis Milhau et Yves Boiret en 1980, les auteurs de cette communication eurent l’opportunité de pouvoir dégager, sans procéder pour autant à une fouille archéologique complète, et observer la partie basse du mur occidental de ce réfectoire, restée en place après l’arasement de 1868. Outre l’évocation du réfectoire, ce sont les résultats de cette observation et le relevé en plan de ce mur qui fut alors fait qui seront présentés lors de cette courte communication.
Lors des travaux d’aménagement de la salle des sculptures romanes du musée des Augustins dirigés par Denis Milhau et Yves Boiret en 1980, les auteurs de cette communication eurent l’opportunité de pouvoir dégager, sans procéder pour autant à une fouille archéologique complète, et observer la partie basse du mur occidental de ce réfectoire, restée en place après l’arasement de 1868. Outre l’évocation du réfectoire, ce sont les résultats de cette observation et le relevé en plan de ce mur qui fut alors fait qui seront présentés lors de cette courte communication.
Émilie Nadal donne la parole à Daniel Cazes pour une communication courte : L’ancien réfectoire des Augustins de Toulouse , qu’il a préparée avec Maurice Scellès.
La Présidente remercie Daniel Cazes pour cette seconde version de son exposé, qu’il a enrichie par rapport à celle qu’il avait présentée en 2013. Elle note que l’aveuglement des autorités locales vis-à-vis du patrimoine toulousain ne date pas d’aujourd’hui. Maurice Scellès tient à préciser qu’en 1980 aucune fouille n’avait été prescrite préalablement aux travaux et que lui-même, à l’époque en stage au Musée, faisait ses débuts dans la technique du relevé. Les photographies prises à cette occasion avaient été déposées au Musée ; elles ont malheureusement disparu. L’édifice a pourtant déjà fait l’objet de nombreux travaux, notamment dans le cloître, et aucune fouille n’a jamais été prescrite, regrette Daniel Cazes, alors que l’existence d’une domus romaine avait été reconnue. Il ne faut pas oublier, conclut-il, que la Circonscription des Antiquités historiques de Midi-Pyrénées, dont Michel Labrousse était alors le directeur, n’avait que deux employés.
Au titre des questions diverses, Guy Ashlell de Toulza nous montre des photographies de la maison n° 3 de la rue des Changes, qui en cours de travaux. L’arrachement de l’enduit dans les parties basses a fait apparaître des ouvertures recouvertes d’un linteau en bois au rez-de-chaussée et le départ de pans de bois à l’étage. Les murs latéraux sont maçonnés. On peut reconnaître une maison du XVe siècle en pans de bois, avec ses piliers en rez-de-chaussée, les moulures caractéristiques des croisées basses qui devaient ouvrir sur un entresol. La façade a été recouverte d’un enduit de plâtre décoré, caractéristique de l’époque de la monarchie de Juillet.

Séance du 08 janvier 2019 (séance privée)
Communication longue de Fernand Peloux : « Éxupère ou la fabrique d’un saint toulousain de l’Antiquité au Moyen Âge. Réflexions à propos d’un texte inédit d’un manuscrit de La Haye (XIe s.) ».
Lire le compte-rendu
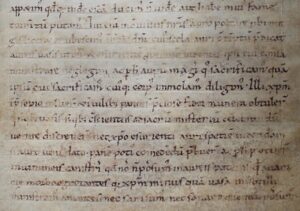 Avec Saturnin, Exupère est au Moyen Âge le saint par excellence de Toulouse. Si l’existence du premier reste hypothétique, le second est bien attesté par plusieurs textes datés de son épiscopat au début du Ve siècle. Comme son contemporain Rustique de Narbonne, Jérôme l’évoque à plusieurs reprises. Usuard considère chacun des deux évêques comme saint, mais si le culte de Rustique semble avoir été restreint et n’avoir jamais conduit à la rédaction d’un récit hagiographique, le culte d’Exupère fut important à Toulouse et conduisit à la rédaction d’un texte, connu dans plusieurs versions, toutes inédites.
Avec Saturnin, Exupère est au Moyen Âge le saint par excellence de Toulouse. Si l’existence du premier reste hypothétique, le second est bien attesté par plusieurs textes datés de son épiscopat au début du Ve siècle. Comme son contemporain Rustique de Narbonne, Jérôme l’évoque à plusieurs reprises. Usuard considère chacun des deux évêques comme saint, mais si le culte de Rustique semble avoir été restreint et n’avoir jamais conduit à la rédaction d’un récit hagiographique, le culte d’Exupère fut important à Toulouse et conduisit à la rédaction d’un texte, connu dans plusieurs versions, toutes inédites.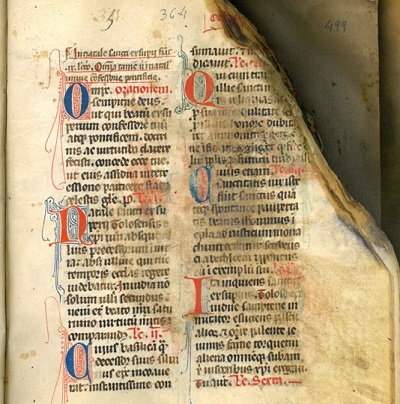 La plus ancienne se trouve dans un manuscrit de la fin du XIe siècle conservé à La Haye. Ce manuscrit, inconnu des études consacrées au saint qui faisaient jusqu’alors de Bernard Gui le premier rédacteur d’un texte, oblige à s’interroger sur les conditions qui ont conduit à une telle promotion hagiographique. Après l’édition et l’examen de ce texte, on propose de le replacer au cœur de la crise grégorienne, moment d’investissement hagiographique à Toulouse comme ailleurs en Languedoc. On évoquera enfin l’évolution de sa légende jusqu’à la fin du Moyen Âge.
La plus ancienne se trouve dans un manuscrit de la fin du XIe siècle conservé à La Haye. Ce manuscrit, inconnu des études consacrées au saint qui faisaient jusqu’alors de Bernard Gui le premier rédacteur d’un texte, oblige à s’interroger sur les conditions qui ont conduit à une telle promotion hagiographique. Après l’édition et l’examen de ce texte, on propose de le replacer au cœur de la crise grégorienne, moment d’investissement hagiographique à Toulouse comme ailleurs en Languedoc. On évoquera enfin l’évolution de sa légende jusqu’à la fin du Moyen Âge.
Présents : Mme Nadal, Présidente, MM. Scellès, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier, Cabau, Secrétaire général, Mme Napoléone, Secrétaire-adjointe, M. Péligry Bibliothécaire-archiviste ; Mmes Andrieu, Cazes, Fournié, Merlet-Bagnéris, Pradalier-Schlumberger, Watin-Grandchamp ; MM. Boudartchouk, Cazes, Garland, Garrigou Grandchamp, Lassure, Macé, Peyrusse, Testard, membres titulaires ; MM. Peloux et Rigault, membres correspondants.
Excusés : Mmes Balty, Lamazou-Duplan et Sénard ; MM. Balty, Marquebielle, Suzzoni et Tollon.
Notre Présidente présente l’ensemble des travaux reçus par la Société et indique les noms des membres chargés d’en rendre compte devant la Compagnie :
![]() Emmanuelle Meunier, Évolutions dans l’exploitation minière entre le second âge du Fer et le début de la période romaine dans le Sud-Ouest de la Gaule. Le cas du district pyrénéen à cuivre argentifère du Massif de l’Arize, doctorat, Université de Toulouse, 2018 – rapporteur : Vincent Geneviève ;
Emmanuelle Meunier, Évolutions dans l’exploitation minière entre le second âge du Fer et le début de la période romaine dans le Sud-Ouest de la Gaule. Le cas du district pyrénéen à cuivre argentifère du Massif de l’Arize, doctorat, Université de Toulouse, 2018 – rapporteur : Vincent Geneviève ;
![]() Célia Oulad El Kaïd, L’exploitation des matières osseuses au paléolithique inférieur et moyen : l’exemple de la grotte du noisetier (Fréchet-Aure, Hautes-Pyrénées), mémoire de master 1, Université de Toulouse, 2016 – rapporteur : Benjamin Marquebielle ;
Célia Oulad El Kaïd, L’exploitation des matières osseuses au paléolithique inférieur et moyen : l’exemple de la grotte du noisetier (Fréchet-Aure, Hautes-Pyrénées), mémoire de master 1, Université de Toulouse, 2016 – rapporteur : Benjamin Marquebielle ;
![]() Paul Saussez, Du sanctuaire païen au castrum comtal. Essai sur l’origine et l’évolution du bourg de Rennes-le-Château du IVe au XIIe siècles, chercheur indépendant, membre de la Société des Études de l’Aude – rapporteur : Jean-Luc Boudartchouk ;
Paul Saussez, Du sanctuaire païen au castrum comtal. Essai sur l’origine et l’évolution du bourg de Rennes-le-Château du IVe au XIIe siècles, chercheur indépendant, membre de la Société des Études de l’Aude – rapporteur : Jean-Luc Boudartchouk ;
![]() Margaux Lemaire, La famille Barrau. Parenté et réseaux à Toulouse (XIIe-XIIIe s), mémoire de master 2 (sous la direction de Laurent Macé), Université de Toulouse, 2018 – rapporteur : Patrice Cabau ;
Margaux Lemaire, La famille Barrau. Parenté et réseaux à Toulouse (XIIe-XIIIe s), mémoire de master 2 (sous la direction de Laurent Macé), Université de Toulouse, 2018 – rapporteur : Patrice Cabau ;
![]() Laura Viaut, « Fecimus concordiam ». Les mécanismes de gestion des conflits dans l’espace aquitain au Haut Moyen Âge (VIIIe-XIIe s.), doctorat, Université de Limoges, 2018 – rapporteur : Fernand Peloux ;
Laura Viaut, « Fecimus concordiam ». Les mécanismes de gestion des conflits dans l’espace aquitain au Haut Moyen Âge (VIIIe-XIIe s.), doctorat, Université de Limoges, 2018 – rapporteur : Fernand Peloux ;
![]() Pauline Bouchaud, Le chanoine limousin Étienne Maleu († 1322), historien de son église, doctorat, École Pratique des Hautes Études, 2018 – rapportrice : Michelle Fournié ;
Pauline Bouchaud, Le chanoine limousin Étienne Maleu († 1322), historien de son église, doctorat, École Pratique des Hautes Études, 2018 – rapportrice : Michelle Fournié ;
![]() Jean Berger, Droit, société et parenté en Auvergne médiévale (VIe-XIVe s.) : les écritures de la basilique Saint-Julien de Brioude, doctorat, Université de Lyon, 2016 – rapporteur : Jean-Luc Boudartchouk ;
Jean Berger, Droit, société et parenté en Auvergne médiévale (VIe-XIVe s.) : les écritures de la basilique Saint-Julien de Brioude, doctorat, Université de Lyon, 2016 – rapporteur : Jean-Luc Boudartchouk ;
![]() Lei Huang, L’abbatiale Sainte-Foy de Conques (XIe-XIIe siècles), doctorat, Université Paris 1 (sous la co-direction de Quitterie Cazes), 2018 – rapporteur : Emmanuel Garland ;
Lei Huang, L’abbatiale Sainte-Foy de Conques (XIe-XIIe siècles), doctorat, Université Paris 1 (sous la co-direction de Quitterie Cazes), 2018 – rapporteur : Emmanuel Garland ;
![]() Joséphine Obrecht, La communauté monastique de Conques, 801-1031 : échanges, liens sociaux, réseaux d’amitiés, mémoire de master, Université de Paris – rapportrice : Quitterie Cazes.
Joséphine Obrecht, La communauté monastique de Conques, 801-1031 : échanges, liens sociaux, réseaux d’amitiés, mémoire de master, Université de Paris – rapportrice : Quitterie Cazes.
L’ouvrage de Pierre Funk, Les Grandes Heures de Rabastens, 2018, n’a pas été accepté pour le concours, car il est publié ; il sera néanmoins pris en compte pour une éventuelle médaille d’encouragement.
Laurent Macé demande dans quelle mesure il sera possible d’apprécier le travail d’un master face à celui d’une thèse. Maurice Scellès répond que le problème se pose tous les ans et que la Société l’a toujours résolu. Il rappelle que nous avons la possibilité de donner des prix de la Société archéologique s’il faut récompenser plusieurs travaux.
Émilie Nadal remercie les rapporteurs pour le temps qu’ils consacreront à la lecture des travaux et à la rédaction de leur recension. Puis elle accueille Aymeric Rigault, nouvellement élu membre de notre Société. Elle donne ensuite la parole à Quitterie Cazes pour la lecture d’un compte rendu sur la candidature d’Oriane Pilloix. Oriane Pilloix est élue.
On poursuit par la lecture des procès-verbaux du 4 et du 18 décembre, adoptés avec un petit ajout.
La Présidente donne la parole à notre confrère Fernand Peloux pour sa communication : Exupère ou la fabrique d’un saint toulousain de l’Antiquité au Moyen Âge. Réflexion à propos d’un texte inédit d’un manuscrit de La Haye (XIe siècle).
Émilie Nadal remercie le conférencier et demande si l’identification d’Exupère sur la châsse du Musée Paul-Dupuy qu’il a présentée repose sur la présence du calice que le personnage tient dans la main, et si l’objet est daté. Fernand Peloux confirme que c’est l’attribut qui permet en effet de reconnaître l’évêque toulousain ; quant à la datation, la fin du XIIe ou le XIIIe siècle est la fourchette habituellement donnée par les historiens de l’art, mais la scène de la défense de la ville peut servir selon lui à situer la fabrication de l’objet après 1219. Dominique Watin-Grandchamp se demande s’il n’y a vraiment aucune possibilité de lire autrement la scène représentée sur la châsse. Michelle Fournié intervient à propos des peintures présentées et demande si la date qu’il a indiquée est bien celle de 1340. Fernand Peloux confirme cette information et renvoie à la publication de Melero Moneo sur le sujet.
Patrice Cabau revient sur la datation du manuscrit de La Haye, estimant que l’on pourrait en remonter la date au-delà du XIe siècle. Fernand Peloux n’est pas d’accord avec cette hypothèse : la présence des abréviations interdit une datation trop haute et le texte apparaît clairement postérieur au légendier de Moissac. Patrice Cabau compare ensuite ce passage du manuscrit de La Haye au texte du manuscrit 477 de Toulouse, notant qu’il y manque des mots et qu’il y a des fautes qui ne sont pas dans le manuscrit toulousain. Puis il invite notre conférencier à citer la donation de la Daurade aux Clunisiens en 1077, où se trouve la première mention médiévale toulousaine de saint Exupère, dans un rappel de la série des plus anciens évêques de Toulouse empruntée à l’Opuscule relatant la Passion et la Translation de saint Saturnin. Fernand Peloux remercie notre confrère pour cette information et ajoute qu’il lui reste encore à examiner les manuscrits hispaniques.
Daniel Cazes revient sur le reliquaire du Musée Paul-Dupuy et reconnaît que l’objet est mal connu et mal étudié ; il s’étonne d’ailleurs qu’une œuvre provenant des ateliers d’émaux de Limoges soit d’aussi mauvaise qualité. Il confirme que la datation donnée est la plus plausible et qu’aucun autre critère ne peut être utilisé. Il évoque les lectures qui ont pu être faites d’un des petits côtés de la châsse : une rencontre avec les représentants d’Ambroise ou encore Exupère présentant deux objets à la vente pour nourrir les pauvres après le passage des Vandales. Fernand Peloux remarque que cette lecture iconographique ne trouve aucun écho dans les récits médiévaux. Dominique Watin-Grandchamp propose au conférencier de consulter les authentiques du reliquaire, qui pourraient donner une image intéressante du personnage d’Exupère.
Au titre des questions diverses, Maurice Scellès nous présente un morceau de marbre trouvé dans une vigne près de Laure-Minervois (Aude) : il s’agit d’une plaque ornementale provenant d’un site de villa. Le décor se compose de petites feuilles ou fleurettes cruciformes telles que celles que l’on peut voir à Valentine et qui sont caractéristiques du IVe siècle. Daniel Cazes pense que le marbre pourrait bien provenir de Saint-Béat.

Séance du 18 décembre 2018 (séance privée)
Communication longue de Laurent Macé : » Aux origines du plain héraldique au XIIIe siècle : Aimeri III, vicomte de Narbonne ; Olivier III, seigneur de Termes« .
Lire le compte-rendu
Le dossier présenté permet de revenir sur les origines de l’adoption d’une forme héraldique assez rare dans le domaine des pratiques sigillaires, à savoir le plain, lequel se caractérise par sa totale monochromie. Deux exemples méridionaux de la première moitié du XIIIe siècle seront abordés : celui des armoiries portées par les vicomtes de Narbonne de la dynastie de Lara ; celui d’un seigneur des Corbières, le célèbre Olivier de Termes. Héraldique et sigillographie constituent, dans ces deux cas, des angles d’approche qui permettent d’interroger les questions d’identité, de mémoire et de représentation sociale.
Présents : Mme Nadal, Présidente, MM. Scellès, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier, Cabau, Secrétaire général, Mme Napoléone, Secrétaire-adjointe, Péligry, Bibliothécaire-archiviste ; Mmes Cassagnes-Brouquet, Cazes, Fournié, Jaoul, Sénard, Watin-Grandchamp, MM. Balty, Cazes, Garrigou Grandchamp, Macé, Peyrusse, Sournia, Surmonne, Testard, membres titulaires ; Mmes Balty, Krispin, Vène, MM. Penent, Suzzoni, membres correspondants.
Excusés : Mmes Czerniak et Haruna Czaplicki, MM. Marquebielle et Tollon.
Invité : M. Yoan Solirenne, étudiant en Histoire médiévale.
Notre Présidente ouvre la séance avec la lecture d’un courrier envoyé par Mme Annette Laigneau, faisant suite aux échanges signalés dans les procès-verbaux des 9 octobre et 6 novembre, et ayant pour objet les réunions programmées pour l’élaboration du secteur sauvegardé de la ville de Toulouse. Ce dernier message nous annonce qu’une autre association toulousaine ayant accepté les conditions de tenue de ces réunions, la présence de notre Société n’est plus nécessaire. Tout le monde y voit une réponse déguisée à l’affaire des morceaux de marbre de Saint-Sernin. Une telle riposte ne saurait en aucun cas affaiblir la vigilance de la Société à l’égard du patrimoine toulousain ou la dissuader de poursuivre son combat pour sa protection.
Émilie Nadal annonce qu’à la suite d’une demande de subventions pour la publication de nos Mémoires, la mairie nous alloue la somme de 4 000 euros.
Notre confrère Laurent Macé a apporté à la Société un mémoire de Master 2 qu’il a dirigé et qu’il propose pour le concours prochain. Il s’agit du travail de Margaux Lemaire, intitulé La famille Barrau, parenté et réseaux à Toulouse (XIIe-XIIIe siècles), soutenu en juin 2018.
Dans le cadre des acquisitions de notre bibliothèque, la Présidente signale :![]() l’achat du catalogue d’exposition Naissance de la sculpture gothique, 1135-1150, Saint-Denis, Paris, Chartres, Paris, 2018 ;
l’achat du catalogue d’exposition Naissance de la sculpture gothique, 1135-1150, Saint-Denis, Paris, Chartres, Paris, 2018 ;![]() le don par Maurice Scellès de deux ouvrages de Jean Duvernoy, Le registre d’inquisition de Jacques Fournier, Toulouse, 1965 (3 volumes), Le registre d’inquisition de Jacques Fournier (traduction), Paris, 1977 (trois volumes).
le don par Maurice Scellès de deux ouvrages de Jean Duvernoy, Le registre d’inquisition de Jacques Fournier, Toulouse, 1965 (3 volumes), Le registre d’inquisition de Jacques Fournier (traduction), Paris, 1977 (trois volumes).
Puis elle donne la parole à Maurice Scellès pour la lecture du compte rendu de la candidature d’Émeric Rigault comme membre correspondant de notre Société. Il est procédé au vote : Émeric Rigault est élu.
On passe ensuite à la lecture des procès-verbaux des deux séances précédentes, qui sont adoptés avec l’apport de quelques précisions.
La Présidente donne la parole à Laurent Macé pour sa communication longue : Aux origines du plain héraldique au XIIIe siècle : Aimeri III, vicomte de Narbonne ; Olivier III, seigneur de Termes .
Émilie Nadal remercie le conférencier et passe la parole à Patrice Cabau. Celui-ci déclare être d’accord de façon générale avec l’analyse faite par Laurent Macé, mais il se pose des questions au sujet du sceau de Sanche VI de Navarre, sur les types anciens de sceaux qui ne relèvent peut-être pas encore de l’héraldique : à un stade pré- ou protohéraldique, il peut être illusoire d’essayer de reconnaître des couleurs. Laurent Macé répond qu’on peut déjà parler d’héraldique à Barcelone en 1140 et qu’à cette époque, on n’est plus dans une période de transition. Dominique Watin-Grandchamp ajoute qu’à partir du moment où ces représentations deviennent l’identifiant d’un individu et que celui-ci s’en sert pour marquer des actes officiels, on n’est plus dans une représentation fantaisiste. Elle ne croit pas en l’existence d’une protohéraldique. En guise de réponse, Patrice Cabau promet à l’assemblée de faire un exposé sur le sujet. Concernant le jeu de mots à l’origine du plain d’Olivier de Termes, Dominique Watin-Grandchamp note encore que c’est le prénom qui a la référence héraldique et qu’en toute logique, c’est lui qui aurait dû être transmis ; or on remarque que ce n’est pas le cas. Pierre Garrigou Grandchamp observe enfin que l’origine de la figure du flying, figure dite « de cabriole » dans laquelle sont représentés les chevaux sur les sceaux, provient de la cavalerie de combat. Laurent Macé remercie notre confrère pour cette information.
La parole est donnée à Valérie Dumoulin pour une question portant sur une Enquête sur le commanditaire de trois manuscrits à Toulouse au XVe siècle .
Émile Nadal remercie notre nouvelle consoeur pour l’exposé de cette enquête et passe la parole à Patrice Cabau. Concernant la famille Buisson, celui-ci demande si la piste des Récollets (Sainte-Marie des Anges largement financée par Jean Buisson) a été explorée. Valérie Dumoulin répond qu’il ne s’agit pas de la même famille et ne connaît pas les armes de cette dernière. Elle fonde beaucoup d’espoir dans la visite de la maison des Buisson de la rue des Changes et cherche à savoir s’il existe des inventaires après décès. Sophie Cassagne-Brouquet lui propose de consulter les registres de notaires du quartier. Dominique Watin-Grandchamp fait remarquer que des éléments d’iconographie qu’elle a présentés pourraient également constituer une piste. Valérie Dumoulin confirme la prise en compte de ces éléments puisqu’elle explore la documentation portant sur les eaux et forêts.
La Présidente donne ensuite la parole au Trésorier pour une seconde question portant sur l’acquisition de deux œuvres par l’Union des Académies et Sociétés savantes de l’Hôtel d’Assézat :![]() une peinture à l’huile de H. Bouillère représentant la cour de l’Hôtel d’Assézat ;
une peinture à l’huile de H. Bouillère représentant la cour de l’Hôtel d’Assézat ;![]() un plâtre ou étude préparatoire de Jean Rivière pour la statue de Clémence Isaure ainsi que trois dessins préparatoires pour le même projet.
un plâtre ou étude préparatoire de Jean Rivière pour la statue de Clémence Isaure ainsi que trois dessins préparatoires pour le même projet.

Séance du 04 décembre 2018 (séance privée)
Communication longue de Jean-Charles Balty : « Le sarcophage aux époux de Quarante : typologie, décor et iconographie, datation, réemploi »
Lire le compte-rendu
 Consécutive à la visite de la Société archéologique du Midi de la France à Minerve et Quarante, le 16 juin dernier, la présente communication se propose de revenir sur le sarcophage dit « des flamines » de l’abbatiale Sainte-Marie de Quarante et sur l’atelier romain qui l’a produit, mais surtout sur l’iconographie de son médaillon central et sa signification, sur la date des transformations qui y ont été apportées et les véritables liens de ce monument avec l’abbaye.
Consécutive à la visite de la Société archéologique du Midi de la France à Minerve et Quarante, le 16 juin dernier, la présente communication se propose de revenir sur le sarcophage dit « des flamines » de l’abbatiale Sainte-Marie de Quarante et sur l’atelier romain qui l’a produit, mais surtout sur l’iconographie de son médaillon central et sa signification, sur la date des transformations qui y ont été apportées et les véritables liens de ce monument avec l’abbaye.

Présents : Mme Nadal, Présidente, MM. Scellès, Directeur, Ahsell de Toulza, Trésorier, Cabau, Secrétaire général, Mme Napoléone, Secrétaire-adjointe, M. Péligry, Bibliothécaire-archiviste ; Mmes Andrieu, Vallée-Roche, MM. Balty, Boudartchouk, Cazes, Sournia, Surmonne, Testard, membres titulaires ; Mmes Balty, Bossoutrot, Czerniak, Dumoulin, M. Rebière, membres correspondants.
Excusés : Mmes Cazes, Krispin, Pradalier-Schlumberger, MM. Darles, Penent, Peyrusse.
La Présidente ouvre la séance et rend compte ensuite de la correspondance « manuscrite ». Il s’agit pour l’essentiel d’un courrier de M. Didier Delhoume, Conservateur régional de l’Archéologie, qui propose le classement des deux statues-menhirs que notre Société possède dans ses collections. Cette offre suscite parmi la Compagnie diverses réactions : pour Nicole Andrieu, une telle mesure pourrait permettre de bénéficier, en cas de restauration, d’une éventuelle subvention ; pour Daniel Cazes, ces pièces appartiennent à la collection constituée par la Société archéologique, qui s’est, entre autres missions, donné celle de « collecter et conserver » des monuments du passé, ce qu’elle continue de faire ; pour Maurice Scellès, un classement de ces objets entraînerait pour un déplacement l’obligation de solliciter l’avis des Monuments Historiques, et de manière plus générale tous les inconvénients liés à une double gestion. Le Directeur juge en outre que la S.A.M.F. assure dans ses locaux la meilleure des protections, puis il rappelle que, si la Société venait à disparaître, ses collections seraient dévolues aux musées de la Ville de Toulouse. Par ailleurs, on se souvient de ce que les deux statues-menhirs en question ont déjà fait naguère l’objet d’une demande de mise en dépôt au Musée Fenaille de Rodez.
Passant à la correspondance « imprimée », Mme Nadal fait circuler un ouvrage offert pour notre bibliothèque, dont le texte a été rédigé par Mme Élodie Cassan : Les granges du Lot de la fin du Moyen Âge à la Révolution, série « Patrimoines du Lot », Luzech, 2018, 64 p.
La parole est à Jean-Charles Balty pour la principale communication du jour, intitulée Le sarcophage « aux époux » de Quarante (Hérault) : typologie, décor et iconographie, datation, réutilisation .
La Présidente remercie M. Balty pour l’enquête qu’il a menée sur l’étonnant sarcophage de Quarante, que nous avions découvert le 16 juin lors de notre journée foraine en Minervois. Son exposé captivant, qui a sans cesse ménagé le suspense, aboutit à des conclusions éclairantes.
Émilie Nadal ose une question de « novice » : qui étaient les flamines ? Jean-Charles Balty explique qu’il s’agissait de prêtres, et qu’il en existait plusieurs sortes : à Rome, très haut dans la hiérarchie, il y en avait six, consacrés au culte de Jupiter ; dans les colonies provinciales, comme Nîmes ou Narbonne, on trouvait des flamines (hommes) et des flaminiques (femmes) municipaux.
Daniel Cazes se dit fasciné par la démonstration magistrale de notre confrère : « C’est lumineux ! », puis il signale qu’en Languedoc la réutilisation de tombeaux venus d’Italie n’était pas chose rare. M. Balty ajoute que les sarcophages ainsi récupérés voyageaient par mer. Après quoi il fait observer que, malheureusement pour nous, les érudits se sont longtemps préoccupés des seules inscriptions, tel l’ingénieur narbonnais Pierre Garrigues autour de 1600, avant de s’intéresser aux monuments sculptés : le premier dessin du sarcophage de Quarante n’a été publié qu’en 1870 par l’archéologue biterrois Louis Noguier.
Maurice Scellès se demande si la signification du vêtement que porte le personnage masculin du médaillon était connue du commanditaire pour lequel le sarcophage a été remis en œuvre et le portrait retaillé. Jean-Charles-Balty répond par la négative. La signification de la toga picta, toge consulaire que l’on trouve représentée à partir du IIIe siècle, n’est effet jamais apparue clairement avant la publication, en 1990, d’une thèse allemande sur les toges.
Guy Ahlsell de Toulza s’interroge sur la coexistence d’un type de vêtement aussi particulier et emblématique avec un portrait en bosse non terminé. M. Balty note que l’inachèvement des portraits qui se constate sur nombre de sarcophages a été diversement interprété. Ainsi, à la fin des années 1930, Henri-Irénée Marrou y voyait-il l’indice d’une superstition, d’une crainte d’ordre magique à se faire représenter sur son monument funéraire…
Bernard Sournia hasarde quant à lui l’hypothèse qu’un tombeau préparé n’ait pu recevoir qu’au dernier moment la personnalisation laissée en attente.
Au titre des questions d’actualité, Jean-Louis Rebière et Anne Bossoutrot présentent une série d’observations qu’ils ont pu faire à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse : Nef raymondine : quelques découvertes récentes.
1. Sous le badigeon qui couvre actuellement les murs et les voûtes des trois travées se révèle une fausse coupe de pierre, datable du XVe siècle (sinon, par places, du premier quart du XVIIe).
2. Dans la troisième travée (la plus orientale), sur la paroi nord et sous l’enduit du XVe siècle sont apparus une peinture figurant une tête nimbée ainsi qu’un fragment d’inscription peinte (DOCT).
3. Dans les trois travées, les disques des « clefs de voûte » sont des éléments rapportés, fixés dans la maçonnerie par des tenons de fer.
4. Parmi les 24 chapiteaux visibles à la naissance des trois grands arcs doubleaux, certains sont des œuvres romanes remployées, d’autres sont des pastiches sculptés au début du XIIIe siècle.
5. À la base de la baie méridionale de la troisième travée, la maçonnerie actuelle a englobé la partie inférieure du meneau central de la baie du XIIIe siècle.
6. Dans la loge du carillonneur se trouvent remployés des éléments d’un plafond peint de l’époque de Louis XIV.
7. Au pied du pilier dit d’Orléans, l’accès au caveau des Riquet a varié selon les sols successifs, dallage puis pavement.
8. Dans la deuxième travée, dans la baie nord, existe un arc de décharge qui montre que l’obturation moderne de cette baie a pu n’être que partielle à un moment donné.
9. Plusieurs documents iconographiques permettent de restituer la disposition des tableaux qui se voyaient accrochés dans la nef au XIXe siècle.
La Présidente remercie les deux intervenants pour les nouveautés qu’il viennent de nous révéler, disant que la découverte de la peinture murale du XIVe siècle l’a tout particulièrement intéressée.
Jean-Louis Rebière précise à propos des fausses coupes de pierre que le décor du XVe siècle a dû être repris à la suite de l’incendie survenu en 1609. Une discussion s’engage entre Virginie Czerniak, Bernard Sournia et M. Rebière à propos de l’ambiguïté des expressions « fausse coupe de pierre », « faux appareil »…
Guy Ahlsell de Toulza s’enquiert du type de décor que pouvait présenter la nef de la cathédrale avant la simulation d’une maçonnerie de pierre. Jean-Louis Rebière évoque la peinture murale à personnage, mais il ne lui est pas possible d’en dire beaucoup plus ; en tout cas, il lui paraît exclu que la maçonnerie de brique n’ait pas été enduite dès le XIIIe siècle. Le projet de restauration s’oriente aujourd’hui vers la suppression du dernier badigeon et un retour à l’appareil simulé.
Nicole Andrieu voudrait savoir s’il est question de replacer des tableaux dans la nef. M. Rebière indique que tel serait le souhait de l’actuel clergé de la cathédrale.
Daniel Cazes déclare que l’observation faite sur les disques rapportés aux croisées des ogives des trois travées de la nef lui paraît très importante pour résoudre le problème posé par la datation de la sculpture qu’ils portent. En étudiant le décor sculpté de la « clef » médiane, il était en effet parvenu à la conclusion troublante que celui-ci présentait une grande analogie avec des œuvres du troisième atelier de la Daurade, mais il n’avait jusqu’ici pu s’expliquer la concordance stylistique et la discordance chronologique.

Séance du 20 novembre 2018 (séance privée)
Communication longue de Françoise Merlet-Bagnéris : « Le Montement de la cathédrale Saint-Étienne : architecture et mise en scène« .
Lire le compte-rendu
A partir du XIIIe siècle, les fondations de confréries en l’honneur de la Vierge se succèdent au monastère de la Daurade ; parmi elles celle de l’Assomption aurait été transférée de la Daurade à la cathédrale en 1487 par l’archevêque Pierre de Rousergue puis rétablie dans son lieu d’origine, donnant naissance alternativement à deux cérémonies rivales. Le Montement consistait, à Toulouse comme dans de nombreuses églises de la région, à élever une statue de la Vierge en majesté le 15 août au milieu des chants et de confrères déguisés en anges, apôtres, etc…, élévation précédée ou non par une procession dans la ville, la statue restant exposée plusieurs jours à la vénération des fidèles.
Le Montement consistait, à Toulouse comme dans de nombreuses églises de la région, à élever une statue de la Vierge en majesté le 15 août au milieu des chants et de confrères déguisés en anges, apôtres, etc…, élévation précédée ou non par une procession dans la ville, la statue restant exposée plusieurs jours à la vénération des fidèles.
Le but de cette communication ne sera pas de retracer l’histoire complexe des relations entre ces deux lieux de dévotion ; ce sera plutôt de découvrir ou redécouvrir par les images des locaux très difficilement accessibles : soit le siège de la confrérie de la cathédrale avec ses trois salles devenues réserves, soit l’étroit dédale de couloirs de la Daurade propre à des déplacements très limités.
Nous tenterons de restituer les autels, trappes, placards, coffres de vêtements, mobilier propres aux mises en scène, les cérémonies bien documentées de la cathédrale au XVIIe siècle surtout pouvant éclairer celles de la Daurade remises à l’honneur durant le dernier quart du XIXe siècle grâce à la protection du pape.
Avec leurs différences, elles prouvent la continuité d’une vénération toulousaine vivante jusqu’à une date proche.
Présents : Mme Nadal, Présidente, MM. Scellès, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier, Cabau, Secrétaire général, Mme Napoléone, Secrétaire-adjointe, M. Péligry Bibliothécaire-archiviste ; Mmes Andrieu, Cassagnes-Brouquet, Cazes, Fournié, Jaoul, Merlet-Bagnéris, Pradalier-Schlumberger, Watin-Grandchamp ; MM. Balty, Cazes, Garland, Julien, Peyrusse, Surmonne, Testard, Tollon, membres titulaires ; Mmes Balty, Czerniak, MM. Laurière, Penent, Suzzoni, membres correspondants.
Excusés : Mmes Dumoulin, Haruna-Czaplicki, Queixalós, Vallée-Roche, MM. Corrochano, Garrigou Grandchamp, Macé, Marquebielle, Sournia, Tollon.
Invité : M. Yves Faup, architecte retraité, professeur à l’École des Beaux-Arts, qui a participé avec Jean-Louis Rebière à la restauration de Saint-Étienne.
La séance commence avec l’annonce d’une triste nouvelle, celle du décès de Patrick Froidure.
Émilie Nadal donne ensuite la parole à la Secrétaire-adjointe pour la lecture du procès-verbal de la séance précédente, auquel Pascal Julien et Jean Penent désirent ajouter des détails ; cela se fera par échange de courriels.
La Présidente présente quatre ouvrages donnés par des membres à la bibliothèque de la Société :![]() Guy François, peintre caravagesque du Puy-en-Velay, de Bruno Saunier ;
Guy François, peintre caravagesque du Puy-en-Velay, de Bruno Saunier ;![]() The Prehistory of Bohemia, 7 volumes offerts par la Société archéologique de Prague, avec laquelle nous effectuons des échanges ;
The Prehistory of Bohemia, 7 volumes offerts par la Société archéologique de Prague, avec laquelle nous effectuons des échanges ;![]() Saint-Sernin de Toulouse, IXe centenaire, 1996 ;
Saint-Sernin de Toulouse, IXe centenaire, 1996 ;![]() Notre-Dame-la-Grande, de Robert Favreau et autres.
Notre-Dame-la-Grande, de Robert Favreau et autres.
Les deux derniers ouvrages ont été offerts par Jacques Surmonne.
Émilie Nadal donne enfin la parole à Françoise Merlet-Bagnéris pour une communication longue intitulée Le Montement à la cathédrale Saint-Étienne et à la Daurade : architecture et mise en scène .
La Présidente remercie notre consœur et regrette de n’avoir pas suivi cette « visite » de la Daurade et de Saint-Étienne. Elle demande si la Vierge présentée sur scène à la cathédrale était un vrai personnage ou s’il s’agissait d’une statue. La conférencière répond que de vrais personnages avaient été en effet mis en scène à Elche, mais qu’il s’agissait bien de statues à la Daurade et à Saint-Étienne. Nicole Andrieu remarque que ces Vierges avaient un rôle public ou privé, et que les femmes les sollicitaient notamment pour accoucher dans de bonnes conditions. Elle ajoute que le concile de Trente avait demandé l’arrêt de ces mises en scènes, qui relevaient plus de pièces de théâtre que de cérémonies religieuses. Guy Ahlsell de Toulza précise que, dans le cadre de l’Assomption de la Vierge, rien ne descendait des balcons aménagés pour le Montement, mais qu’on y hissait les statues. Il évoque par ailleurs la machinerie de l’église de Rabastens, dont on conserve le bail à besogne de 1482, et celle en usage dans la basilique Sainte-Marie d’Elche. Il souligne encore que ce ne sont pas des Vierges à l’Enfant qui étaient mises en scène, mais des statues de la Vierge Marie, élevées en position debout et non en gisantes. Il suppose alors que la confrérie du Montement utilisait des statues spécifiques pour ces cérémonies, qui pouvaient durer deux jours. Il confirme l’arrêt de ces spectacles à la fin du XVIIe siècle.
Pascal Julien rappelle qu’il existe à Saint-Étienne une Vierge allongée sculptée par Nicolas Bachelier. Elle correspond à la commande d’une Vierge avec angelot. Par ailleurs, le dispositif de machinerie avec rail a été refait à la suite d’un incendie.
Guy Ahlsell de Toulza et Françoise Merlet-Bagnéris se disent surpris par la présence de saint Paul à l’Assomption. Cette figuration existe pourtant répond Emmanuel Garland : on peut en trouver des exemples dès le XIIIe siècle.
Michelle Fournié note qu’il n’y a aucune continuité entre les processions de statues de saints de l’époque médiévale et l’apparition des confréries dont il a été question. Elle voudrait savoir cependant pourquoi la confrérie a quitté la Daurade pour s’installer à Saint-Étienne. Elle demande si l’on doit lier cet événement au contexte tumultueux de la fin du XVe siècle pour l’accession à l’archevêché. Françoise Merlet-Bagnéris répond qu’elle a eu beaucoup de mal à trouver des réponses dans les sources, abondantes pour Saint-Étienne mais très pauvres pour la Daurade. Sophie Cassagne-Brouquet signale que, concernant les troubles dans la ville, les archives du Parlement peuvent lui apporter des informations.
Maurice Scellès nous annonce son projet de présenter sur notre site Internet la médaille de la Société archéologique et fait un appel à contribution, notamment aux membres qui connaissent les archives des Beaux-Arts, pour retracer son histoire et celle de l’artiste qui l’a créée.
Émilie Nadal donne ensuite la parole à Virginie Czerniak pour une communication courte intitulée Le cosmos d’Aristote dans la basilique Saint-Sernin .
Le Moyen Âge chrétien connait parfaitement le cosmos : il a été créé par Dieu.
Le premier récit de la création inaugure la Genèse et relate les origines de l’univers qui déterminent son organisation harmonieuse et ordonnée servant de cadre aux fatalités de l’humanité. La cosmogonie chrétienne – de gonie, l’origine et kosmos, le monde – a hérité de la théorie pythagoricienne de l’harmonie des sphères que l’on retrouve chez Platon et surtout chez Aristote. Dans Le traité du ciel, écrit au IVe siècle avant notre ère, ce dernier décrit les planètes comme des sphères parfaites dont le mouvement circulaire uniforme est centré sur la Terre. Cette conception géocentrique de l’univers est parachevée au IIe siècle de notre ère par le mathématicien et astronome Ptolémée qui, avec son célèbre ouvrage Almageste, première véritable étude de cosmologie scientifique, impose le système aristotélicien. Celui-ci va prévaloir dans tout l’occident médiéval jusqu’au XVIe siècle, s’accordant en effet de façon pleinement satisfaisante avec la vision chrétienne d’une Terre au centre de l’univers. Ainsi défini, l’univers présente quatre caractéristiques principales : il est fini, sphérique, centré sur la Terre et il est divisé en un monde sublunaire (terrestre) et un monde supralunaire (céleste).
Géocentrisme et rose des vents
Ce dernier a été illustré dans la basilique Saint-Sernin de Toulouse. Dans une étroite galerie située au-dessus du collatéral nord extérieur de la basilique est conservée, sur la paroi méridionale de cet espace, une composition picturale modestement réalisée à l’ocre rouge sur un léger badigeon blanc . Elle s’organise en douze cercles concentriques parfaitement tracés (sans aucun doute au moyen d’un compas même si l’emplacement du point central n’est plus visible à ce jour), échelonnés à partir de la représentation centrale de la Terre. Celle-ci est lisiblement identifiable et divisée en trois parties nommément désignées : la moitié gauche de la sphère terrestre est Asia, le quart inférieur Europa et le quart supérieur Africa. Huit phases de la lune se succèdent sur la totalité du premier cercle, accompagnées de l’inscription globus lunae. Puis viennent sur les cercles successifs via mercurii, la trajectoire de Mercure, circulus veneris, le cercle de Vénus, casa solis, la résidence du Soleil, sfera martis, la sphère de Mars, puis celum iovos, le ciel de Jupiter. La planète Saturne est manquante et devait probablement se trouver au niveau supérieur de la composition aujourd’hui dégradé. Le huitième cercle est intégralement couvert d’étoiles sobrement signifiées par trois traits croisés et qui ne paraissent pas avoir été légendées. Ces cercles périphériques pourraient être considérés comme une représentation du Premier Moteur responsable pour Aristote de l’éternité du mouvement de l’univers et assure la révolution de l’ensemble des sphères cristallines, les orbes, sur lesquelles reposent les astres ainsi que l’Empyrée, séjour symbolique du divin.
La vision médiévale du monde céleste sous la forme d’un univers géocentrique n’est pas l’unique représentation conservée dans cet espace singulier. Dans la même travée et sur la même paroi prenait place une seconde composition circulaire également de grande taille dont il manque malheureusement aujourd’hui toute la partie supérieure. Ce qui subsiste autorise néanmoins une identification du sujet, qui n’avait pas été réellement compris jusqu’à maintenant . De précieuses inscriptions accompagnent une corne d’abondance peinte au centre de la partie inférieure de la bande circulaire. De cette corne très simplifiée sortent des traits destinés à évoquer le vent. On comprend cela à la lecture des deux mots encore lisibles respectivement au sommet de la corne – septentrio. – et le long de cette dernière – Boreas.
Borée est le dieu du vent du Nord dans la mythologie gréco-romaine et ce nom, complétant la désignation du septentrion, permet de comprendre que nous sommes en présence de la représentation d’une rose des vents telle qu’Aristote l’a conçue au chapitre VI de ses Météorologiques, intitulé « Position générale des vents, leur nombre, leurs dénominations » . D’autres inscriptions sont encore discernables sur la partie médiane de la bande circulaire, du côté droit, associées à des traces de traits laissant penser qu’un autre vent était ainsi désigné, celui de l’Ouest en toute logique, Zéphyr frère de Borée, puisque le nord est ici positionné dans le bas de la composition. Cela étant, nous ne sommes pas en mesure de déchiffrer précisément ces éléments et il faut pour l’heure se contenter de la seule identification du vent du Nord.
Un témoignage de la vie intellectuelle toulousaine médiévale
Qu’en est-il de ces peintures ? Sommes-nous, comme cela a pu être suggéré, dans un espace dédié à l’enseignement au sein de la basilique Saint-Sernin ? Nous ne le croyons pas. D’un point de vue pratique tout d’abord, il paraît très difficilement envisageable, en raison de l’inaccessibilité des lieux, que l’on puisse y avoir organisé des classes même avec un nombre restreint d’auditeurs. Par ailleurs, aucune source ne nous assure que Saint-Sernin ait bien été un lieu d’enseignement et même si dans l’absolu les édifices cultuels ont cette fonction au Moyen Âge, cela ne suffit pas à en défendre ici l’idée.
Il convient de préciser que le monde céleste et la rose des vents sont associés à d’autres éléments peints. Sur la même travée, un semis d’étoiles, succinctement réparties autour de fausses nervures d’ogives fort maladroites, se développe sur le demi berceau qui couvre la galerie, tandis que des vestiges, à l’état de fantômes, sont repérables sur la voûte en berceau plein cintre du couloir bas par lequel on accède à ladite galerie. Ces traces n’ont pas toutes le même degré de lisibilité mais les mieux conservées ont été réalisées à l’ocre rouge sur un badigeon de chaux blanc, autorisant à envisager une exécution concomitante à nos représentations à caractère cosmologique. Cet ensemble peint aurait-il alors une vocation décorative ? Dissimulé à la vue du plus grand nombre, il se limite à une travée de cet espace annexe sans aucun lien avec les parties emblématiques de la basilique .
Peut-être peut-on se disposer alors à y voir l’expression personnelle d’un chanoine féru d’astronomie et d’Aristote, désireux de partager ses connaissances avec certains de ses pairs et d’échanger avec eux sur ces questions cosmologiques. Quoi qu’il en soit, ces peintures, pour modestes qu’elles soient, sont un précieux témoignage en images de la vie intellectuelle toulousaine au moment où l’on redécouvre, par le biais de traductions arabo-latines, la totalité du corpus aristotelicum.
Au regard de leurs caractéristiques plastiques et graphiques, ces compositions peintes sont attribuables au XIIIe siècle. En 1210 le synode de Paris promulgua l’interdiction d’enseigner les livres de philosophie naturelle d’Aristote. Cet interdit fut officiellement levé à partir de 1255 avec l’adoption de tous les écrits du philosophe grec inscrite dans les statuts de la faculté des arts de Paris. Toutes les universités européennes suivirent alors celle de Paris faisant des écrits d’Aristote la base de leur enseignement philosophique. Les ouvrages scientifiques d’Aristote prohibés à Paris ne le furent pas à Toulouse et la toute jeune université méridionale, dont la création avait été entérinée par le traité de Meaux-Paris de 1229, put probablement bénéficier dès ses origines de ces textes fondamentaux. On peut néanmoins proposer de voir dans les peintures de Saint-Sernin un témoignage du renouveau aristotélicien qui toucha l’ensemble du monde chrétien occidental dans la seconde moitié du XIIIe siècle.
Émilie Nadal remercie Virginie Czerniak de nous avoir tenus informés de cette étude récente qu’elle a publiée dans la revue Midi-Pyrénées Patrimoine. Maurice Scellès avoue ne pas être totalement convaincu par l’interprétation que la conférencière fait de ces peintures. Il trouve en effet le motif peint du Cosmos soigné et réfléchi, loin à son sens du lieu de « révision » qu’elle évoque. Par ailleurs, ajoute Daniel Cazes, ce lieu n’est pas isolé et clos. Il est à son avis un passage réservé entre le palais abbatial et le transept, donc un lieu de passage de l’abbé. Dominique Watin-Grandchamp propose de raccorder ce décor à celui qui se trouve sur les parois de l’escalier bâti dans l’épaisseur du mur du bras nord du transept. Olivier Testard met enfin notre conférencière en garde quant aux affirmations concernant les interdictions faites sur les textes d’Aristote. En effet, les théories du philosophe grec ont toujours été présentes dans la pensée médiévale, et il n’y a eu que des interdictions de propositions.
Enfin, au titre des questions diverses, Patrice Cabau intervient à propos de plusieurs fragments de colonne de marbre apparus au début du mois de novembre parmi les matériaux qui sont entreposés à l’est du chevet de la basilique Saint-Sernin. Après notre séance du 6, il en avait parlé à Daniel Cazes, en lui demandant d’aller voir. Le lendemain 7, en se rendant sur place afin de prendre des photographies, il a constaté que ces éléments avaient été déplacés. L’un d’entre eux, qui avait été mis au sommet d’un tas de pièces de grès (provenant du mur bahut qui supportait la grille sud du jardin de Saint-Sernin), avait basculé et s’était fracassé en tombant sur le banc en granit situé en contrebas : il n’en est plus resté que des débris. Deux autres fragments lapidaires, abîmés eux aussi par les manutentions, ainsi que l’indiquaient des éclats épars, ont encore une longueur approchant 0,80 m (75 et 78 cm environ). Le matériau est un marbre pyrénéen, blanc veiné de gris foncé, très saccharoïde, devenu friable. La colonne originelle, manifestement antique, devait être d’un bon diamètre (apparemment plus de 0,50 m). Les deux grands éléments subsistants proviennent d’une remise en œuvre ancienne, comme le montre l’évidement piqueté visible sur leur face interne.
Daniel Cazes donne quelques précisions sur ce triste épisode. Il s’est informé par deux fois auprès de son deuxième successeur à la conservation du Musée Saint-Raymond et de la basilique Saint-Sernin. La première fois, il lui a signalé ce morceau de colonne transformé par creusement en couvercle, alors qu’il était encore sur le tas de pierres de l’enclos du chantier, face à la Bourse du Travail, en lui demandant de le faire récupérer pour le Musée des Antiques et le futur musée de l’œuvre, étant donné son intérêt pour l’histoire du site de Saint-Sernin. La conservatrice lui répondit en avoir parlé au responsable de la cellule archéologique de Toulouse, qui lui apprit qu’il s’agissait d’un élément de la couverture d’une tombe maçonnée, aménagée, vers l’Est, entre le massif du portail Miègeville et le contrefort suivant. Il devait enlever ce vestige lapidaire et le mettre dans le dépôt archéologique de son Service métropolitain d’archéologie. Ayant constaté que cela ne s’était pas fait et que ce marbre, tombé du tas sur lequel il était, s’était fracassé en plusieurs morceaux et une multitude d’éclats, Daniel Cazes reprit contact avec la conservatrice pour que l’on agisse rapidement avant que tous ces morceaux éparpillés ne disparaissent définitivement avec les pierres stockées là. Elle s’en est immédiatement occupée et les principaux morceaux, mais pas tous, furent enfin disposés sur une palette pour leur transport vers le dépôt.
Daniel Cazes ajoute qu’il avait déjà remarqué en septembre qu’une pelle mécanique avait bouleversé le secteur proche de la porte Miègeville, vers l’Est, et qu’il y avait vu de menus fragments de marbre mélangés avec les gravats et terres environnants, ce qui l’avait évidemment choqué, au pied d’un portail qui est un chef-d’œuvre absolu de l’art roman. Il rappelle que les conditions dans lesquelles se déroule ce grand chantier ne permettent pas de sauvegarder les couches supérieures du site archéologique, où l’on a creusé en de nombreux endroits des trous et tranchées profonds, alors que l’on aurait dû procéder à une fouille dans les règles de l’art, autour d’un des premiers grands monuments historiques classés de France. Ainsi a-t-on déplacé beaucoup de terre archéologique (truffée de tessons de céramique et autres fragments) dans l’aire de l’ancien cloître roman, en creusant des tranchées de fondation immédiatement remplies de béton et de systèmes électriques sur l’emplacement supposé des murs bahuts de l’ancien cloître. Que l’on intervienne ainsi et aussi rapidement sur le site d’un cloître majeur de l’art roman en Occident le surprend toujours et n’est pas digne d’une ville d’art comme Toulouse. Que pourra-t-on penser dans le reste du pays et en Europe de cette pratique aussi peu respectueuse du patrimoine ?

Séance du 06 novembre 2018 (séance privée)
Communication longue de Jean Penent :« Les fantômes de la Renaissance toulousaine ».
Lire le compte-rendu
Des peintures à jamais perdues des artistes des XVe et XVIe siècles, ont été conservées quelques traces, à travers de modestes mais précieuses reproductions que nous allons découvrir ou redécouvrir. Elles ont été réalisées par Jean Chalette, Hilaire Pader, Jean-Pierre et Antoine Rivalz…



Présents : Mme Nadal, Présidente, MM. Ahlsell de Toulza, Trésorier, Cabau, Secrétaire général, Mme Napoléone, Secrétaire-adjointe, Péligry, Bibliothécaire-archiviste ; Mmes Haruna-Czaplicki, Jaoul, Merlet-Bagnéris, Pradalier-Schlumberger, Watin-Grandchamp, MM. Cazes, Julien, Peyrusse, Sournia, Tollon, membres titulaires ; Mmes Jiménez, Joy, Vène, MM. Marquebielle, Penent, Suzzoni, membres correspondants.
Excusés : Mmes Balty, Czerniak, Queixalós et Sénard ; MM. Balty, Garland, Garrigou Grandchamp, Macé, Scellès et Surmonne.
La parole est donnée à la Secrétaire-adjointe pour la lecture des procès-verbaux des deux premières séances. Ceux-ci sont adoptés après l’ajout de quelques précisions.
Valérie Dumoulin est élue membre correspondant.
Émilie Nadal donne ensuite la parole à notre confrère Jean Penent pour une communication longue intitulée, Les fantômes de la Renaissance toulousaine.
En remerciant le conférencier, elle note que les fantômes qu’il évoque sont heureusement bien évocateurs. Dominique Watin-Grandchamp fait remarquer que l’on doit à Bernadette Suau d’avoir fait racheter par les Amis des Archives départementales un certain nombre de miniatures des Annales disparues, actuellement conservées aux Archives municipales. Par ailleurs, concernant les peintures de Saint-Sernin, elle avoue ne pas être convaincue par l’interprétation qu’il donne de l’intervention du peintre Rolin et par l’affirmation que ce n’est pas Dieu le Père qui est représenté. Pascal Julien reconnaît l’importance du sujet et regrette de n’avoir pas pu le traiter à l’occasion de l’exposition sur la Renaissance qu’il a dirigée l’année précédente, cela n’ayant pas été possible faute de place. Il annonce toutefois que ce beau sujet fait partie d’une thèse aujourd’hui en cours. L’enluminure de Marmottan Monet dont il a été question a pu figurer dans le catalogue, mais il n’a pas été possible de la faire venir pour l’exposition, la dation dont elle est issue excluant toute possibilité de prêt. On sait par ailleurs que de nombreuses œuvres sont dispersées dans des collections particulières : tout n’a donc pas été brûlé à la Révolution. Pascal Julien met en garde le conférencier sur les confusions possibles entre les peintres Antoine de Raulin et Nicolas Rolain, piste qu’il a déjà suivie. Il revient ensuite sur l’iconographie de la voûte de Saint-Sernin et sur la question du Père sous les traits du Fils, chère à Marcel Durliat, nous renvoyant à ce qu’il a écrit sur le sujet dans sa thèse. Jean Penent répond que Renée de France, fille de Louis XII, épouse du duc de Ferrare Hercule d’Este, écrit en 1528 aux capitouls pour leur recommander le peintre « Nicolas Raulin ». Celui-ci est reçu avec honneur à Toulouse et dispensé de chef-d’œuvre en 1530 pour être admis à la maîtrise, c’est-à-dire pour obtenir le droit d’exercer son métier à Toulouse. [Il est témoin en 1531 de François Malcorresa pour le chef-d’œuvre que celui-ci doit exécuter d’après un modèle : un Dieu le Père sur son trône.] En 1536, il reçoit enfin 18 écus d’or pour avoir fourni le modèle des peintures de la voûte du chœur de Saint-Sernin. Que faisons-nous de tous ces éléments ? La peinture en question présente un personnage qui possède le visage traditionnel du Christ, il est assis sur un trône, inscrit dans la mandorle, il présente le livre de la main gauche et dresse verticalement la main droite (on voit mal la position de ses doigts qui devrait indiquer à la fois sa double nature divine et humaine, et le signe de la Trinité). Il est entouré des symboles des Évangélistes. N’est-ce pas là l’image même du Christ en majesté, le Christ qui évoque en même temps la figure de Dieu le Père ? [Ce sujet complexe sera désigné dans les documents par une synecdoque : « Dieu le Père ».]
Pascal Julien précise que tout est conforme au contrat, la peinture moderne ne faisant que remplacer la peinture romane qui était à cet endroit-là et qui représentait déjà « un grand Dieu le père avec quatre évangélistes », selon une description antérieure aux travaux. De plus, on ne peut soupçonner aucune dérive d’interprétation dans la rédaction du contrat ni d’exécution des peintures, car celle-ci fut surveillée de près par les chanoines, notamment pour l’orthodoxie de l’iconographie. [Quant à la confusion entre Nicolas Rolain, reçu maître en 1530, et Antoine de Rolin, qui est payé très cher en 1536 pour affiner des dessins à Saint-Sernin, elle est impossible à faire car elle n’est pas conforme aux textes qui distinguent clairement ces deux personnages.]
Patrice Cabau intervient à propos de l’attribution à Laurent Robyn (alias Roby, Robi, Robin, ou Robini) des figures qui ornent l’ouvrage de Guillaume de Catel consacré à l’Histoire des Comtes de Tolose. Il y a là pour lui un raccourci assez peu exact, qu’ont accrédité les assertions approximatives de divers auteurs.
Sur mandat du 10 décembre 1491, le peintre toulousain Laurent Robyn reçut 9 livres tournois per la istoria qu’a fayta en lo libre de las istorias en lo qual libre son istoriatz totz los contes de la present villa de Tholoza. Dans le Livre des Histoires (devenu le premier registre des Annales manuscrites), sur deux feuillets en vis-à-vis, la miniature précédant la chronique de l’année capitulaire 1490-1491 illustrait la généalogie (en grande partie supposée) de ces comtes, avec leurs effigies enluminées « dans un même tableau, avec l’abrégé de leur vie, écrit en caractère gothique, & en langage gascon ». Ce tableau, « un des plus précieux qui soient dans ces Registres » selon Jean Raynal, a disparu depuis l’autodafé du 10 août 1793.
Un peu avant 1600, le Président aux Enquêtes Matthieu de Chalvet (1528-1607), comme beaucoup de parlementaires grand amateur d’ouvrages anciens, fit voir au conseiller Guillaume de Catel (1560-1626) « vn ancien Liure manuscrit » contenant « les noms, & les effigies des Comtes de Tolose, auec vn sommaire, ou eloge fort petit, de ce qu’ils ont faict, & combien de temps ils ont tenu la Comté : il est en langage Tolosain ».
Jacques de Chalvet lui ayant offert l’album précédemment possédé par son grand-père, Guillaume de Catel le fit reproduire à la suite de son Histoire, imprimée in-folio en 1623 : Les Comtes de Tolose. Auec leurs pourtraits tirez d’vn vieux liure manuscrit Gascon. « Les Comtes de Tolose y sont en l’ordre, & en la forme que ie les ay faict representer ; sauf que dans l’ancien Liure les pourtraicts sont illuminez de diuerses couleurs ». Les dix gravures en taille-douce, certaines signées par Huguet et d’autres par Jean Étienne Lasne, ont été mises en couleurs dans l’exemplaire de l’auteur, qui le fit relier à ses armes.
Catel assure que la série des comtes était la même dans son album que dans le registre de la maison de Ville, où leurs portraits se voyaient « en petit volume », et Germain de Lafaille témoigne que le tableau des Annales représentait les comtes « conformes pour les habitudes [lire habits] au manuscrit gascon rapporté par Catel ».
Il y avait cependant une différence notable entre le tableau de Robyn peint au Livre des Histoires et la suite des images imprimées reproduisant la galerie des figures de l’album manuscrit : on était passé d’une page (41 cm x 27 cm) double à dix pages (34 cm x 21 cm), soit une multiplication par plus de trois de la surface utile maximale. Sauf à douter de la fidélité des œuvres d’Huguet et de Lasne, il faut concevoir que l’album qu’ils ont copié était issu d’une recomposition des miniatures originelles.
Sur les gravures imprimées, les personnages sont mis en scène dans des décors d’architecture, les uns posés sur des socles, d’autres comme « en lévitation », ainsi que François Bordes l’a noté pour deux d’entre eux. Si leurs costumes peuvent appartenir à la fin du XVe siècle, les ordonnances et les ornements des arrière-plans évoquent plutôt le milieu du XVIe, moment probable de la réalisation du manuscrit publié par Catel.
[Jean Penent répond que les gravures aient été exécutées d’après la miniature des Annales ou d’une réplique « identique » présentée en album ne change rien à son propos.]
Émilie Nadal donne ensuite la parole à Magali Vène, qui nous informe qu’une enluminure d’Antoine Olivier provenant de l’antiphonaire de Mirepoix a été mise en vente. Il s’agit d’une Crucifixion, et son prix est très élevé (96 500 euros).
Enfin, au titre des questions diverses, Guy Ahlsell de Toulza nous montre avec de nombreuses illustrations l’avancement de l’extraordinaire chantier de restauration du château de Bournazel (Aveyron). Pascal Julien partage l’enthousiasme de notre confrère, se réjouissant des nombreuses questions que pose une telle entreprise, notamment d’ordre déontologique. Il avoue cependant que certaines choses lui paraissent dérangeantes. Dans le suivi de chantier, il n’est jamais question de fouilles archéologiques, alors que de nombreuses excavations sont pratiquées. Par ailleurs, il regrette que la surveillance du chantier par l’Architecte honoraire, M. Voinchet, soit un peu lointaine. Louis Peyrusse note que les chantiers de restitution d’édifices de cette ampleur, rares en France, se pratiquent couramment en Europe centrale et en Russie. Bruno Tollon rappelle que les restaurations du château de Bournazel s’appuient sur une documentation faite de dessins et de descriptions, et sur la découverte de vestiges d’architecture comme les bases de pilastres géants. Le portail inférieur a fait par ailleurs l’objet de restaurations visibles à partir des éléments conservés en mauvais état. Pascal Julien précise que, s’agissant des réserves qu’il a exprimées, il ne tient bien sûr en aucun cas les propriétaires pour responsables ; il trouve d’ailleurs admirable de s’être lancé dans un tel projet et il a tenu à donner une place à ce monument et à sa restauration dans l’exposition sur la Renaissance. Il précise par ailleurs que tous les travaux ont été fait de façon légale sous l’égide des Monuments Historiques et que les entreprises qui y travaillent sont exemplaires.
Daniel Cazes revient sur l’aspect financier de l’entreprise : il s’agit d’un monument privé ayant reçu des subventions publiques importantes et qui aurait dû, selon lui, bénéficier de fouilles archéologiques.

Séance du 23 octobre 2018 (séance privée)
Communication longue de Xavier Barral i Altet : « La translation d’une relique de Saint Bertrand à Saint-Bertrand-de-Comminges en septembre 1733 : ce qu’elle nous apprend sur le Moyen Âge ».
Lire le compte-rendu
 Les translations de reliques constituent une pratique liturgique, populaire et identitaire, très fréquente pendant le Moyen Age et jusqu’à nos jours. Il s’agit de cérémonies qui engagent la communauté des chrétiens, générant de grands évènements de foule, qui sont source de foi, mais aussi d’économie. Les miracles qui accompagnent des déplacements à courte ou longue distance font l’objet de récits augmentés de légendes. Les fidèles veulent s’approcher du corps saint lors de son passage, et toucher la chasse, coffre ou reliquaire anthropomorphe qui contient les reliques. Une relation du XVIIIe siècle décrit un transfert de reliques de saint Bertrand à Saint-Bertrand de Comminges en 1733 et permet de rendre visible un événement qui dure plusieurs jours et qui nous fait revivre le Moyen Age.
Les translations de reliques constituent une pratique liturgique, populaire et identitaire, très fréquente pendant le Moyen Age et jusqu’à nos jours. Il s’agit de cérémonies qui engagent la communauté des chrétiens, générant de grands évènements de foule, qui sont source de foi, mais aussi d’économie. Les miracles qui accompagnent des déplacements à courte ou longue distance font l’objet de récits augmentés de légendes. Les fidèles veulent s’approcher du corps saint lors de son passage, et toucher la chasse, coffre ou reliquaire anthropomorphe qui contient les reliques. Une relation du XVIIIe siècle décrit un transfert de reliques de saint Bertrand à Saint-Bertrand de Comminges en 1733 et permet de rendre visible un événement qui dure plusieurs jours et qui nous fait revivre le Moyen Age.

Présents : Mme Nadal, Présidente, Scellès, Directeur, Cabau, Secrétaire général, Mme Napoléone, Secrétaire-adjointe, Péligry, Bibliothécaire-archiviste, Ahlsell de Toulza, Trésorier ; Mmes Cassagnes-Brouquet, Cazes, Fournié, Haruna-Czaplicki, MM. Cazes, Garland, Garrigou Grandchamp, Lassure, Macé, Peyrusse, Sournia, Surmonne, Testard, membres titulaires ;
Mmes Czerniak, Sénard ; MM. Barral i Altet, Pousthomis, membres correspondants.
Excusés : Mmes Merlet-Bagnéris et Watin-Grandchamp, MM. Julien et Tollon.
Invités : Mme Catherine Réty, professeur en classes préparatoires au lycée Pierre-de- Fermat, Mme Oriane Pilloix et M. Emeric Rigault, doctorants en Histoire de l’art à l’université de Toulouse II – Jean-Jaurès.
La Présidente souhaite la bienvenue à notre nouveau confrère Xavier Barral y Altet et aux invités de cette séance, avant de demander la lecture des deux derniers procès-verbaux de l’année académique précédente ; ceux-ci sont adoptés par l’assemblée. Maurice Scellès précise que le procès-verbal de la séance foraine de Minerve est déjà en ligne, de façon à soutenir rapidement notre consœur Marie Vallée-Roche, qui œuvre en faveur de la sensibilisation au patrimoine de ce site, ainsi que la mairie de Quarante dans son action patrimoniale.
L’assemblée se réjouit d’apprendre que l’Académie de Carcassonne s’est enfin dotée d’un nouveau logo.
Énumérant le courrier adressé à notre Société, la Présidente nous donne lecture d’une lettre de remerciement de l’association de sauvegarde de l’abbaye de Grandselve et de son Président M. Froidure. Nous projetons d’organiser une séance foraine sur ce site au printemps prochain. Émilie Nadal nous annonce également que deux de nos invités, Oriane Pilloix et Émeric Rigault, nous ont envoyé une lettre de candidature pour devenir membres correspondants de notre Société. Puis elle nous présente quatre ouvrages donnés à notre Bibliothèque :![]() cinq volumes sur Saint-Bertrand-de-Comminges (don de Jean-Louis Rebière) ;
cinq volumes sur Saint-Bertrand-de-Comminges (don de Jean-Louis Rebière) ;![]() Les heures de Rabastens (don de Guy Alshell de Toulza) ;
Les heures de Rabastens (don de Guy Alshell de Toulza) ;![]() La céramique dans le territoire industriel de Martres-Tolosane à partir du XVIe siècle (don de Stéphane Piques) ;
La céramique dans le territoire industriel de Martres-Tolosane à partir du XVIe siècle (don de Stéphane Piques) ;![]() L’abbaye de Lagrasse. Art, archéologie et histoire (don de Nelly Pousthomis).
L’abbaye de Lagrasse. Art, archéologie et histoire (don de Nelly Pousthomis).
Maurice Scellès nous fait part ensuite de la décision du Bureau de modifier les dates de remise des travaux pour le concours indiquées sur le règlement intérieur. Il propose de les préciser chaque année sur la rubrique de notre site internet en fonction du nombre de candidats déjà présentés. Quitterie Cazes propose de mettre d’emblée la date limite au 10 janvier ; l’assemblée approuve cette proposition.
Émilie Nadal donne enfin la parole à Xavier Barral i Altet pour une communication intitulée La translation d’une relique de Saint-Bertrand à Saint-Bertrand-de-Comminges en septembre 1733 : ce qu’elle nous apprend sur le Moyen Âge.
La Présidente remercie notre confrère et lui demande quelle est la part de mythe dans le texte qu’il nous a présenté. Xavier Barral i Altet répond qu’il le croit parfaitement fidèle car les justifications apportées sont nombreuses. La longueur du récit de la translation, plus de cent pages, en fait par ailleurs un texte précis dans lequel est rapporté le nom de tous les témoins. En rappelant l’ouverture des châsses-reliquaires de Saint-Sernin, Michelle Fournié ajoute que ce type de cérémonie peut aussi être vécu de nos jours. Si on devine le Moyen Âge à partir de ce texte du XVIIIe siècle, demande Louis Peyrusse, quelle est la part de chacune de ces deux époques ? Le conférencier répond que le choix qu’il a fait de ce texte a été guidé par les fortes ressemblances qu’il y a reconnues avec ceux du Moyen Âge et qui dénotent une grande continuité. Jean-Michel Lassure évoque le site proche de L’Isle-Jourdain où sont passées les reliques ; il précise que les vestiges d’une église romane y ont été trouvés, mais que le résultat des fouilles n’a malheureusement pas été publié.
Pour rebondir sur l’histoire immobile dont ce texte semble être un témoignage, Daniel Cazes évoque la matérialité de ces cérémonies en se référant aux trésors des églises. Prenant l’exemple de celui que conservait Saint-Sernin, il regrette que l’oubli ait engendré l’abandon ou la disparition de nombreux objets durant une période que l’on peut situer entre 1880 et 1970. Xavier-Barral i Altet confirme le fait en évoquant le cas de la cathédrale du Puy-en-Velay.
Maurice Scellès demande des précisions sur le contexte de la publication du livre contenant ce texte, mais notre confrère avoue ne pas s’être penché sur la question. Emmanuel Garland fait observer que, la cité de Saint-Bertrand-de-Comminges ayant perdu son lustre au XVIIIe siècle, seul le culte de saint Bertrand pouvait maintenir les chanoines en place : c’est dans ce contexte qu’il faut sans doute imaginer la publication de ce livre. Patrice Cabau évoque le temps long et les témoignages sur le culte des reliques, qui paraît attesté dans la région de Saint-Bertrand-de-Comminges dès le IVe siècle. Xavier-Barral y Altet ne pense pas qu’il y ait eu là des particularités locales : on relève au contraire que cela se passait partout de la même façon.
La Présidente donne la parole à Guy Ashlell de Toulza, qui nous annonce, au titre des questions diverses, l’achat par l’Union des Académies d’un portrait de capitoul en pied : il s’agit d’Étienne Besset, capitoul en 1645, peint par Antoine Durand sur une toile de 2,02 m x 1,13 m. Il nous présente ensuite les armoiries de la ville de Toulouse, peintes au XVIIe siècle sur une planche qui a dû faire partie d’un décor de fête ou de cérémonie. Les deux peintures ont été acquises à Clermont-Ferrand.

Journée foraine du 13 octobre 2018 : à Lagrasse
Journée foraine à Lagrasse, samedi 13 octobre 2018, 10h-17/18h.
Lire le compte-rendu
Visite du bourg et de la maison du patrimoine sous la conduite de Julien Foltran. A 11h visite de l’abbaye du côté des chanoines sous la direction de Nelly Pousthomis, puis après le déjeuner, reprise de la visite du bourg, puis de l’abbaye, cette fois du côté du Conseil départemental.
L’abbaye de Lagrasse s’élève dans la vallée de l’Orbieu, dans le nord du massif des Corbières, à 35 km au sud-est de Carcassonne. Fondée par Charlemagne sur la base d’un ermitage sous l’autorité de Nimfridius, compagnon de Benoît d’Aniane, elle bénéficie d’un fonds documentaire exceptionnel et continu, et offre un remarquable ensemble, vaste et complexe, de constructions échelonnées dans le temps et dans l’espace, scindées en deux propriétés distinctes depuis la Révolution. Sur la rive droite de l’Orbieu, le village conserve plusieurs dizaines de maisons des XIIIe et XIVe siècles, ainsi que des édifices remarquables comme le pont vieux, l’église paroissiale, la halle.
Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires culturelles, du Département de l’Aude, de la SCI Abbaye de Lagrasse et de la municipalité de Lagrasse, une équipe interinstitutionnelle de chercheurs a mené un programme collectif de recherche centré sur l’abbaye, sous ses aspects historiques, architecturaux et archéologiques (2007-2012, Universités de Provence-LA3M, Montpellier3 et Toulouse-Jean Jaurès -TRACES et Framespa-Terrae), puis, plus largement, sur le bourg et le terroir (2013-2017, Université de Toulouse-Jean Jaurès, TRACES et Framespa-Terrae).
L’équipe a mené des recherches en archives, réalisé un grand nombre de relevés, conduit une étude architecturale avec les méthodes de l’archéologie du bâti, effectué des campagnes de sondages, de fouilles et de prospections radar dans les bâtiments et dans l’enclos monastiques ainsi que dans le bourg, et des prospections pédestres dans le terroir. Elle a, tout au long de ces années, assuré un suivi des travaux menés dans l’ensemble du complexe monastique et dans l’espace urbain. Outre les rapports annuels, une publication a dressé en 2013 un premier bilan du travail accompli. Divers articles sont prévus pour rendre compte des avancées et découvertes depuis cette date.
L’abbaye conserve de rares témoins de constructions des 9e-10e siècles, un bras de transept des années 1050 et des sculptures erratiques du 12e s. Une grande campagne de travaux a été menée par l’abbé Auger de Gogenx (1276-1309) à qui l’on doit non seulement une chapelle abbatiale peinte et sculptée mais aussi une refonte complète du palais abbatial, une reconstruction du cloître et du dortoir. L’église a été en grande partie rebâtie à l’époque gothique, probablement vers la fin du 15e s. et des travaux d’embellissement ont été commandés par l’abbé Philippe de Lévis (1501-1537). Réformée par les Mauriste en 1662, ces derniers ont reconstruit au 18e s. une grande partie des bâtiments monastiques, le cloître et les ailes qui encadrent la cour et l’avant-cour.
 L’agglomération, sur la rive opposée de l’Orbieu et accessible par un ancien pont fortifié, n’apparaît dans les sources qu’à la fin du XIIIe siècle, à une époque où elle semble déjà très importante et dotée d’institutions comme le consulat. Plusieurs dizaines de maisons en pierre de taille datables de la fin du XIIIe-début du XIVe siècle y sont encore conservées, indiquant une période de dynamisme.
L’agglomération, sur la rive opposée de l’Orbieu et accessible par un ancien pont fortifié, n’apparaît dans les sources qu’à la fin du XIIIe siècle, à une époque où elle semble déjà très importante et dotée d’institutions comme le consulat. Plusieurs dizaines de maisons en pierre de taille datables de la fin du XIIIe-début du XIVe siècle y sont encore conservées, indiquant une période de dynamisme.
 Le marché de Lagrasse, se tenant sous la halle édifiée par l’abbé Auger de Gogenx, était d’ailleurs le plus important des basses Corbières. Au début de l’époque moderne, la ville était encore prospère, en témoigne la douzaine de demeures décorées de riches plafonds peints étudiés ces dernières années par l’association internationale de Recherche sur les Charpentes et Plafonds Peints du Midi (RCPPM). Des planches issues de quelques-uns de ces plafonds malmenés sont aujourd’hui restaurées et exposées dans la Maison du patrimoine.
Le marché de Lagrasse, se tenant sous la halle édifiée par l’abbé Auger de Gogenx, était d’ailleurs le plus important des basses Corbières. Au début de l’époque moderne, la ville était encore prospère, en témoigne la douzaine de demeures décorées de riches plafonds peints étudiés ces dernières années par l’association internationale de Recherche sur les Charpentes et Plafonds Peints du Midi (RCPPM). Des planches issues de quelques-uns de ces plafonds malmenés sont aujourd’hui restaurées et exposées dans la Maison du patrimoine.
Cette décennie de recherche a permis d’éclairer les traces de l’histoire mouvementée de cette abbaye très puissante, dont les bâtiments ne se laissent pas facilement appréhendés, et de la ville voisine, l’une des plus grandes agglomérations médiévales des Corbières.
Nelly Pousthomis-Dalle (Université Toulouse-Jean Jaurès, UMR 5608-Terrae, responsable du PCR), et Julien Foltran (Hadès-archéologie) pour le collectif de recherche.

Séance du 09 octobre 2018 (séance privée)
Ouverture de l’année académique
Communication longue de Virginie Czerniak : « Nouveau regard sur les peintures du croisillon septentrional de Saint-Sernin de Toulouse ».
Lire le compte-rendu
 La basilique Saint-Sernin de Toulouse conserve quelques témoignages épars de sa décoration picturale médiévale au nombre desquels figure la composition sise dans la première travée occidentale du croisillon nord. Développée sur l’ensemble de la travée – mur, voûte et arcs – la peinture propose un programme iconographique riche et cohérent qui fut analysé par Marcel Durliat à l’heure de sa mise au jour. Cette lecture, ainsi que l’appréciation des données stylistiques, peuvent être aujourd’hui affinées à la faveur de comparaisons avec d’autres ensembles peints relevant de la sphère pontificale.
La basilique Saint-Sernin de Toulouse conserve quelques témoignages épars de sa décoration picturale médiévale au nombre desquels figure la composition sise dans la première travée occidentale du croisillon nord. Développée sur l’ensemble de la travée – mur, voûte et arcs – la peinture propose un programme iconographique riche et cohérent qui fut analysé par Marcel Durliat à l’heure de sa mise au jour. Cette lecture, ainsi que l’appréciation des données stylistiques, peuvent être aujourd’hui affinées à la faveur de comparaisons avec d’autres ensembles peints relevant de la sphère pontificale.
Présents : Mme Nadal, Présidente, MM. Scellès, Directeur, Cabau, Secrétaire général, Mme Napoléone Secrétaire-adjointe, MM. Péligry, Bibliothécaire-archiviste, Ahlsell de Toulza, Trésorier ; Mmes Andrieu, Cazes, Fournié, Haruna-Czaplicki, Jaoul, Watin-Grandchamp ; MM. Balty, Catalo, Cazes, Garrigou Grandchamp, Lassure, Macé, Sournia, Stouffs, Surmonne, Testard, membres titulaires ; Mmes Balty, Bossoutrot-Rebière, Czerniak ; MM. Darles, Marquevielle, Penent, Rebière, Suzzoni, membres correspondants.
Excusés : Mmes Galès, Lamazou-Duplan, Vallée-Roche ; MM. Peyrusse et Tollon.
Invités : Mme Marie-Lys de Castelbajac, restauratrice, M. Lacoste, chef de l’entreprise de restauration LACOSTE 32.
La Société accueille chaleureusement Benjamin Marquevielle, récemment élu membre correspondant.
Notre Présidente rappelle qu’une séance foraine se tiendra le samedi 13 octobre à Lagrasse sous la direction de Julien Foltran et de Nelly Pousthomis, et elle invite la compagnie à s’y rendre. Elle énumère ensuite le courrier reçu par la Société pendant les vacances. Notre attention est retenue par une lettre envoyée par M. Frédéric Nepont au sujet du ravalement des façades du collège de Foix. Maurice Scellès fait remarquer que les phénomènes de modes se suivent en la matière : en effet, avant, on laissait les appareils à nu ; désormais les façades sont enduites. Le problème est de savoir si l’enduit est de bonne qualité et si la façade a fait l’objet d’une étude avant d’être recouverte. Quitterie Cazes propose d’insister auprès des Services de Toulouse Métropole pour qu’une couverture photographique ou une analyse de bâti soit effectuée avant la pose des enduits.
Émilie Nadal annonce ensuite que la Mairie de Toulouse invite les associations du patrimoine à se rendre à une réunion ayant pour objet l’élaboration du « secteur sauvegardé » de la ville.
Notre Présidente nous invite à consulter notre site internet, où la liste des lauréats de la Société archéologique depuis 1990, élaborée par Vincent Geneviève, a été insérée. Nous pourrons également y voir bientôt le travail effectué sous la direction de Christian Péligry pour notre bibliothèque. En effet, le catalogue a été repris avec un nouveau logiciel ; la saisie des ouvrages est en cours, mais il sera possible d’avoir accès à 4 000 documents à partir du mois de décembre. Par ailleurs, notre bibliothèque s’enrichit de deux ouvrages : le premier est un don de Pierre Garrigou Grandchamp s’intitulant Archéologie de l’espace urbain, édité par l’Université de Tours, le second est offert par Lourdes de San José i Llongueras et porte le titre de Trésors et objets d’orfèvrerie des églises catalanes IXe-XIIIe siècle.
Enfin, notre Présidente nous annonce la candidature de Valérie Dumoulin comme membre correspondant de notre Société.
Elle donne ensuite la parole à Virginie Czerniak pour sa communication : Nouveau regard sur les peintures du croisillon nord de Saint-Sernin.
Émilie Nadal remercie notre consœur de nous avoir permis de redécouvrir les peintures du transept nord de Saint-Sernin et, surtout, de nous avoir fait connaître le fragment magnifiquement conservé trouvé à Saint-Géraud d’Aurillac. Virginie Czerniak précise que ce dernier fragment a fait l’objet d’analyses. Ainsi sait-on qu’il a été peint selon la technique du mezzofresco, peut-être utilisée également à Saint-Sernin. Elle note qu’il ne s’agit probablement pas du même atelier et pense qu’il faudrait étudier de plus près les liens qui ont pu exister entre les deux édifices. Elle ajoute enfin qu’il reste difficile de dire si les deux programmes étaient identiques, même s’il apparaît clairement que les modèles sont communs.
Quitterie Cazes reprend l’hypothèse de notre consœur, associant l’iconographie du décor peint du transept nord de Saint-Sernin à la cérémonie du baptême. Elle note qu’à la suite se trouvent les représentations de la Passion et de la Crucifixion. Émilie Nadal reprend également un détail du monde infernal décrit par Mme Czerniak : le chapeau qui lui fait penser à celui des papes en enfer dans l’iconographie des XIIIe et XIVe siècles. Dominique Watin-Grandchamp note enfin qu’il faut tenir compte de la cohérence globale de l’iconographie.
Jean-Louis Rebière annonce que les restaurations de ces peintures vont bientôt commencer.
Dans le cadre des questions diverses, la parole est donnée ensuite à Marie-Lys de Castelbajac, restauratrice en charge du prochain nettoyage des peintures du transept nord de Saint-Sernin pour la présentation de quelques aspects techniques et iconographiques du décor en question. Émilie Nadal remercie la restauratrice et demande si des analyses des pigments ont été effectuées. Marie-Lys de Castelbajac répond par l’affirmative et précise que les résultats ont montré l’utilisation d’ocre et d’aérinite provenant des Pyrénées pour les teintes bleues, mais aucun pigment extraordinaire ou de provenance lointaine n’a été trouvé. À la demande de Jean-Marc Stouffs sur des informations concernant les résines qui recouvrent les peintures, la restauratrice répond qu’elle n’a rien trouvé. Il l’interroge encore sur l’existence d’archives sur les restaurations anciennes. Aucun document n’existe, mais Marie-Lys de Castelbajac a pu noter l’utilisation de néoprène. Jean-Marc Stouffs voudrait avoir des précisions sur les opérations qui vont être effectuées et demande si ces résines vont être allégées ou supprimées et si des essais ont été effectués. La restauratrice précise que des essais ont été faits avec différents solvants et que le plus probant est celui d’un mélange effectué avec de l’acétone. Jean-Marc Stouffs demande enfin quels sont les objectifs de cette restauration. Il lui est répondu qu’il s’agit d’alléger les fixatifs qui ont des effets négatifs sur la lecture de l’œuvre. Les coulures de néoprène ne peuvent être enlevées. Il ne sera pas fait de consolidation. Quelques retouches et rebouchages sont envisagés avec des tons et des matériaux différents puisque toutes les retouches anciennes ont viré. Le principe retenu est celui d’alléger ces retouches et de les remplacer par des glacis d’aquarelle et des enduits de tons neutres pour les grandes lacunes, ce qui permettra une meilleure lisibilité.
Quitterie Cazes rappelle que les restaurations des peintures du transept nord effectuées par Pierre Belin en 1974 ont été faites dans l’urgence : il a travaillé derrière les ouvriers, dans la précipitation. Il apparaît clairement que sans son intervention ce décor n’existerait plus. Daniel Cazes ajoute que personne n’imaginait à l’époque trouver des peintures. Le projet des travaux effectués en 1974 était simplement de décaper les murs dans tout l’édifice.

