Année académique 2022-2023

Séance du 13 juin 2023
Séance dédiée à Jean-Luc Bourdatchouk avec les communications courtes suivantes :
Lire le compte-rendu
![]() J.-Ch. Balty : « La statuette dite d’Ausone du musée d’Auch »
J.-Ch. Balty : « La statuette dite d’Ausone du musée d’Auch »![]() D. Cazes : « Questions autour d’un art wisigothique »
D. Cazes : « Questions autour d’un art wisigothique »![]() Ph. Gardes : « Toulouse des origines : de la déconstruction des mythes à la révélation archéologique »
Ph. Gardes : « Toulouse des origines : de la déconstruction des mythes à la révélation archéologique »![]() D. Watin-Grandchamp : « Une tournée lotoise avec Jean-Luc »
D. Watin-Grandchamp : « Une tournée lotoise avec Jean-Luc »![]() P. Cabau : « À propos de deux manuscrits des œuvres de Sidoine Apollinaire »
P. Cabau : « À propos de deux manuscrits des œuvres de Sidoine Apollinaire »![]() F. Peloux : « Afer natione. Les saints d’origine africaine dans la bordure sud du Massif central (VIe siècle) »
F. Peloux : « Afer natione. Les saints d’origine africaine dans la bordure sud du Massif central (VIe siècle) »![]() L. Macé : « Au pied du mur : l’emblématique des vicomtes de Murat »
L. Macé : « Au pied du mur : l’emblématique des vicomtes de Murat »
La séance sera suivie d’un apéritif pour clôturer l’année académique de façon conviviale.
Présents : Mme Czerniak, Présidente, MM. Ahlsell de Toulza, Trésorier, Péligry, Bibliothécaire-Archiviste, Mmes Napoléone, Secrétaire générale, Machabert, Secrétaire adjointe ; Mmes Bessis, Cazes, Nadal, Watin-Grandchamp, MM. Balty, Cazes, Garrigou Grandchamp, Lassure, Macé, Peyrusse, Scellès, Sournia, Surmonne, Testard, membres titulaires ; Mmes Balty, Dumoulin, Ledru, MM. Gardes, Peloux, membres correspondants.
Excusés : Mmes Haruna-Czaplicki, Rollins, MM. Capus, Penent, Stouffs.
La Présidente ouvre la séance et fait circuler, à titre d’information, le dépliant promotionnel de l’exposition « Viollet-le-Duc. Trésors d’exception » qui se déroule du 10 juin au 1e octobre 2023 au Musée des Beaux-Arts de Carcassonne. La Présidente rend ensuite compte de la correspondance. Concernant le dossier du château de Scopont, deux courriers ont été reçus : de la part du Ministère de la Culture et du Ministère chargé des Transports. Tous deux prennent acte de la protestation exprimée par notre Société (séance du 9 mai 2023). La bibliothèque s’enrichit grâce à un nouveau don de Pierre Garrigou Grandchamp : Federico Farina, Benedetto Fornari, L’Architettura cistercense e l’abbazia di Casamari, Edizioni Casamari, réédition 2001.
La séance du jour, clôturant l’année académique, est une séance particulière, entièrement dédiée à Jean-Luc Boudartchouk. Coordonnés par Laurent Macé, six membres interviendront pour honorer la mémoire de notre confrère. Pour introduire cet hommage, Louis Peyrusse rappelle les mots de Louis Aragon : « il est des morts qu’il ne faut pas pleurer mais continuer ». Notre ancien Président poursuit : Comment ne pas pleurer quand l’étape vient beaucoup trop tôt et devant une mort trop rapide ? mais continuer, c’est exactement ce que vont faire les collègues de Jean-Luc Boudartchouk.
Pour débuter, la parole est donnée à Jean-Charles Balty qui aborde : La statuette dite d’Ausone du musée d’Auch.
La Présidente remercie notre confrère et lui demande s’il a connaissance d’autres types de sculptures ressemblant à ce modèle à Auch et pouvant correspondre à un programme décoratif commandé au XVIe ou XVIIe siècle ? Une série sur les hommes illustres d’Auch aurait pu être réalisée pour la bibliothèque par exemple. Jean-Charles Balty pense que cette statue a effectivement été taillée pour la bibliothèque. L’œuvre n’a pas été trouvée en fouilles car elle ne présente aucune trace de concrétions à la surface, elle est en bon état, hormis le tenon qui a dû se briser lors d’une chute. Il souligne la singularité de cette statue qui présente un personnage en toge positionné sur une base et non fixé comme cela se voit plus souvent. Aujourd’hui son emplacement au musée d’Auch la rend peu visible. Si elle est méconnue, des qualités de taille se révèlent notamment à travers le traitement du pli de la toge au niveau du coude droit. Le sculpteur a vraisemblablement observé des statues en toge, des exemplaires ont été trouvés à Bordeaux en particulier dès le début du XVIe siècle. Ainsi Jean-Charles Balty avance un terminus post quem vers 1560-1570 ; ce qui doit correspondre à l’arrivée des Jésuites explique-t-il. Notre confrère rappelle que les deux premières éditions des textes d’Ausone ont été éditées par des philologues bordelais à Bordeaux. Le poème que l’auteur consacre à Staphilius a dû marquer les esprits et dans la ville du rhéteur, à Auch, les Jésuites ont pu commander une statue. L’artiste sollicité reste, en revanche, inconnu. Jean-Charles Balty ayant mentionné dans sa présentation le Togado de Periate conservé à Grenade, Daniel Cazes profite de cet échange pour signaler que l’autre grande statue en toge de bronze de l’époque romaine découverte à la fin du XIXe siècle dans la péninsule ibérique (à Pampelune) et disparue depuis a été récemment retrouvée dans une collection particulière aux États-Unis et acquise par le musée de Navarre pour un quart de sa valeur. À la demande de Laurent Macé, Jean-Charles Balty confirme que le personnage tient dans la main gauche un volumen, il s’agit donc d’un homme de lettres. Jean-Michel Lassure évoque la présence, dans le sud du Gers, de têtes en marbre pyrénéen qui se fixent sur des togati et dont les attitudes sont presque semblables à celle de la statuette dite d’Ausone. Il suggère qu’elles aient pu servir de modèle. Jean-Charles Balty est convaincu que le sculpteur de la statuette du musée d’Auch avait un modèle pour la toge. En effet la plupart des statues en toge conservées sont dépourvues de tête, généralement elles se sont cassées, qu’elles soient sculptées directement ou encastrées. La tête et plus particulièrement la chevelure dénotent par rapport au style du corps. Louis Peyrusse remarque que la statue, in abstracto, peut ressembler à une statue baroque. Daniel Cazes pense, lui, au travail de Marc Arcis. L’œuvre rappelle à Guy Ahlsell de Toulza l’image du Christ enfant enseignant telle que figurée sur les sarcophages paléochrétiens. Le Christ est alors montré en togatus, les cheveux longs et bouclés et avec un visage poupin. Aussi, l’auteur de la statuette aurait pu prendre pour modèle une gravure d’un sarcophage romain paléochrétien représentant le Christ enseignant, entouré de saint Pierre et saint Paul par exemple.
Après cet échange, Daniel Cazes nous présente ses Questions autour d’un art wisigothique.
À propos du « deuxième sceau d’Alaric », récemment découvert et conservé dans une collection particulière en Grande-Bretagne, Dominique Watin-Grandchamp signale qu’il existe des chercheurs spécialistes capables d’identifier la veine géologique de la pierre et sa provenance. Il serait intéressant qu’une étude soit effectuée sur une pièce d’une telle importance. Daniel Cazes précise que Jean-Luc Boudartchouk n’avait trouvé aucune étude scientifique probante sur l’origine du saphir.
La parole est ensuite donnée à Philippe Gardes pour son intervention sur Toulouse des origines : de la déconstruction des mythes à la révélation archéologique.
La communication suivante est proposée par Dominique Watin-Grandchamp, qui revient sur Une tournée lotoise avec Jean-Luc (autour de la visite de l’église de Saint-Aureil sur la commune de Castelnau-Montratier et datable du XIIe siècle).
Dominique Watin-Grandchamp précise que l’origine de la dévotion à saint Aureil, considéré comme thaumaturge, guérisseur des maux d’oreille (sic), est inconnue. Fernand Peloux demande pour quelle raison saint Aurélien de Limoges est écarté pour l’identification de la statue de Limoges. Dominique Watin-Grandchamp répond : il y a actuellement deux statues dans l’église : une du XVIIe siècle réputée représenter saint Aureil, mais sans attribut ; la seconde, de style saint-sulpicien, figure en réalité saint Aurélien de Limoges en évêque. Elle ajoute que la manière dont saint Aureil est cité dans les textes médiévaux retranscrits par des érudits quercynois semble exclure qu’il puisse s’agir d’Aurélien. Ces mentions intéressent Fernand Peloux, car il y a un argument qui peut appuyer cette hypothèse d’identification : dans la légende de saint Martial telle qu’Adémar de Chabannes la promeut, en dehors de Limoges il y a peu de lieux que Martial aurait évangélisés, mais le Quercy en fait partie. Un lien entre le sanctoral du Limousin et le Quercy existe donc assez tôt, ce qui rend plausible la référence à Aurélien. Dominique Watin-Grandchamp poursuit : le territoire environnant est d’une grande richesse archéologique et, lors de cette tournée, un repérage avait été effectué sur le site de Saint-Sernin de Thézels, à trois-cent mètres de Saint-Aureil. Seul un bosquet, abritant quelques blocs de pierre, marque encore son emplacement. Les vestiges en ont été largement dispersés, quelques-uns sont conservés au musée de Cahors, d’autres réemployés (chapiteau sous une croix de chemin) sont visibles aux abords et le champ qui entoure le bosquet regorge de fragments de marbre dont du « Grand antique » de provenance pyrénéenne. Daniel Cazes rectifie : le marbre Grand Antique provient de la carrière d’Aubert située dans la commune de Moulis (Ariège) et la vallée du Lez et non de la Lèze.
Puis la parole est donnée à Fernand Peloux pour une communication courte intitulée Afer natione. Les saints d’origine africaine dans la bordure sud du Massif central (VIe siècle).
Dominique Watin-Grandchamp demande si, parmi les manuscrits mentionnés, la transcription proposée par celui de Toulouse est la plus proche de la réalité historique ? Fernand Peloux répond que seul « ejus » est ajouté par rapport aux autres documents, il est donc difficile de savoir si le scribe a simplement voulu rendre le texte compréhensible ou s’il a eu un modèle. Le doute intervient pour beaucoup des textes du légendier de Moissac, en l’absence d’un autre témoin extérieur et aussi ancien, il est délicat de se prononcer. Fernand Peloux ajoute que le texte évoqué est difficilement compréhensible, mais en considérant que Quintien est de la famille de Faust le passage devient clair. Il n’est alors pas étonnant qu’il soit envoyé auprès d’un membre de la famille de l’évêque. En outre, cette hypothèse corrobore ce qu’en dit Grégoire de Tours. Dominique Watin-Grandchamp demande s’il est possible d’identifier le premier manuscrit ayant servi de modèle. Fernand Peloux explique que le légendier de Moissac avait des antigraphes qui probablement étaient, soit en écriture mérovingienne donc difficilement lisibles au moment de leur copie, soit dans un état linguistique tel que les copistes ne sont pas parvenus à le reproduire avec exactitude.
Enfin, Laurent Macé présente sa communication intitulée : Au pied du mur : l’emblématique des vicomtes de Murat.
Valérie Dumoulin note que la présentation des appareils de l’un des sceaux montrés est similaire à celle des faux appareils produits au XIIIe siècle pour les églises. Quitterie Cazes remarque que cet élément est caractéristique du grand appareil et se retrouve aussi dans des sculptures romanes. Olivier Testard précise que dans l’appareil simulé de ce sceau le trait ne figure pas le joint mais évoque la taille de la face de la pierre. Valérie Dumoulin rappelle qu’il existe un exemple local, certes plus récent, avec les armoiries de la ville de Muret qui reproduisent deux murailles crénelées.
Après ce tour de paroles, Guy Ahlsell de Toulza souhaite évoquer trois souvenirs avec Jean-Luc Boudartchouk. Le premier se situe à Caussade où ils s’étaient rendus un jour chez Mme Neveu qui était en possession de fibules mérovingiennes que Jean-Luc Boudartchouk voulait essayer de faire acquérir. Puis, le Trésorier regrette que le projet, souvent évoqué par la Société, d’effectuer un voyage en Auvergne tous ensemble guidés par notre éminent confrère, ne se soit jamais concrétisé. Enfin, Guy Ahlsell de Toulza exprime un dernier regret concernant Saint-Amans de Rabastens. L’accès à l’église rendu impossible a interrompu l’étude qu’il avait entamée avec Jean-Luc Boudartchouk. Depuis deux ans, le travail est à l’arrêt.
La Présidente remercie chaleureusement l’ensemble des membres qui ont accepté de participer à cette séance et qui, à travers les souvenirs, ont rendu hommage à Jean-Luc Boudartchouk.
Pour finir, elle félicite, au nom de la Société, notre consœur Valérie Dumoulin qui vient d’être nommée attachée de conservation du patrimoine.
Daniel Cazes attire l’attention des membres sur l’annonce par la municipalité de l’ouverture d’un nouveau jardin public dans la cour Sainte-Anne à l’arrière de la cathédrale Saint-Étienne. Des réaménagements sont programmés notamment pour végétaliser le site sans qu’il soit question de l’ancien cloître roman sous-jacent. Une vigilance est donc de mise quant au déroulement des travaux.
Après ce dernier point, la Présidente prononce la clôture de l’année académique et invite les membres à partager un moment convivial.

Séance du 30 mai 2023
Communication courte de Jacques Dubois, La reconstruction de l’église abbatiale de Moissac à la fin du Moyen Âge ; Communication courte de Sophie Brouquet, Le diable au couvent, le monastère de Prouilhe au milieu du XVe siècle et Addenda à la communication de Bernard Sournia, Sainte-Marie de Bayonne, Chronique de chantier suite et fin.
Lire le compte-rendu
Jacques Dubois, La reconstruction de l’église abbatiale de Moissac à la fin du Moyen Age
De l’ensemble monastique de Moissac, l’abbatiale, reconstruite à la fin du Moyen Age, est la grande délaissée de l’historiographie. Ce désintérêt pour cette partie-là de l’abbaye est sensible par une datation variable et imprécise de l’église selon les auteurs, de même par l’absence de consultation des sources manuscrites signalées comme l’indiquent des propos totalement erronés. Si Marcel Durliat a bien identifié deux campagnes distinctes dans ce programme de reconstruction et en a précisé la chronologie (chevet en premier et nef en second), en revanche, leur datation et leur attribution, à Aymeric de Roquemaurel (1423-1449) pour l’une et à Pierre de Caraman (1449-1484) pour l’autre, doivent être entièrement revues à la lumière de la relecture des pièces manuscrites et du monument sur lesquels l’historiographie s’est appuyée. Ainsi, entre autres documents, un arrêt du Parlement de Toulouse de 1490 rendu contre l’abbé – source méconnue des historiens de l’abbaye – vient participer à la nouvelle proposition faite à l’occasion de cette communication. De même, la prise en compte de l’économie de la construction, par l’étude de la mise en œuvre des matériaux, fournit un bon indice de l’investissement limité des abbés dans les chantiers, surtout lors de la deuxième campagne de construction vers 1495.
Sophie Brouquet, Le diable au couvent, le monastère de Prouilhe au milieu du XVe siècle
Fondé par saint Dominique en juillet 1206, le monastère de Prouilhe s’est implanté à proximité d’une chapelle dédiée à la Vierge, devenue Sainte-Marie de Prouilhe. Le lieu fut choisi en raison de sa situation privilégiée, à la croisée des routes du Lauragais et en terre hérétique, permettant d’accueillir les nouvelles converties au catholicisme par le chanoine d’Osma. Ce couvent de femmes est le premier des Dominicaines, abritant des sœurs cloîtrées, vouées à la prière. Comme souvent, les historiens se sont moins intéressés à son sort à la fin du Moyen Âge. Aussi, est-il intéressant de saisir un témoignage concernant l’abbaye à cette époque.
Présents : Mmes Czerniak, Présidente, Napoléone, Secrétaire générale, Machabert, Secrétaire adjointe, MM. Cabau, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier ; Mmes Brouquet, Fournié, Jaoul, Pradalier-Schlumberger, Watin-Grandchamp, MM. Cazes, Garland, Garrigou-Grandchamp, Lassure, Macé, Pradalier, Sournia, Surmonne, Testard, membres titulaires ; Mmes Dumoulin, Rollins, Rousset, Tollon, Vène, Viers, MM. Dubois, Kérambloch, Rigault, membres correspondants.
Excusés : MM. Balty, Péligry, Peyrusse ; Mmes Balty, Merlet-Bagnéris.
Invitée : Gabriella Chiwood.
Virginie Czerniak ouvre la séance en accueillant notre invitée Gabriella Chiwood, jeune doctorante en Histoire de l’Art inscrite à l’Université de l’Oregon et invitée par notre consœur Lanie Rollins.
La Présidente annonce par ailleurs à l’assemblée que le volume 2019 de nos Mémoires est chez l’imprimeur ; nous devrions pouvoir le récupérer à la séance du 13 juin. Le retard de parution de nos Mémoires est donc enfin rattrapé. Elle fait ensuite circuler le programme du 58e colloque de Fanjeaux consacré cette année – sous la direction d’Anne Massoni, de Limoges –, aux « Chanoines et chapitres du Midi ». Il se tiendra du 3 au 6 juillet prochains.
Puis elle donne la parole à Michelle Fournié pour nous parler d’un autre colloque auquel elle a participé récemment autour de saint Thomas. En parallèle à l’exposition qui se tient actuellement et que les membres de la Société sont invités à visiter mardi 6 juin prochain à l’Institut Catholique, ce colloque regroupait un certain nombre de communications sur la théologie, la liturgie et quelques communications historiques. Notre consœur intervenait à partir du manuscrit de la translation des reliques de saint Thomas aux Jacobins à la fin du mois de janvier 1369 et à partir du manuscrit 610 de la Bibliothèque Municipale de Toulouse rédigé par le Dominicain Raymond Hugues. Ce manuscrit transcrit par Sylvie Caucanas va donc être publié et traduit. Notre consœur a plus particulièrement travaillé sur le corpus des miracles à partir de ce document. À l’occasion de ce colloque, elle a rencontré d’autres chercheurs, en particulier Marika Räsänen, Finlandaise, de l’Université de Turku et spécialiste des reliques de saint Thomas. Elle travaille avec le chercheur australien Constant Mews sur d’autres manuscrits de la translation des reliques. Michelle Fournié a donc appris qu’il existe trois autres manuscrits (à Bologne, à Yale et à Venise) dont le corpus des miracles est plus complet que celui qui apparaît dans le manuscrit toulousain. Notre consœur est ravie à la perspective de travailler avec ces chercheurs pour la publication.
La parole est à Daniel Cazes pour une information ponctuelle. En faisant visiter Moissac à un groupe, il est passé par Saint-Nicolas-de-la Grave où se trouve le château de campagne de l’abbé de Moissac Bertrand de Montaigu. Préalablement, il avait pris contact avec la Mairie pour savoir ce que devenait cet édifice, laissé jadis quasiment à l’abandon. Or, il se trouve que la Municipalité de Saint-Nicolas-de-la-Grave a racheté l’ensemble des lots constituant l’édifice pour y installer la mairie et a fait restaurer le château par tranches successives ; voilà qui est à son sens tout à fait remarquable. Notre ancien Président demande à l’assemblée d’aller voir ce château pour envisager la remise d’une médaille de la Société pour cette heureuse initiative, comme nous l’avions fait il y a quelques années à La Salvetat-Saint-Gilles. Pierre Garrigou Grandchamp fait remarquer qu’une très bonne étude de cet édifice a été publiée il y a deux ans par notre confrère Gilles Séraphin dans le Bulletin de la Société Archéologique de Tarn-et-Garonne.
Virginie Czerniak donne ensuite la parole à Bernard Sournia pour un addendum à la communication qu’il a faite lors de la séance précédente : Sainte-Marie de Bayonne : chronique de chantier, (suite et fin).
La Présidente remercie notre confrère et lui demande de veiller à publier tous les dessins qui ont illustré sa communication : ce sont des documents de travail extraordinaires et indispensables à la compréhension de l’édifice. Michèle Pradalier se dit également admirative devant toute cette documentation. Elle est toujours à la recherche de sculptures pour cet édifice, notamment des clés de voûte. Le collage entre deux parties avec des chapiteaux trahissant deux époques différentes l’intéresse beaucoup ; les corbeilles à crochets peuvent être datées du milieu du XIIIe ou de la seconde moitié de ce siècle au plus tard. Cela correspond à la chronologie établie lors de l’étude, répond Bernard Sournia. Selon lui, cette première phase se situerait entre 1258 et 1278. Pour la seconde phase, les chapiteaux à feuillages boursouflés accusent plutôt la première moitié du XIVe siècle, ajoute Michèle Pradalier, ce qui correspond bien à la datation proposée par notre confrère. Enfin, les vitraux de la belle rose sont-ils d’origine, demande-t-elle, et, si c’est le cas, n’y a t-il pas derrière l’idéal cistercien ? Bernard Sournia se dit incapable de parler du vitrage qu’il n’a pas pu voir de près, mais cela résulte plutôt selon lui d’une restitution du XIXe siècle. Michèle Pradalier pense qu’il est important de faire une publication complète de toute la documentation graphique du XIXe siècle, qui est inédite. Bernard Sournia confirme en effet avoir découvert ce fonds, jusqu’ici non exploité, aux Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques. Laurent Macé demande si, dans la phase de reconstruction de l’édifice, les matériaux de l’ancienne cathédrale ont été remployés et si ces remplois sont visibles. Bernard Sournia répond que l’appareil est d’une belle régularité et que les formats des éléments ont été standardisés en carrière ; les remplois ne sont donc pas apparents. Le mur gouttereau de l’ancienne cathédrale avait été conservé en remploi, sur place, mais il a été supprimé quand fut bâtie au XIXe siècle la chapelle paroissiale. Cette maçonnerie apparaît cependant sur les dessins anciens. Olivier Testard fait remarquer que les matériaux anciens sont souvent jetés dans les fondations des nouvelles constructions. Concernant la chronologie « des Deschamps », reprend Michèle Pradalier, elle a été renouvelée dans la thèse de Christian Freigang, qui n’a malheureusement jamais été traduite. Il a cependant publié un article dans le Bulletin Monumental où il montre clairement qu’il n’y a pas « un » seul Deschamps : il y a celui de la cathédrale de Clermont-Ferrand, puis les autres. Le terme de « firme » utilisé par notre confrère est donc tout à fait adéquat.
Virginie Czerniak donne ensuite la parole à Jacques Dubois pour une seconde communication courte, intitulée La reconstruction de l’église abbatiale de Moissac à la fin du Moyen Âge.
La Présidente remercie notre confrère pour ses propos, qu’elle a trouvés très intéressants, et note que les reconstructions qu’il a évoquées sont générales pour les églises du Quercy à la fin du XVe siècle. Elle renvoie aux statistiques effectuées par Jean Lartigaut sur les églises partiellement ou entièrement détruites à la fin de la Guerre de Cent Ans. Il lui semblait cependant que la file de coupoles qui devait couvrir la nef de l’édifice au XIIe siècle n’était qu’une hypothèse. Elle se demande par ailleurs comment étaient couverts les murs gouttereaux romans et comment se faisait le raccord avec le reste de la maçonnerie. Notre confrère note le départ des pendentifs qui a suscité l’hypothèse de la file de coupoles et montre les reprises et les sculptures du XIIIe siècle qui semblent indiquer que le projet de cette construction est resté sans suite. Virginie Czerniak demande à notre confrère s’il compte pousser plus loin l’étude du bâti. Celui-ci répond qu’il se concentrera sur la fin du Moyen Âge. Henri Pradalier questionne notre confrère sur l’emplacement de l’écu de l’abbaye par rapport à la porte du cloître. Il se trouve au niveau de la porte, répond Jacques Dubois. Daniel Cazes demande ensuite à notre confrère s’il a une idée de l’organisation du chœur après les travaux qu’il a évoqués. Celui-ci répond que la communauté s’est en effet réduite au XVe siècle mais qu’il n’a pas trouvé de mentions à ce sujet dans les textes qu’il a consultés. Dominique Watin Grandchamp voudrait savoir à quel moment les deux plaques de dédicace de l’église du XIe siècle ont été ancrées dans le mur nord ? Jacques Dubois pense qu’il faut situer cette insertion après les travaux de la fin du Moyen Âge. Notre consœur considère qu’elles ont pu être encastrées après les derniers travaux du chœur, dans le cadre d’une récupération au moment d’une nouvelle consécration. Elle demande enfin si les dates de consécration sont connues. Les documents ne signalent aucune cérémonie en 1435, répond Jacques Dubois.
La parole est enfin donnée à Sophie Brouquet pour une communication courte, Le diable au couvent, le monastère de Prouilhe au milieu du XVe siècle selon les archives du Parlement de Toulouse.
La Présidente remercie notre consœur pour ce récit édifiant. Elle lui demande si les textes qu’elle a consultés évoquent les origines de ce personnage haut en couleur qui se nomme Labastrou. C’est un Dominicain, répond notre consœur, probablement de Toulouse car il semble y avoir des relations. Un registre de mains courantes de Pamiers montre qu’il se passe beaucoup de choses dans les couvents des Dominicains et des Cordeliers. Elle évoque également un autre procès à Millau concernant un Cordelier pris en otage dans une maison de Clarisses. Michelle Fournié avoue avoir trouvé l’histoire peu compréhensible, tout d’abord quant au nombre des prêcheurs. Sophie Brouquet répond que le texte indique qu’il y en a beaucoup, car les Dominicaines de Prouilhe se confessent tous les jours. Mais il y a aussi des oblats et des donats qui ne confessent pas. Le nombre exact des frères n’est pas connu. Où habitent ces hommes ? demande encore Michelle Fournié. Ils logent dans le prieuré qui est à côté du couvent des femmes, à l’intérieur de l’enceinte, répond notre consœur. C’est donc un prieuré d’une centaine de personnes implanté à Prouilhe, distinct du couvent de Fanjeaux. Michèle Pradalier évoque l’église de Prouilhe, qui a fait au XIXe siècle l’objet d’un projet démesuré, équivalent de celui de l’église Saint-Aubin de Toulouse. Malheureusement, la communauté n’arrive pas aujourd’hui à achever les travaux, les fenêtres restent sans vitraux et des palissades en bois s’élèvent sur le chantier. Daniel Cazes signale la parution, dans un numéro récent du Bulletin Monumental, d’une étude portant sur les topographies ancienne et récente du monastère de Prouilhe (Haude MORVAN, « La Gallia Dominicana de Georges Rohault de Fleury. Restituer les couvents médiévaux à l’aube du XXe siècle », dans Bulletin Monumental, t. 180-4, 2022, p. 325-340). Elle montre bien la disposition des deux communautés, avec des informations intéressantes sur les édifices qui précédaient ceux qui s’élèvent actuellement sur le site et enfin sur l’utilisation de la même église pour les deux communautés, le tout cerné par une grande enceinte. Michelle Fournié fait enfin remarquer que le couvent des femmes avait été conçu au départ pour être la base du financement de l’Ordre dans la province dominicaine. À son apogée, c’est-à-dire à la fin du XIIIe siècle, le couvent comptait entre 130 et 200 femmes, mais les effectifs s’effondrent à partir du milieu du XIVe siècle. En 1435, il n’en reste plus que 60 à 80.

Séance du 9 mai 2023
Communication longue de Bernard Sournia, Sainte-Marie de Bayonne : chronique de chantier, suite et fin.
Lire le compte-rendu
On va continuer la chronique de chantier commencée lors d’une précédente communication. L’on prendra les choses vers 1315, à la reprise des travaux (après quelques années d’interruption). L’on suivra les diverses phases de l’ouvrage (abside, transept, vaisseau triple) jusqu’à la fin du gros œuvre quelque part entre 1451 et 1475. L’on verra en particulier comment au cours de cette dernière phase de chantier est tentée une ré-écriture de l’édifice dans un éblouissant style flamboyant ; puis comment, à partir de 1850, une restauration approfondie, sous la direction d’Emile Boeswillwald, architecte diocésain, ramène l’ouvrage au style rayonnant et à la pureté présumée de ses origines.
Situation du chantier vers 1325
Calepinage de l’une des fenêtre ouest du vaisseau triple, dessin de Boeswillwald.
Communication courte de Dominique Watin Grandchamp, Un Benezet dans l’ombre
Une demande de protection au titre des Objets mobiliers des tableaux de chœur de l’église de Saint-Julia (31) a été l’occasion de redécouvrir un tableau relativement important dans l’œuvre du peintre Bernard Benezet (1835-1897). Connu de l’historien d’Art Christian Mange, ce tableau, encore peu lisible, avait quasiment disparu sous la poussière et les chancis. Il illustre la conduite exemplaire de l’évêque Henri-François-Xavier de Belzunce de Castelmoron lors de l’épidémie de peste qui frappe la ville de Marseille, en 1720. Le tableau est signé et daté de 1887. Outre la scène principale, traitée dans le goût du « gothic revival » cher à Benezet, il porte la représentation du « Sacré Cœur » de Jésus dont le peintre fixe la nouvelle iconographie, en 1874, à la demande du père Ramière qui est à la tête de la compagnie des jésuites à Toulouse.

Présents : Mme Czerniak, Présidente, MM. Cabau, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier, Mmes Napoléone, Secrétaire générale, Machabert, Secrétaire adjointe ; Mme Watin-Grandchamp, MM. Balty, Cazes, Garland, Garrigou Grandchamp, Macé, Peyrusse, Scellès, Sournia, Testard, Tollon, membres titulaires ; Mmes Balty, Hénocq, Rollins, M. Kérambloch, membres correspondants.
Excusés : Mmes Dumoulin, Fournié, Ledru, Merlet-Bagnéris, Rolland Fabre, MM. Péligry, Surmonne.
La Présidente ouvre la séance et annonce que les membres de la Société sont conviés le mardi 6 juin à 17 h, à une visite de l’exposition « Saint Thomas d’Aquin, une sagesse offerte à tous » proposée à l’Institut Catholique de Toulouse (espace Georges Baccrabère). Les membres souhaitant y assister sont priés de s’inscrire directement auprès d’elle. Daniel Cazes et Dominique Watin-Grandchamp, présents au vernissage, soulignent la qualité de l’exposition. Concernant le château de Scopont, la Présidente nous informe qu’un courrier de protestation contre le tracé de l’autoroute, validé par le Bureau, a été adressé en recommandé : au Préfet de Région, au Préfet du Département, à l’Architecte des Bâtiments de France du Tarn, à la Ministre de la Culture, au Ministre délégué auprès du Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires chargé des Transports, au Maire de Maurens-Scopont et au Directeur des Affaires Culturelles de la Région. Louis Peyrusse nous informe ensuite que le 2 mai a été inaugurée l’exposition « Fernand Pifteau. La passion du patrimoine écrit toulousain ». Elle est présentée conjointement au Musée du Vieux Toulouse et à la Bibliothèque Universitaire de l’Arsenal jusqu’au 15 juin. Enfin, Laurent Macé fait un point sur la séance du 13 juin dédiée à Jean-Luc Bourdatchouk ; à ce jour six membres se sont manifestés pour participer à cet hommage.
La Présidente donne ensuite la parole à Bernard Sournia pour sa communication longue : Sainte-Marie de Bayonne : chronique de chantier, suite et fin .
La Présidente remercie Bernard Sournia pour sa présentation et salue l’impressionnante qualité de ses dessins de relevés. Virginie Czerniak appuie la conclusion proposée : Sainte-Marie de Bayonne est un édifice « incroyable », en termes d’évolution des formes notamment. Daniel Cazes a été particulièrement séduit par la beauté de la voûte de la croisée du transept avec les liernes et tiercerons. Notre confrère demande : est-elle plus précisément datable, dans la « période Godin » ou simplement avant 1336 ? Bernard Sournia est formel, elle date de la période du cardinal Godin qui, dans son testament de 1336, rappelle qu’il a réalisé, « iam est diu » (« il y a pas mal de temps »), sur ses deniers, les voûtes de la croisée. Cette affirmation, vague, ne permet pas de connaître exactement la date de construction mais situe tout de même l’ouvrage dans l’espace de la dizaine d’années précédant le testament du cardinal. Virginie Czerniak s’interroge : n’est-ce pas précoce pour une voûte à liernes et tiercerons ? Bernard Sournia évoque l’exemple d’Amiens, première réalisation de ce type au milieu du XIIIe siècle, autour de 1240. Cette référence se situe loin de Bayonne, mais les constructeurs de Sainte-Marie sont imprégnés de l’art du Nord, poursuit Bernard Sournia, ils sont d’ailleurs eux-mêmes des gens du Nord, des Picards, des Champenois, des Franciliens ! Daniel Cazes fait remarquer que l’utilisation de ces voûtes à liernes et tiercerons est un des traits de génie du « palmier » de l’église des Jacobins de Toulouse. Certes, il s’agit dans ce cas de voûtes triangulaires, mais elles datent d’avant 1292, aussi Godin aurait-il pu se souvenir de cet exemple suggère notre confrère. Bernard Sournia explique que la voûte à liernes et tiercerons s’impose comme une formule usuelle dès le milieu du XIIIe siècle, comme la solution la plus pertinente pour couvrir le grand espace des croisées de transept. Pierre Garrigou Grandchamp ajoute que dans l’art gothique dit angevin ce type arrive très tôt, dès les années 1230 (entre Saumur et Angers).
Virginie Czerniak souligne le caractère extraordinaire de la clef de voûte du transept qui présente une iconographie singulière : un navire accompagné des symboles des quatre évangélistes tenant des phylactères. À ce sujet Dominique Watin-Grandchamp suggère qu’il puisse s’agir d’une confrérie de marins de haute mer plutôt que d’une confrérie de constructeurs de bateaux. En effet, le bateau reprend les caractéristiques des navires hauturiers, de haute mer (hune, dispositif de la nef…). Ces confréries étaient souvent très riches : les membres commerçaient. D’ailleurs, dans cette représentation, l’équipage est nombreux. Bernard Sournia abonde en ce sens : il existe des mentions d’archives du XVIe siècle, relevées avant l’incendie en 1908, qui signalent que les maîtres et compagnons mariniers, au retour de leur voyage, devaient verser une somme qui entrait dans la caisse de la fabrique de la cathédrale. Laurent Macé précise qu’il faut regarder cette clef de voûte du transept en ayant aussi en tête les sceaux urbains. Pour des villes de l’Atlantique telles que Biarritz, Bayonne ou San Sebastian, il y a pour cette période des représentations de bateaux et de leurs équipages. Notre confrère explique qu’il s’agit d’un élément identitaire très fort, qui peut aussi bien correspondre à une confrérie ou à un groupe corporatif qu’à une identité urbaine. Ainsi, les édiles ou les consuls de Bayonne ont peut-être participé au financement de la construction de l’édifice. Bernard Sournia évoque la présence des armes de France sur la façade occidentale, qui peuvent faire envisager un don royal pour la ville. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées. La nef apparaît comme un motif sur les monnaies, complète Laurent Macé. Il renvoie notamment à celles des Plantagenêt, au XIVe siècle, qui figurent souvent le roi dans une nef dans le contexte de la guerre de Cent ans. Les représentations des marins sur le gréement et de personnages à la manœuvre sont des éléments d’iconographie fréquents sur les monnaies de cette époque.
La Présidente donne ensuite la parole à Dominique Watin-Grandchamp pour une communication courte intitulée : un Benezet dans l’ombre .
Virginie Czerniak demande si d’autres illustrations de cette iconographie par Bernard Benezet sont connues, y compris dans ses compositions murales ? Il n’en existe pas d’autres, répond Dominique Watin-Grandchamp. Notre consœur ajoute que, paradoxalement, cet épisode (l’évêque Henri-François-Xavier de Belsunce de Castelmoron face à l’épidémie de peste qui frappe la ville de Marseille en 1720) a donné lieu à des commandes de la part de communautés religieuses et de familles catholiques, mais qu’il n’y a pas eu de nombreuses représentations de ce thème. Notre Présidente note qu’il est surprenant de trouver cette iconographie dans le modeste édifice paroissial d’une petite localité du Midi. Louis Peyrusse explique que cette iconographie relève plus du thème du Sacré-Cœur que de l’histoire de monseigneur de Belsunce, qui est secondaire. Malheureusement, aucune trace de la genèse de la commande n’a été trouvée. Notre consœur suppose qu’elle provient de la famille de Bernard Benezet qui habitait à Saint-Julia depuis le XVIIIe siècle et qui faisait partie des bienfaiteurs de l’hôpital. Dominique Watin-Grandchamp pense que Bernard Benezet lui-même a pu faire un don. À la disparition de l’hôpital, le tableau a pu être déposé dans l’église. Elle insiste sur la surabondance de toiles peintes dans ce modeste édifice situé dans une petite commune. Ces tableaux, de qualité pour certains, attestent le déploiement d’une floraison de peintres, encore mal connus, qui produisaient des toiles de grand format pour de petites églises. En effet, d’autres toiles de ces peintres anonymes, de facture identique et avec les mêmes poncifs, se retrouvent dans les environs de Saint-Julia. Selon Louis Peyrusse, l’ancrage local de Benezet explique ainsi la présence de cette peinture. Dominique Watin-Grandchamp nous présentera une suite à sa communication après la restauration de la toile.
Séance du 18 avril 2023
Communication longue de Sophie Duhem et Gérard d’Alto (invité), L’entreprise familiale des Pedoya, peintres itinérants au XIXe siècle
Lire le compte-rendu
Présentation par Sophie Duhem de Gérard d’Alto, du projet Banditi et de l’état des recherches menées actuellement à l’université.
Gérard D’Alto interviendra sur le sujet :
« Récolter le fruit de son labeur au XIXe siècle : la longue quête de Jean-Antoine Pedoy face à la fabrique de Rieux ».
Sa conférence s’attardera sur l’examen de « l’affaire Pedoya » qui a duré près d’une trentaine d’années (1833-1862), et qui a opposé le peintre et entrepreneur Jean-Antoine Pedoya à la fabrique de Rieux. Après avoir exposé l’histoire de ce procès au « long cours », il montrera l’intérêt que représente « l’analyse de réseau » – méthodologie issue des sciences sociales, pour l’étude de la commande artistique en milieu rural et la connaissance du milieu des peintres italiens itinérants.
Présents : Mmes Czerniak, Présidente, Napoléone, Secrétaire générale, Machabert, Secrétaire adjointe, MM. Ahlsell de Toulza, Trésorier, Péligry, Bibliothécaire-Archiviste ; Mmes Bessis, Cazes, Fournié, Jaoul, Merlet-Bagnéris, Pradalier-Schlumberger, MM. Cazes, Julien, Penent, Peyrusse, Scellès, Suzzoni, Testard, membres titulaires ; Mmes Duhem, Rolland Fabre, Rollins, membres correspondants.
Excusés : Mme Balty, MM. Balty, Cabau, Garland, Garrigou Grandchamp, Kerambloch, Pradalier et Tollon.
Invités : Mme Mariana Burasovitch (étudiante), M. Gérard D’Alto (étudiant).
Notre Présidente ouvre la séance et nous informe de l’organisation prochaine de deux manifestations : le 147e Congrès national des Sociétés historiques et scientifiques qui se tiendra du 23 au 26 mai prochains à l’Université de Toulouse 2 – Jean Jaurès avec le titre Effondrements et ruptures, et le Congrès de la Fédération historique de la Région Occitanie qui se réunira sur le thème De Tautavel à la Région Occitanie, la fabrique des territoires, du 16 au 18 juin 2023 à Montpellier.
Par ailleurs, deux courriers en date du 14 avril nous ont été adressés : le premier émane de l’association La Renaissance du château de Scopont et le second du propriétaire du château, Bernard d’Ingrando, nous demandant notre soutien dans le cadre du projet de l’autoroute A69 dont le tracé mettrait en péril la conservation de l’édifice. Ces correspondances sont accompagnées de tous les documents qui ont déjà été envoyés au Préfet, au DRAC, etc. Ce problème ayant déjà été examiné (séance (cf. du 21 mars 2023), il reste à la Société de faire un courrier pour appuyer cette demande.
Virginie Czerniak accueille chaleureusement nos deux invités, dont l’un va activement participer à la communication de ce jour. Puis elle présente le volume double de nos Mémoires (t. LXXX-LXXXI, 2020-2021) qui vient d’être imprimé.
Elle donne enfin la parole à Sophie Duhem et Gérard D’Alto pour une communication longue intitulée : L’entreprise familiale des Pedoya, peintres itinérants au XIXe siècle.
Notre Présidente remercie les deux intervenants et demande des informations sur le logiciel d’analyse de données Gephi utilisé pour le traitement des sources. Gérard D’Alto répond qu’il a commencé par faire des tableaux Excel en partant des édifices. Il a inclus dans ces tableaux toutes les données disponibles dans les sources. Cela suppose de relever tous les noms secondaires, ajoute Sophie Duhem, et certaines sources, comme les recensements, l’état civil, les registres paroissiaux…, se prêtent bien à cette récolte de données et permettent d’établir les relations. Le logiciel Gephi, explique encore Gérard D’Alto, représente par exemple un point par personnage et un trait par relation. Plus les relations sont nombreuses, plus le trait est épais. De plus, reprend Sophie Duhem, cela permet de repérer des éléments que la seule lecture des documents ne laisse pas apparaître. Il faut donc veiller à ne pas multiplier les entrées pour ne pas complexifier les graphes, fait remarquer notre Présidente. En effet, répond Sophie Duhem, c’est un travail qui demande une longue réflexion en amont. Virginie Czerniak demande enfin ce qu’il en est du curé Pailhes : était-il réellement malhonnête dans la gestion des affaires ? Les sources laissent entendre en tout cas qu’il a tout fait pour redonner du faste à l’Église, répond Gérard D’Alto. Louis Peyrusse demande quel était le prénom de l’abbé d’Aldéguier ? Il évoque les trois ou quatre grandes familles d’Aldéguier de Toulouse dont faisait partie un ancien Président de notre Société (Auguste d’Aldéguier, magistrat, † 1866), et pense que le curé dont il est question appartenait certainement à l’une d’elles. Il avait donc toutes ses entrées à l’archevêché. Il faut sans doute consulter l’étude qui a été faite sur le clergé toulousain du XIXe siècle par l’ancien archiviste de l’archevêché. L’Ordo du diocèse de Toulouse peut également indiquer son prénom. Ce personnage avait certainement une tout autre surface sociale que le curé Pailhes. Notre ancien Président est également très étonné par la somme importante due par ce dernier : 8 164 francs. C’est en effet le drame de l’histoire, reprend Sophie Duhem : à partir du moment où les Pedoya se constituent en entrepreneurs, ils ont beaucoup de mal à se faire payer après les chantiers. Louis Peyrusse voudrait connaître la nature des travaux à payer : s’agit-il seulement de peintures ou de la réfection de chapelles avec plâtre, maçonnerie… Gérard D’Alto répond qu’il y a eu trois campagnes de travaux (1833, 1836, 1839), où l’entreprise emploie des plâtriers, des maçons et un menuisier. Il fait remarquer que le travail de François Pedoya à Fronton a coûté 13 000 francs pour les travaux sur toute la voûte. La somme de 8 164 francs sur trois campagnes n’est donc pas exorbitante. Le problème, reprend Louis Peyrusse, est le partage entre maçonnerie, peinture et décoration. S’il ne s’agit que de peinture, c’est une somme bien supérieure à celle de la vente de tableaux importants à la même époque ; il s’agit là simplement d’avoir un ordre d’idée. Sophie Duhem fait remarquer que cette dette constitue un drame pour la famille qui paye ses ouvriers et vit difficilement. Gérard D’Alto ajoute que cela va d’ailleurs causer sa perte, comme en témoignent certains courriers. L’analyse de réseaux peut être discutée, reprend Sophie Duhem, mais elle a l’avantage dans certains cas de repérer des acteurs secondaires auxquels on n’aurait jamais prêté attention à la simple lecture de documents d’archives. Pascal Julien fait remarquer que le graphe indique que des artisans locaux sont sollicités, alors que l’on s’attendrait à voir les mêmes ouvriers suivre tous les chantiers de ces peintres itinérants. Gérard D’Alto confirme ce fait et ajoute qu’il est aussi intéressant de confronter différents graphes en prenant l’exemple des travaux effectués à Rieux-Volvestre où les sources mentionnent l’origine des capitaux et la liste des ouvriers. Les graphes permettent de voir sur quels chantiers ont travaillé ces ouvriers. Louis Peyrusse demande s’il a été possible de faire dans ces tableaux numériques des statistiques sur l’iconographie. Sophie Duhem répond qu’ils ne se sont pas encore attaqués à ce travail mais qu’il est prévu. Elle voudrait intégrer les motifs peints, après les avoir bien identifiés, et faire des rapprochements stylistiques et iconographiques pour laisser justement apparaître sur les cartes des rapprochements que l’on n’aurait pas soupçonnés. Gérard D’Alto ajoute que la base de données contient actuellement 10 000 images. Louis Peyrusse rappelle que les Pedoya sont tout de même des hommes célèbres qui sont entrés dans la littérature grâce à Ferdinand Fabre ; il demande si l’étude critique du récit de cet auteur, Le roman d’un peintre, a été faite, car il est intéressant d’analyser un document qui est arrivé au grand public de l’époque. Il a été lu attentivement, répond Sophie Duhem, et il a été présenté dans un séminaire il y a deux ans. En outre, même dans la bibliographie récente, on présente encore ces artistes comme des « barbouilleurs », ce qui montre de quelle manière ils ont été désignés dans l’historiographie depuis le XIXe siècle et justifierait peut-être l’état de ce patrimoine aujourd’hui. Le cas de Ceroni est intéressant, poursuit-elle : il est présent à Toulouse en 1820 et décore les salles du Musée des Augustins, alors que les Pedoya travaillent à la cathédrale Saint-Étienne. Dans les années 1815-1820, ils sont appréciés et font l’objet de louanges, mais la pression de la commande artistique les oblige à quitter progressivement la ville pour travailler sur des chantiers plus faciles à remporter pour eux. Ce glissement vers l’extérieur de la ville a été également noté pour Albi. Gérard d’Alto reprend : à ce travail d’historien fondé sur le traitement des sources, il manque celui du sociologue pour mieux appréhender les relations. En effet, ajoute Sophie Duhem, nous aimerions savoir s’il existe des fréquentations entre les artistes : entre les Ceroni et les Pedoya par exemple, ce qui reste difficile à mettre en évidence. Quelles sont les interactions avec la ville de Toulouse et l’école des Beaux-Arts ? Quel est le rôle joué par les frères Bach dont l’un peint quelques années après dans l’esprit de ce que font les Pedoya, donc la question de l’influence sur les peintres toulousains se pose ? C’est un effet de mode qu’il faut essayer de caractériser, fait remarquer Louis Peyrusse, d’où l’intérêt de se pencher sur l’iconographie pour voir d’abord quels sont les sujets à la mode. Sophie Duhem fait remarquer que l’on trouve dans les sources des commandes de peintures dans le style byzantin ou néo-gothique, mais le travail de Mariana Burasovitch a montré que les Pedoya ont des répertoires d’ornements issus de recueil imprimés au XIXe siècle à Paris (de motifs ornementaux de la Sainte-Chapelle), contrairement à Bosia qui est lui très tourné vers le répertoire des XVIIe et XVIIIe siècles, on voit donc à la même époque des sources d’inspiration différentes.
Notre Trésorier fait remarquer aux intervenants qu’à l’hôtel de Fournasse à Rabastens se trouve un salon peint par les Italiens vers 1874-75. Celui-ci est richement orné dans le style néo-gothique. Un autre salon est décoré de grandes fleurs dans le style Napoléon III. Il se demande si les frères Ceroni, basés à Lavaur, se sont chargés de ces décors ? Pascal Julien fait remarquer qu’en Italie on fonctionne en réseau familial, alors que dans le cas présent on est en réseau professionnel ; il se demande s’il y a des interconnections entre ces réseaux. Gérard d’Alto pense que la famille est restée en Italie, il est d’ailleurs question d’une sœur malade dont le fils Riccardo vient travailler en France dans un second temps. Sophie Duhem note également que Bosia fait venir ses pigments d’Italie. Elle fait du reste remarquer que ces artistes circulent beaucoup et sur de longues distances ; la question du moyen de transport reste posée. Virginie Czerniak demande où se trouvait l’atelier de peinture sur chevalet des Pedoya. Probablement à Pamiers, répond Sophie Duhem. Gérard D’Alto récapitule : François, le plus doué, fait les tableaux ; Jean-Antoine s’occupe de l’entreprise, il circule beaucoup pour chercher les marchés ; Riccardo gère les petits chantiers. L’analyse de réseaux est une entreprise particulièrement complexe conclut Sophie Duhem.
Quitterie Cazes trouve ce travail passionnant et propose aux orateurs de venir faire à la Société un petit point annuel sur leur travail de recherche.

Séance du 4 avril 2023
Communication longue d’Anne-Laure Napoléone, Le palais de la famille Balène à Figeac
Lire le compte-rendu
Commissaire royal et receveur du Périgord et du Quercy au duché d’Aquitaine, à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle, Géraud Balène éleva sa demeure principale à Figeac. Ce vaste édifice qui marque toujours le paysage urbain était composé de quatre corps de bâtiment disposés autour d’une cour et d’une tour au-dessus du passage d’entrée. Après avoir été le palais d’une puissante famille, l’édifice joua un rôle important dans l’histoire de la ville.
Présents : Mme Czerniak, Présidente, MM. Cabau, Directeur, Ahlsell de Toulza, Mmes Napoléone, Secrétaire générale, Machabert, Secrétaire adjointe Trésorier, M. Péligry, Bibliothécaire-Archiviste ; Mmes Cazes, Fournié, Merlet-Bagnéris, MM. Balty, Cazes, Garrigou Grandchamp, Lassure, Macé, Peyrusse, Scellès, Sournia, Surmonne, Testard, membres titulaires ; Mmes Balty, Dumoulin, Ledru, Rolland Fabre, Rollins, membres correspondants.
Excusés : Mmes Pradalier-Schlumberger, Jaoul ; MM. Garland, Pradalier, Tollon.
La Présidente ouvre la séance en signalant un nouveau don qui vient enrichir notre bibliothèque : Pierre Garrigou Grandchamp offre un numéro de la revue European Journal of Post-classical Archaeologies, volume 2, mai 2012. Michèle Fournier informe ensuite l’assemblée que le vendredi 14 avril, à la Bibliothèque d’Études Méridionales, se tiendra un séminaire « Autour de saint Jacques à Toulouse ». Ce séminaire, organisé par l’équipe TERRAE, annonce un colloque programmé pour novembre 2023.
Laurent Macé propose que la dernière séance de l’année académique soit dédiée à Jean-Luc Boudartchouk. Une communication de notre regretté ami était en effet programmée le 13 juin. Certains membres pourraient évoquer des travaux qu’ils avaient engagés en commun avec lui. Cette séance pourrait être l’occasion de présenter des documents ou une ébauche des recherches en cours et, ainsi, rendre hommage à la mémoire de notre éminent confrère. La Présidente trouve l’idée excellente et remercie Laurent Macé pour cette très bonne initiative. La proposition sera relayée auprès des membres afin de coordonner la séance.
Enfin la Présidente se réjouit du succès de la séance publique de la Société. Le 26 mars l’assistance était nombreuse dans la salle Clémence-Isaure, et Virginie Czerniak remercie les conférenciers d’avoir contribué à cette belle réussite.
La Présidente donne ensuite la parole à Anne-Laure Napoléone pour la communication longue du jour : Le palais de la famille Balène à Figeac.
Virginie Czerniak remercie notre consœur pour ce travail impressionnant. Elle demande si une telle hauteur, de dix mètres, pour une aula, est courante ; quelle est la surface de la pièce ? Elle fait 180m2 avec vingt-deux mètres de long et elle occupe tout un corps de bâtiment, répond Anne-Laure Napoléone. Puis Virginie Czerniak revient sur les peintures mentionnées par un journaliste dans un article paru après l’incendie du début du XXe siècle. Anne-Laure Napoléone explique que l’auteur se désole seulement des lambeaux qui se décollent et laissent apparaître ces peintures. Aucune description n’en est proposée alors, ni au moment de la construction du théâtre. Lors de la transformation en salle de cinéma, les murs ont été doublés. Peut-être reste-t-il des traces ou des vestiges derrière ces parois toujours en place ? Virginie Czerniak demande ensuite si une analyse dendrochronologique est envisagée sur le morceau de poutre retrouvé dans le mur. Anne-Laure Napoléone avoue y penser, mais il faudrait plusieurs bois pour que la dendrochronologie soit fiable. L’intérêt d’une telle étude n’est pas primordial puisque les datations sont déjà bien établies, note Virginie Czerniak. Anne-Laure Napoléone explique avoir pris le parti de proposer des datations en se fondant sur les textes plutôt que sur le style des sculptures. Les deux approches semblent concorder.
Pierre Garrigou Grandchamp remercie à son tour notre consœur pour son travail sur un bâtiment actuellement dans un état épouvantable. Il rappelle que le palais Balène est un des plus beaux monuments civils du début des années 1300 en France. Le Quercy est le seul endroit, avec le milieu avignonnais (Avignon et Villeneuve-lès-Avignon), où un panorama des grandes demeures « aristocratiques » en France peut être dressé. À Paris, elles ne sont connues que par des sources écrites ; dans le reste de la France, tout a disparu. Le milieu est donc extraordinairement intéressant, mais il est pourtant très mal traité. Aucun de ces édifices n’a bénéficié d’une étude complète, d’un PCR (Programme Collectif de Recherche)… Ce désintérêt est regrettable, poursuit Pierre Garrigou Grandchamp, car, ainsi que l’a prouvé cette communication, la documentation et l’analyse des vestiges permettent de restituer avec précision les formes architecturales et la distribution de ce palais. Il souligne l’intérêt du bâtiment sous l’aspect des formes. Celles-ci traduisent en effet un basculement, puisque deux vocabulaires se mélangent, avec un apogée du style rayonnant à travers les grandes fenêtres à réseau, et des croisées déjà très présentes sous toutes leurs formes : les croisées à remplages avec des trilobes en partie inférieure, tandis que d’autres, plus sèches, donnent sur la cour. Ainsi la précocité de cette nouvelle forme se révèle, puisque le gothique est arrivé dans la région dans le courant de la seconde moitié du XIIIe siècle.
Louis Peyrusse demande : que souhaite faire la Mairie de Figeac de ce bâtiment ? Anne-Laure Napoléone explique que la municipalité utilise le rez-de-chaussée réaménagé comme salle d’exposition, de conférence… Elle espère que la parution de l’article tiré de cette communication fera évoluer la situation. Louis Peyrusse précise ensuite que la façade néo-gothique, avec son portail et son fronton, est à considérer dans son contexte. Elle doit être restituée dans l’histoire des restaurations des années 1930 ; elle incarne la postérité de Viollet-le-Duc et de ses disciples. Elle fait aussi partie de l’histoire de l’édifice. Anne-Laure Napoléone ajoute que c’est en raison de ces transformations que l’édifice est inscrit et non pas classé à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Virginie Czerniak relève que le palais de l’Hébrardie de Carjac est aussi dans un état préoccupant. Elle songe également à la maison Lobios de Moissac et à sa grande salle sous charpente de 130 m2, qui n’a jamais été étudiée. Maurice Scellès ajoute que le palais épiscopal de Cahors disposait également d’une grande salle avec des fenêtres à réseau. L’édifice reste à étudier entièrement ; les caves médiévales et le corps principal sont conservés. Le constat est regrettable : malgré les démarches signalant leur intérêt et alertant sur leur état, les autorités délaissent ces monuments. Anne-Laure Napoléone précise qu’à Figeac, la municipalité se montre à l’écoute.
Daniel Cazes se dit saisi par les dimensions du palais Balène. Elles renvoient aux grands palais toscans comme celui du Bargello. Les palais italiens de ces proportions disposent toujours d’une chapelle, poursuit Daniel Cazes, il demande alors : est-il possible d’imaginer la présence d’une chapelle au palais Balène ? Anne-Laure Napoléone répond que, en l’état actuel, elle ne voit pas où elle pourrait se situer dans l’édifice. L’hypothèse est avancée pour le palais de la Raymondie, à Martel, dont la tour, au premier étage, est très soignée et voûtée. Peut-être était-ce le cas aussi au palais Balène, mais la tour n’existe plus. Louis Peyrusse demande si la documentation mentionne l’établissement d’une chapelle, ce qui suppose des autorisations. Anne-Laure Napoléone indique qu’au XVIe siècle la salle a été transformée en chapelle dédiée à saint Louis, mais la destination d’origine n’a pas alors été nécessairement respectée. Pierre Garrigou Grandchamp rappelle que le Lot a une densité et une qualité de bâtiments égales à celles de la Toscane. Il évoque en exemple les maisons-tours de la rue du Four-Sainte-Catherine à Cahors ; aucun équivalent de maisons-tours aussi grandes n’a été trouvé en Italie. Celles du Lot sont les plus grandes et les plus belles, mais aussi les plus abîmées. Quitterie Cazes demande s’il existe une hiérarchie dans les types d’ouvertures. Anne-Laure Napoléone confirme qu’à cette époque une hiérarchie est visible : les fenêtres à réseau signalent la partie la plus importante de l’édifice, tandis que des croisées sont employées dans les parties secondaires. À Figeac, un autre bâtiment de la même époque (l’hôtel situé au n° 39-43 de la rue Gambetta) dispose de fenêtres à réseau à l’étage (au niveau de la salle) et de croisées au second étage. Au palais de la Raymondie, construit 10-15 ans après Balène, toutes les fenêtres sont identiques. Dès lors, la salle n’est plus identifiable sur les façades. Maurice Scellès complète : au palais Duèze de Cahors, les fenêtres des élévations secondaires sont de simples baies géminées à deux lancettes séparées par une colonnette mais pour la chambre de parement (niveau inférieur sur la façade) des croisées à réseau ont été choisies. Cela laisse ainsi imaginer que les fenêtres de la grande salle donnant sur la rue étaient des fenêtres à réseau comparables à celles du palais Balène. Quitterie Cazes demande : des édifices avec des fenêtres aussi grandes ou plus grandes qu’à Balène sont-ils connus ? Anne-Laure Napoléone explique que les palais empruntent généralement au vocabulaire des architectures militaire et princière, mais le palais Balène emprunte à l’architecture religieuse, notamment avec les grandes fenêtres et le portail à voussures situé au pied de la tour. Laurent Macé s’intéresse à l’activité commerciale de ces palais : les arcades du rez-de-chaussée du palais de la Raymondie à Martel ouvraient-elles sur des boutiques ? Pour Anne-Laure Napoléone, cela paraît évident dans ce cas. Le palais se situe au centre de la ville, place des Consuls. Tout dépend du positionnement du palais dans la ville. Celui de Balène est en retrait des axes principaux, il n’est donc pas ouvert pour le commerce. Maurice Scellès indique qu’il y avait aussi, sans doute, des boutiques au palais Duèze. Pierre Garrigou Grandchamp ajoute qu’au palais de l’évêché à Cahors tout le rez-de-chaussée est ouvert d’arcades sur une des rues principales. Il serait intéressant de connaître leur fonction, complète Maurice Scellès : l’évêché avait-il des boutiques louées ? Quitterie Cazes rappelle que, dans un autre contexte, aux XVIe-XVIIe siècles, au monastère de la Daurade à Toulouse, toutes les ouvertures sur la rue Peyrolières sont des boutiques louées et cela correspond sans doute à un système médiéval. Certaines ouvertures peuvent donner sur des lieux de stockage ou des écuries, les fonctions peuvent être polyvalentes, suggère Anne-Laure Napoléone. Pour Maurice Scellès, il est aussi possible que la série d’arcades devienne un motif, notamment pour le palais épiscopal de Cahors.
Guy Ahlsell de Toulza exprime sa stupéfaction devant la manière dont le palais Balène a été maltraité, en toute connaissance de cause, avec notamment l’emploi excessif du béton. Les travaux successifs du siècle dernier ont été réalisés sans aucun respect de l’édifice. Pierre Garrigou Grandchamp souligne que l’intérêt pour l’architecture civile médiévale est récent. Ce patrimoine a longtemps été négligé. De Viollet-le-Duc jusqu’à Camille Enlart, la même importance était accordée à toutes les architectures (civile, militaire, religieuse, monastique…), puis il y a eu un « effondrement général ». Entre les deux guerres et jusqu’aux années 1970, l’architecture civile médiévale a été délaissée. Anne-Laure Napoléone précise que les travaux visés ont été réalisés avant la création du secteur sauvegardé de Figeac. Plusieurs membres se questionnent sur le devenir du palais Balène et de nombreux autres palais évoqués. Le manque d’investissement des autorités est souvent justifié par l’absence de fonction dévolue à ces bâtiments. Pierre Garrigou Grandchamp réfute cet argument : cet édifice vaut par lui-même ! Le palais des Papes d’Avignon montre qu’une utilisation est possible en préservant le bâtiment, remarque Guy Ahlsell de Toulza.
Enfin le Trésorier annonce la venue prochaine de Google Street View à l’Hôtel d’Assézat, afin de réaliser des vues à 360° des salles de l’Académie des Jeux Floraux. Il propose que la salle des séances de la Société Archéologique du Midi de la France soit également photographiée.

Séance du 21 mars 2023
Communication courte d’Henri Pradalier, Une source du maître de Cabestany ?
Lire le compte-rendu
Dans le contexte de la sculpture romane du XIIe siècle l’art du Maître de Cabestany se signale par des formes extrêmement originales. Ses sources sont à la fois antiques et contemporaines. Il est possible que certaines sculptures antiques et des modèles précis permettent d’expliquer le traitement particulier des visages des différents personnages sculptés par le Maître de Cabestany. La question est de savoir où le Maître de Cabestany a croisé ces modèles, ce qui peut se déduire en observant l’aire de diffusion de ses principaux chefs-d’œuvre.
Communication courte de Gilles Séraphin, Le chevet de Saint-Étienne de Périgueux, notes de visite
La cathédrale Saint-Etienne de Périgueux revisitée
A l’occasion d’une visite à la cathédrale Saint-Etienne-de-la Cité à Périgueux, l’examen de la pierre calendaire du 12e siècle insérée dans la travée de chœur a conduit à s’interroger quant à la chronologie de l’édifice. L’histoire des églises à files de coupoles d’Aquitaine pourrait s’en trouver modifiée.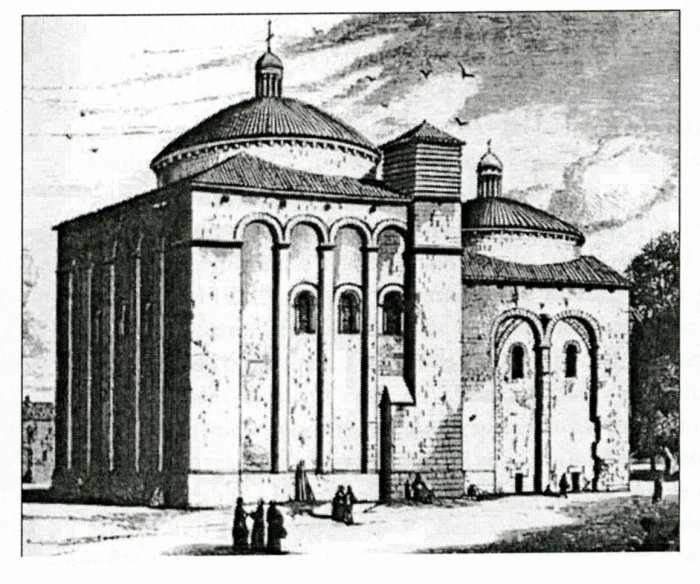
Photo : Saint-Etienne de la Cité à Périgueux, d’après J. de Verneilh, L’architecture byzantine, 1851
Présents : Mme Czerniak, Présidente, MM. Cabau, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier, Péligry, Bibliothécaire-archiviste, Mmes Napoléone, Secrétaire générale, Machabert, Secrétaire-adjointe ; Mmes Cazes, Fournié, Pradalier-Schlumberger, MM. Balty, Cazes, Penent, Peyrusse, Pradalier, Sournia, Surmonne, Testard, Tollon, membres titulaires ; Mmes Balty, Hénocq, Rolland Fabre, Rollins, MM. Kerambloch, Rigault, Séraphin, membres correspondants.
Excusés : MM. Garland, Garrigou Grandchamp, Scellès.
Invitée : Jeanne Péligry.
La Présidente ouvre la séance en rappelant aux membres que la séance publique annuelle de notre Société se tiendra dimanche 26 mars à 16 h. Outre l’allocution de la Présidente et la remise des prix, nous aurons le plaisir d’écouter une conférence de Pierre Garrigou Grandchamp, Maurice Scellès et Anne-Laure Napoléone intitulée « Construire et habiter au Moyen Âge dans le Lot ». La Présidente nous informe également du retour, lundi 27 mars, des statues-menhirs prêtées au Musée Henri-Prades. Enfin, Virginie Czerniak fait circuler le programme des évènements culturels et scientifiques organisés autour des centenaires de la naissance, de la mort et de la canonisation de saint Thomas d’Aquin (2023-2025). Michèle Pradalier-Schlumberger signale que, dans ce cadre, une exposition sera proposée à l’Espace muséographique Georges- Baccrabère de l’Institut Catholique de Toulouse. L’invitation pour le vernissage, qui aura lieu le mardi 2 mai 2023 à 18 h, a été diffusée auprès des membres.
La Présidente donne ensuite la parole à Henri Pradalier pour la première communication courte du jour : Une source du maître de Cabestany ?
Daniel Cazes souligne que le Silène ivre conservé au Musée archéologique de Narbonne complète admirablement la série de comparaisons présentée. Henri Pradalier précise que le visage, éloigné des standards du maître de Cabestany, montre qu’il y avait des œuvres de ce type dans la région. Daniel Cazes se demande si le maître de Cabestany a vu des œuvres du Haut-Empire romain telles que celles qui ont été projetées, ou s’il a plutôt été influencé par la sculpture de l’Antiquité tardive, notamment à travers les sarcophages ? En effet, pour le sarcophage de Saint-Hilaire, ce n’est pas qu’une question de visage, il y a aussi une imitation d’un modèle de sarcophage de la fin de l’Antiquité et peut-être chrétien. Daniel Cazes est aussi troublé par une certaine parenté entre les visages du maître de Cabestany et ceux de la frise de sarcophage du IVe siècle provenant de Saint-Sernin présentée au Musée Saint-Raymond. On y retrouve une façon brutale, angulaire, de présenter les profils et les visages ainsi que les coups de trépan caractéristiques de la sculpture paléochrétienne du IVe siècle. Jean-Charles Balty se réjouit d’avoir entendu cette communication qui répond à certaines de ses propres interrogations. Selon lui, deux plans sont à distinguer dans l’analyse : d’un côté, la question de l’iconographie et d’autre part celle du style. Les parallèles proposés avec les représentations du dieu Pan et des satyres relèvent, selon lui, d’un modèle plus général. Ils sont effectivement très proches des modillons de Saint-Papoul ; le maître de Cabestany a vraisemblablement vu des modèles de ce genre. Toutefois, du point de vue du style, les visages, taillés en biseau avec d’énormes yeux placés très haut, des crânes aplatis et des barbes touffues renvoient à des sarcophages romains de la deuxième moitié du IVe siècle. Jean-Charles Balty fait notamment référence à un sarcophage situé dans le porche de Saint-Laurent-hors-les-Murs à Rome, dont les têtes sont similaires à celles du maître de Cabestany. Ces références constituent donc l’influence principale du maître de Cabestany, même s’il est tout aussi indiscutable qu’il a cherché d’autres modèles dans la région : il y a des sarcophages de ce genre à Narbonne, à Gérone aussi (San Feliu). La filiation de ce côté est évidente. Seul Sant’Antimo est éloigné du reste, mais l’idée de pèlerinage est vraisemblable et explique la distance. Le maître aurait ainsi vu davantage de sarcophages de ce type au cours de son cheminement de Narbonne à Pise, notamment à Gênes. Michèle Pradalier-Schlumberger évoque l’hypothèse du transport des œuvres. Les sculptures italiennes, Sugana en particulier, n’ont-elles pas pu être transportées comme cela s’est fait au XIVe siècle, par exemple avec les deux statues attribuées au maître de la chapelle de Rieux de la cathédrale de Tarbes. A priori les pierres sont locales, note Virginie Czerniak. Henri Pradalier confirme, le sculpteur s’est déplacé, pas l’œuvre. Pour notre confrère, la colonne de Sugana n’est pas du maître de Cabestany. Elle est l’œuvre d’un disciple. Sugana dépendait de Sant’Antimo, il y a donc un lien entre les deux, une circulation.
La Présidente donne ensuite la parole à Gilles Séraphin pour la seconde communication courte du jour intitulée : Le chevet de Saint-Étienne de Périgueux, notes de visite.
Virginie Czerniak revient sur la raison du développement des églises à file de coupoles dans le domaine anglo-normand ? qui peut s’expliquer par le matériau, le calcaire, aisé à travailler en Aquitaine. Elle avoue que le rôle des Plantagenêts dans le Midi est un sujet qui l’intéresse particulièrement par rapport à Moissac. Au-delà des liens existant pour les peintures de l’abbatiale, il y a un contexte historique intéressant, avec la coalition entre Henri II et le Roi d’Aragon pour prendre en étau le comte de Toulouse. Gilles Séraphin est convaincu que les ducs d’Aquitaine élaborent un grand projet commercial et non pas seulement militaire. Cet axe Atlantique-Méditerranée passe par une alliance avec les comtes de Barcelone, avec la vicomtesse de Narbonne, avec les Trencavel, et par l’éviction des comtes de Toulouse, dans le cadre de la Guerre de Cent Ans méridionale. La plaque tournante de ce projet est Cahors qui va faire le lien entre la voie terrestre et la voie fluviale. Michèle Pradalier-Schlumberger tient à rappeler que la période « 1200 » est aussi très riche pour l’art. Gilles Séraphin précise qu’il la perçoit comme un « angle mort » dans la recherche, aucunement comme un « vide ». Mme Pradalier-Schlumberger revient ensuite sur les églises à file de coupoles. Lorsqu’elle s’est intéressée à ce sujet, après les travaux de Raymond Rey et ceux de Marcel Durliat, elle avait constaté que la datation de Brantôme par Claude Andrault-Schmitt était beaucoup trop tardive. Par ailleurs, elle avait remarqué l’existence de deux générations d’églises à file de coupoles. La première génération correspond à celle de Saint-Front et de Cahors et la seconde compte la cathédrale d’Angoulême (malgré les restaurations) et Fontevraud. Elles se distinguent par la façon dont les coupoles reposent sur les supports. Pour les plus anciennes coupoles sur pendentifs, les pendentifs se rejoignent par la partie haute avec une coursière, alors que dans la seconde génération les retombées des coupoles se font sur des éléments qui se rapprochent de niches. Les églises de cette dernière catégorie se caractérisent également par un décor plus important. À propos des travaux récents de restauration de Saint-Étienne de Périgueux qui ont provoqué la disparition des marques prouvant la réalisation distincte de deux campagnes architecturales pour les travées, Virginie Czerniak demande : l’architecte a-t-il totalement enduit l’édifice ? Gilles Séraphin confirme que l’enduit masque tous les éléments. Ce cas est l’occasion de rappeler l’importance d’engager un dialogue dépassionné entre architectes du patrimoine et historiens de l’art. Puis Henri Pradalier s’intéresse à la source de la datation de Saint-Front de Périgueux. Gilles Séraphin indique que la mention de l’incendie de 1120 sert d’appui, complétée par des repères stylistiques, sujets à caution puisque Paul Abadie a refait une majeure partie des chapiteaux. Henri Pradalier poursuit : ainsi il est difficile de placer à l’origine un monument qui a été entièrement reconstruit au XIXe siècle sans autre preuve que la mention de l’incendie, d’autant que sa gravité et l’ampleur des destructions ne sont pas connues. Daniel Cazes revient sur l’inscription de la table calendaire et sur l’enfeu : une étude archéologique permettrait notamment d’expliquer plus clairement leur réutilisation et la façon dont on les a replacés. Henri Pradalier note que les murs à petits moellons ne sont qu’une enveloppe et ne supportent rien, aussi peut-être sont-ils réutilisés sans que cela soit un élément possible de datation. Gilles Séraphin précise que les maçonneries du XIe siècle et du début du XIIe siècle peuvent être repérées à l’œil : les petits moellonages sont très bien assisés, à la différence, à partir d’une certaine hauteur, du moellonage supérieur qui est du tout-venant. C’est sans doute en observant ces éléments que Marcel Durliat, se fiant à Jean Secret, a proposé une datation au XIe siècle. Henri Pradalier relève que Marcel Durliat datait de 1110 ; descendre en 1163 lui paraît bas, d’autant que cette date s’appuie sur le très contestable déplacement d’une inscription à l’intérieur de l’édifice. Gilles Séraphin ajoute que la datation est également établie d’après la file de coupoles de l’église de Cahors, désormais associée au grand portail nord que Marcel Durliat date, soit d’un peu avant 1150, soit plus probablement d’après 1150. À Moissac, on sait que la nef à file de coupoles est exactement contemporaine du clocher, et cette nef est sans doute celle consacrée en 1180. Tous ces éléments constituent un faisceau. Gilles Séraphin propose donc cette datation (1ére travée vers 1160), qui lui semble cohérente avec le contexte architectural et historique. Il appuie : il faut s’intéresser aux liens entre l’Aquitaine et le Languedoc, en prenant conscience que Limoges est la capitale de l’Aquitaine dans la seconde moitié du XIIe siècle. Henri Pradalier approuve l’établissement de ce rapport entre le Languedoc et une Aquitaine tentant de peser sur celui-ci comme le prouve l’iconographie du portail occidental de Saint-Sernin de Toulouse qui a été élaborée dans Toulouse sous domination aquitaine avec la volonté de mettre saint Martial au-dessus de saint Sernin. Cela traduit une volonté de mainmise de Limoges sur Toulouse à la fin du XIe siècle. Henri Pradalier demande ensuite une précision sur la manière dont est voûtée l’abside à Solignac. Il s’agit d’un cul-de-four, répond Gilles Séraphin. Il ajoute que ses dimensions sont beaucoup plus restreintes, tout comme à Souillac. Michèle Pradalier-Schlumberger souligne que l’église de Solignac n’est pas très décorée. Gilles Séraphin reprend : à Périgueux dans la première travée, la plus ancienne, ce sont les pilastres plats qui soutiennent la corniche, puis dans la deuxième travée ce sont les demi-colonnes adossées. Ce rythme est reproduit à l’identique pour les deux premières travées de Solignac, ce qui incite notre confrère à supposer que ses constructeurs ont observé Périgueux dans la dernière phase. Pour Brantôme, il faudrait s’intéresser à la frise de pointes de diamant et établir des comparaisons avec d’autres édifices afin d’affiner la datation.
Au titre des questions diverses, Michèle Pradalier-Schlumberger débute par un point sur le château de Scopont régulièrement évoqué en séance ces dernières années. Le château, situé sur la commune de Maurens-Scopont, a appartenu au marquis de Castellane, membre fondateur de notre Société. Le pavillon de style néo-gothique avec des chapiteaux en remploi du XIIIe siècle est classé, tandis que le château et l’orangerie sont inscrits à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Les deux bâtiments doivent faire l’objet d’une campagne de rénovation portée par la Fondation du Patrimoine (candidature soutenue par la SAMF, séance du 15 février 2022). Aujourd’hui le domaine est menacé par le projet d’autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Michèle Pradalier-Schlumberger cite un texte de Rémi Paulin, chargé de mission régional pour la Fondation du Patrimoine, alertant sur la situation. Le tracé de l’autoroute retenu par le Préfet passe à 180 mètres du château. Outre la préservation de ce patrimoine, la sauvegarde des biotopes environnants est également en jeu. Des associations et des avocats ont entamé des démarches pour faire annuler la DUP (Déclaration d’Utilité Publique). Olivier Testard explique que l’urgence serait de restaurer l’orangerie, dont la toiture s’est effondrée en 2021. Actuellement, les décombres appuient sur la façade sud, qui risque de s’effondrer à son tour. Le château est également en danger : des fuites ont considérablement détérioré la toiture et les menuiseries. L’état du pavillon néo-gothique est le moins inquiétant. Daniel Cazes rappelle que le remplacement par des moulages des décors sculptés du pavillon est en discussion depuis plusieurs décennies. Pour l’heure, le danger majeur pour le domaine reste le projet d’autoroute. Le château est entouré de zones humides, l’autoroute risque d’accentuer l’assèchement et de menacer l’équilibre des fondations. La Présidente, au nom de la SAMF, va rédiger un courrier à l’attention du Préfet de Région et du Préfet du Tarn pour manifester l’inquiétude de la Société devant le tracé qui menace un monument classé.
Henri Pradalier aborde ensuite le devenir de la caserne Vion. L’examen du cas du bâtiment, œuvre de l’architecte Pierre Debeaux, était inscrit à l’ordre du jour de la dernière CRPA (Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture). Il en a été retiré à la dernière minute par le Préfet à la demande du Maire de Toulouse. L’étude du dossier a été reportée à la prochaine séance. La situation de la caserne est remontée jusqu’au Ministère et, à ce jour, le bâtiment est toujours en danger. Aline Tomasin, au nom de l’association des Toulousains de Toulouse, va demander une instance de classement en urgence. La SAMF va effectuer la même démarche de son côté. Louis Peyrusse et Daniel Cazes rappellent la grande qualité architecturale de cet ensemble.
Enfin, Daniel Cazes nous informe que, dans le cadre d’une quinzaine dédiée à l’action des femmes, le jeudi 16 mars, les Archives départementales des Pyrénées-Orientales ont rendu hommage à Yvette Carbonell-Lamothe, enseignante aux universités de Toulouse et Perpignan, conservateur des antiquités et objets d’art des Pyrénées-Orientales, décédée, qui fut un membre actif de notre Société. Cet hommage fait suite au volume publié sous la direction de Géraldine Mallet et Agnès Carbonell, Yvette Carbonell-Lamothe, la passion du patrimoine, 2021, 247 p. (conservé à la bibliothèque de la SAMF). Plusieurs de nos membres ont pu assister à cet hommage et à la conférence donnée par Géraldine Mallet et Agnès Carbonell, cette dernière, fille de la défunte, ayant remarquablement évoqué l’épisode peu connu de la récupération par Yvette Carbonell-Lamothe du reliquaire byzantin de saint Jean-Baptiste, volé à la cathédrale de Perpignan.

Séance du 7 mars 2023
Communication longue de Valérie Rousset et Virginie Czerniak, L’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Toulongergues (Aveyron).
Lire le compte-rendu
L’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Toulongergues (commune de Villeneuve en Aveyron) est l’un des plus remarquables édifices à angles arrondis du Rouergue. Classée Monument historique en 1988 après avoir été convertie en grange-étable après la Révolution, l’église a retrouvé son statut en 1984 avec son rachat par la commune et à la suite de plusieurs phases de restauration.
Des fouilles menées dans la nef et l’abside ont mis au jour en 1988 une nécropole des VI-VIIe siècles, recoupée par les fondations de l’église datée par radiocarbone de la seconde moitié du Xe ou du début du XIe siècle.
L’édifice en « double boîte » se caractérise par une nef haute et étroite dans laquelle s’ouvrent des porte « en entrée de serrure » et des fenêtres en meurtrière. L’abside, quadrangulaire et voûtée d’un berceau légèrement outrepassé, est dotée d’arcatures doubles à l’intérieur desquelles sont conservés des colonnes et des bases en grès profilées de baguettes et de filets. Deux personnages ainsi que les pattes d’un équidé sommairement taillés dans la pierre de deux colonnes constituent des témoignages précieux auxquels sont associés deux chapiteaux retrouvés dans des comblements postérieurs. L’un deux porte un décor d’entrelacs et une scène qui pourrait figurer l’Entrée du Christ à Jérusalem.
Une phase d’embellissement a concerné l’abside, l’arc triomphal et une partie de la nef. Un enduit masquant la modénature et le décor sculpté antérieurs a été le support d’un remarquable ensemble peint. En dépit de sa complexité et de l’importance des lacunes, de nouvelles interprétations iconographiques peuvent être proposées et des pistes ouvertes pour l’analyse stylistique de ce décor pictural particulièrement singulier.

Communication courte de Valérie Rousset, Église Saint-Côme et Saint-Damien de Saint-Côme d’Olt (Aveyron) : une signature du XVIe siècle ?
Le portail occidental de l’église Saint-Côme (Saint-Côme d’Olt, Aveyron) présente deux vantaux remarquables sur lesquels s’inscrivent, non seulement le chronogramme de 1532 et les armes de la famille d’Estaing, mais des animaux, des bustes et des lettres onciales.
Présents : Mme Czerniak, Présidente, MM. Cabau, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier, Péligry, Bibliothécaire-Archiviste, Mmes Napoléone, Secrétaire générale, Machabert, Secrétaire adjointe ; Mmes Cazes, Fournié, MM. Cazes, Peyrusse, Scellès, Stouffs, Surmonne, Testard, membres titulaires ; Mmes Caucanas, Ledru, Rolland Fabre, Rollins, Rousset, M. Laurière, membres correspondants.
Excusés : Mmes Balty, Jaoul, Pradalier, MM. Balty, Dubois, Garland, Garrigou Grandchamp, Kérambloch, Pradalier, Tollon.
Invitée : Jeanne Péligry.
La présidente ouvre la séance et fait un accueil chaleureux à Lanny Rollins, nouvellement élue membre correspondant de notre Société.
Elle donne ensuite les résultats de la commission de la Société sur les travaux présentés au concours de cette année. Sur sept travaux présentés, quatre ont été primés :
Esteban Demesteere L’affaire de Najac (1249-1258), mémoire de master II en histoire médiévale sous la direction du professeur Laurent Macé, soutenu à l’Université de Toulouse 2 Jean-Jaurès, est distingué par le Prix de Clausade.
Dès les premières pages du premier volume de 238 pages, le rapporteur est saisi devant la rigueur d’écriture et de relecture ainsi que la clarté des arguments, présentés dans une langue aussi claire que rigoureuse. Il ne m’a pas permis de trouver une faute d’orthographe et de français ni en latin, sauf un accent sur Dom Devic.
Cette première impression se concrétise à la découverte de l’organisation rigoureuse de l’enquête.
Dans son introduction, M. Demesteere plante le décor, le contexte général, les personnages auxquels il va s’attacher et la méthodologie qu’il va mettre en œuvre.
Le premier chapitre du mémoire est remarquable pour un jeune étudiant dans sa rigueur scientifique et sa capacité à interroger les sources et la bibliographie dont il fait non seulement l’historique mais aussi une critique historiographique qui témoigne de la maîtrise de son sujet, convoquant l’histoire, l’archéologie, l’histoire politique et religieuse, etc.
C’est sans aucun doute cette aisance parmi les sources qui lui permet de se sentir chez lui dans ce castrum et ses habitants du XIIIe siècle, décrit dans le deuxième chapitre.
Après un important travail de transcriptions et de traduction du latin, le chercheur aurait pu s’arrêter là, mais il mobilise bien d’autres sources comme la géographie avec des cartes remarquables et l’archéologie dans son troisième chapitre.
Ce n’est qu’après toutes ces approches, fortes utiles par la suite, qu’au chapitre IV, il en vient au cœur du sujet, la révolte de Najac de 1249 dont il propose une chronologie. Une démarche qui a la particularité de ne s’appuyer que sur les sources médiévales, relues et décortiquées avec un sens critique qui l’honore, mais il est aussi un conteur très précis des évènements et n’en s’en laisse pas compter par les sources partisanes du Moyen Âge et d’aujourd’hui.
De cette affaire, somme toute modeste, M. Demesteere fait un exemple d’approche sociologique des groupes qui habitent Najac, parfois unis, parfois déchirés, alliés ou antagonistes : les coseigneurs de Najac, les grands perdants de la révolte, les consuls et les marchands et les consuls et les autres habitants.
Dans le chapitre VI, l’auteur pose la question de la révolte, comme il l’a fait déjà fait dans le titre de son mémoire en utilisant prudemment le terme d’affaire, plutôt que de révolte. Dans le chapitre suivant, il en vient à la conclusion de la révolte ainsi que ses conséquences, la répression et l’instrumentalisation. C’est ici que s’inscrit l’épisode « cathare » sur lequel le chercheur reste prudent et y voit à juste titre un prétexte pour l’évêque de Rodez et le sénéchal comte de Toulouse à s’enrichir. En effet, même s’il est vrai qu’il y a des hérétiques à Najac, l’hérésie n’a joué aucun rôle dans la révolte de Najac, mais par contre dans son instrumentalisation pour se débarrasser des vaincus.
Enfin, l’auteur montre bien l’emprise du nouveau pouvoir capétien par la construction de la forteresse de Najac, tout en redonnant aux Najacois leur charte de coutumes, mettant en pièces la légende « des méchants capétiens et des gentils raimondins ».
La conclusion du mémoire est aussi claire que le reste, même si le lecteur serait intéressé par l’esquisse de nouvelles perspectives de recherches que ce beau volume fait deviner.
Le deuxième volume du mémoire comporte de très nombreuses pièces présentées par le texte original et leur traduction, ainsi que des tableaux onomastiques.
On l’aura compris, le travail effectué par M. Destemeere est d’une qualité remarquable en tous points et l’on trouve rarement parmi les jeunes chercheurs, aussi bien dans la forme que dans le fond, et nous espérons qu’il puisse persévérer dans cette voie où il excelle.
Sergio Jiménez Manchón, Pratiques d’élevage entre l’Empordà et le Languedoc à l’âge du Fer, Archéozoologie, alimentation animale et saisonnalité, thèse sous la direction d’Armelle Gardessin, soutenue à l’Université de Montpellier 3 Paul-Valéry en 2020, est distingué par le Prix spécial de la Société Archéologique.
La thèse de Sergio Jiménez Manchón correspond à un volume unique de 543 p. Le document présente une grande qualité de forme avec une mise en page efficace, des illustrations de qualité, complétant parfaitement le discours.
La thèse a pour objectif de comprendre comment le contexte de changement apparu à la fin de la fin de l’âge du Fer se traduit dans le domaine de l’élevage. Pour répondre à cette problématique la thèse a été organisée en 6 chapitres : : 1. cadre de l’étude, 2. problématique, 3. matériel et méthodes, 4. résultats par sites, 5. confrontation, 6. synthèse générale.
En réalité, ce découpage intègre trois grandes parties bien équilibrées : présentation, problématique et méthodes, résultats par sites et synthèse/conclusion.
Le chapitre 2 dresse un bilan des hypothèses et des arguments jusque-là avancés sur l’élevage. Il liste les objectifs de la thèse : identifier le spectre faunique, connaître la gestion économique du troupeau, analyser les pratiques culinaires et de boucherie, analyser le régime alimentaire des animaux, étudier les rythmes saisonniers, identifier et décrire les processus taphonomiques et replacer les résultats dans leur contexte géographique.
Le corpus comprend 5 sites principaux (ch. 3). La méthodologie est très élaborée et associe des analyses jusque-là classiques à des approches peu courantes ou inédites pour déterminer l’âge, la saison d’abattage et les espèces…
Les résultats sont ensuite présentés par sites dans une partie analytique (ch. 4). Puis les données sont rassemblées et soumises à une discussion (Ch. 5). Celle-ci conduit à une synthèse générale (ch. 6).
Principaux résultats
L’auteur indique la prédominance de la triade domestique sur tous les sites. Les caprinés arrivent toujours en tête suivis le plus souvent du bœuf puis du porc. Il identifie des nuances : aux VIe et Ve s. le bœuf est surtout présent dans les zones littorales et les caprinés dans l’arrière-pays. Une plus grande variabilité se manifeste à la phase suivante (Ve-IVe s.).
Espèces : aux VIe et Ve s., les valeurs montrent une certaine homogénéité dans l’Empordà et une plus grande variabilité en Languedoc. A la phase suivante, la situation évolue peu en Empordà. En Languedoc, on note une augmentation du porc sur les sites urbains. Il en va de même du bœuf, par rapport aux caprinés. Cela souligne une forte demande en viande stimulée par le phénomène urbain.
Exploitation du troupeau : on observe une tendance générale dans les deux régions. Les animaux sont soit abattus jeunes, pour leur viande, soit gardés plus longtemps pour mettre à profit leurs produits secondaires. La tendance s’accentue durant la deuxième phase.
La taille des animaux : la taille moyenne des animaux est relativement basse. Ceci est d’autant plus vrai pour les bœufs. Ceci pourrait s’expliquer par la réduction de la mobilité de ces animaux et la difficulté d’accès aux pâturages.
Chasse : activité secondaire
Pratiques culinaires et boucherie : l’ensemble des étapes de traitement de la viande est représenté sur la grande majorité des sites. On peut donc en déduire que les carcasses arrivent entières sur les sites. Les techniques bouchères varient selon l’espèce. En revanche, le schéma de découpe apparaît similaire. Ces éléments signalent que l’activité bouchère est déjà normée et exercée sans doute par des spécialistes.
Les traces sur les ossements renvoient à des préparations de type bouillon ou cuisson directe.
Alimentation du bétail : l’analyse de la méso-usure et de la micro-usure des dents permet une première approche de l’alimentation des animaux. Les caprinés bénéficient d’un régime mixte, de type brouteur et les bœufs ont accès à une alimentation plus riche en graminées. Ces derniers ont un régime plus proche des paisseurs.
Fourrage : le recours au fourrage semble secondaire durant la période.
Espaces de stabulation : le porc est assurément présent dans la plupart des sites (zones de parcage ?).
Rythmes saisonniers : l’analyse des données disponibles permet d’identifier différentes tendances :![]() la mise bas se produit principalement au printemps chez les caprinés,
la mise bas se produit principalement au printemps chez les caprinés,![]() le troupeau se nourrit dans son milieu environnant,
le troupeau se nourrit dans son milieu environnant,![]() en été, les caprinés ont un régime plus pauvre en graminées,
en été, les caprinés ont un régime plus pauvre en graminées,![]() la réforme des adultes intervient principalement au printemps et en été, chez les caprinés,
la réforme des adultes intervient principalement au printemps et en été, chez les caprinés,![]() les caprinés jeunes sont tués tout au long de l’année,
les caprinés jeunes sont tués tout au long de l’année,![]() en automne et en hiver, une partie des caprinés sont gardés pour la lutte et la gestation,
en automne et en hiver, une partie des caprinés sont gardés pour la lutte et la gestation,![]() les bœufs ont un régime alimentaire riche en graminées. Ils sont mis à mort durant toute l’année contrairement aux caprinés adultes.
les bœufs ont un régime alimentaire riche en graminées. Ils sont mis à mort durant toute l’année contrairement aux caprinés adultes.
Au bilan, la thèse apporte de nouvelles données sur l’élevage entre les VIe et IVe s. Les résultats reposent, entre autres, sur trois types d’analyse novatrices : l’étude de la méso- et de la micro-usure dentaire et de la cémentochronologie.
Conclusion
La thèse de Sergio Jiménez Manchón concerne l’élevage et son économie à l’âge du Fer. C’est un travail de très grande qualité. Il n’échappe pourtant pas à quelques reproches. Ainsi, la question de la transhumance n’est pas du tout abordée. Or, il est difficile de parler d’élevage autour des Pyrénées sans au moins évoquer ce sujet. En outre, certaines hypothèses ne peuvent en l’état être validées. Elles mériteraient d’être confrontées à des études environnementales, réalisées au plus près des sites. Mais là, évidemment, l’auteur n’est pas seul en cause.
Malgré ces quelques remarques, on se doit de souligner la qualité de cette thèse, l’importance du corpus analysé et le caractère novateur du protocole d’étude mis en place. Parmi les nombreux résultats obtenus, plusieurs sont particulièrement significatifs. L’auteur démontre ainsi que le bétail était exploité au plus près des sites, dans des bois ou des zones ouvertes, en fonction des espèces. Plusieurs indices trahissent également une forte pression sur les terres agricoles, comme la réduction de la taille des animaux, signe de difficultés à trouver une nourriture adaptée. Un autre acquis de cette thèse concerne le porc, qui se développe comme corollaire de la croissance urbaine. De mon point de vue, cette thèse est novatrice et de grande qualité. Elle ouvre des perspectives multiples sur l’étude de l’élevage avant la conquête romaine.
Andréa Calestroupat, Du Roi à l’industrie : le règne minéral des marbres de Saint-Béat (XVIe siècle-début XXe siècle), mémoire de master II sous la direction d’Emmanuel Charpentier et Pascal Julien, soutenu à l’Université de Toulouse 2 Jean-Jaurès, est distingué par la médaille de la Société Archéologique.
![]() Originalité du sujet
Originalité du sujet
Le candidat aborde le sujet d’emblée par une approche intéressante : il interroge la réception et la mémoire de l’activité et du matériau. Il s’inscrit, en mettant au premier plan de sa problématique le matériau, dans une tendance historiographique récente, d’autant plus qu’il veille à placer le marbre dans la société des artisans qui l’exploite, mais également dans le système économique qui se bâtit autour de lui. Si le choix chronologique du traitement du sujet est assez classique, il s’avère à la lecture qu’il s’impose pour donner une dynamique et un tempo à la description de l’activité. Son propos s’inscrit donc dans une démarche actuelle de la recherche, tout en s’imposant comme synthèse des travaux antérieurs déjà effectués sur le thème ou sur le site. Son travail a donc l’intérêt d’une étude de l’activité humaine, technique et économique d’un site sur le temps long.![]() Méthodologie
Méthodologie
L’argumentaire du candidat est clair et structuré. L’appareil critique est solide, et le texte est agrémenté des figures, cartes et éléments de preuves indispensables à la lecture. Le lecteur, même novice au sujet, ne se perd pas et a en main tous les éléments de compréhension indispensables. Les annexes sont très complètes : sources, bibliographie très fournie, du peu que je puisse en juger vu mon manque d’expertise fine sur le sujet, documents transcrits et figurés. Il est aussi à noter la présence fort utile d’un glossaire. Il est peut-être regrettable d’avoir articulé le plan en seulement deux parties, une troisième aurait pu, peut-être, permettre le déroulé de la réflexion de manière plus fine, mais dans l’ensemble cette objection est contrebalancée par un texte bien construit et facile à suivre.![]() Qualité de l’écriture
Qualité de l’écriture
Le style est clair, l’argumentaire pertinente et la langue française, autant dans sa syntaxe que son orthographe, maîtrisée. Notons également que le candidat fait preuve d’une grande maîtrise dans la transcription des textes historiques, appliquant à la fois les normes correctement, mais également rythmant les textes transcrits avec une ponctuation utilisée à très bon escient.![]() Maîtrise du sujet
Maîtrise du sujet
Le candidat, vu la difficulté de son sujet, réussi brillamment à montrer sa maîtrise des différentes problématiques liées au thème, surtout déclinées dans un temps long. Il fait preuve d’une maîtrise du sujet, au sens où : 1, il mobilise les notions et concepts adéquats, 2, il s’appuie à juste titre sur les travaux existants tout en les requestionnant, 3, il expose un appareil critique très complet et des sources choisies avec pertinence.
Julia Faiers, Power, Piety and Legacy : the Patronage of Bishop Louis d’Amboise in fifteenth Century Languedoc, thèse soutenue à l’Université de St-Andrews (Écosse) en 2020, est distinguée par la médaille de la Société Archéologique
Mme Julia Faiers, de nationalité anglaise, a soutenu en décembre 2020 à l’Université de Saint-Andrews, Écosse, une thèse sous la direction du professeur Katerin Rudy pour l’obtention du grade de PhD (Doctor of Phylosophy). Ce travail, intitulé Power, Piety and Legacy : the Patronage of Bishop Louis d’Amboise in fifteenth Century Languedoc, est consacré aux commandes de Louis Ier d’Amboise, évêque d’Albi à la fin du XVe s. Il consiste en un volume de 421 pages, illustrations (au nombre de 178) et annexes comprises.
Si le sujet n’est pas inédit côté français, en revanche, l’approche scientifique retenue pour aborder le sujet est plus originale pour des médiévistes français. En effet, le travail de Mme Faiers s’inscrit dans la tradition anglo-saxonne de la sociologie de l’art de ces toutes dernières années, approche peu représentée en France chez les médiévistes de nos jours. Le propos est clair dès l’introduction. Il ne s’agit pas de poursuivre une tradition historiographique proposant de nouvelles lectures iconographiques ou attributions à tels ou tels artistes, mais de lire autrement les œuvres commandées et les ouvrages réalisés. Pour cela, la candidate s’appuie uniquement sur les œuvres conservées. Ces sources sont alors regardées autrement que comme la pure et simple manifestation de piété du prélat, comme cela a toujours été présenté par l’historiographie. En effet, Julia Faiers interroge les réalisations de Louis d’Amboise sous l’angle du politique avec des commandes exécutées à tels moments souvent pour répondre à tel contexte, en questionnant notamment la prolifération de l’écu familial sur l’ensemble des ouvrages. Ainsi sa réflexion l’a amené à proposer une analyse convaincante et renouvelée de certaines des commandes du prélat.
Pour cela, le plan de la démonstration, puisqu’il s’agit d’une longue dissertation, est à la fois classique et simple et s’article en 7 chapitres, souvent solides et bien documentés : le premier est consacré aux sources et à l’historiographie, le deuxième aux Amboise aux XVe siècle, puis à partir du suivant, à l’analyse des œuvres (chœur et jubé d’abord, peinture du Jugement Dernier ensuite, palais de la Berbie et clocher de la cathédrale, les travaux à la chapelle de la résidence de Combéfa, puis la plate-tombe conservée dans la chapelle d’axe de Sainte-Cécile d’Albi).
Le travail de recherche est solide et réfléchi, lequel manifeste un sens critique et de la réflexion indéniable, soutenu par une bibliographie référencée plutôt complète et pertinente, même si quelques manques sont à regretter comme notamment les rapports du P.C.R. dirigé par Bernard Pousthomis consacré à la Berbie, rapports pourtant connus de Mme Faiers qui lui aurait permis de revoir une grande partie de son chapitre 6, le moins convaincant de l’ensemble en raison de l’utilisation de données erronées. Il peut être souligné que les sources et les œuvres sont bien exploitées et que les conclusions qu’elle en tire constituent souvent de nouveaux apports à la compréhension de ces réalisations et un parfait complément à l’historiographie existante.
Ainsi, dans les chapitres 2 et 3, les véritables acteurs de la commande et de la gestion des ouvrages, recrutés parmi les religieux de sa cathédrale, sont interrogés, le parcours de ceux du mobilier de cuivre de 1484 est ainsi retracé et l’identité de ceux de l’ensemble de la clôture est avancée et remporte l’adhésion. Dans le chapitre 6, c’est le modèle de la composition des carreaux de pavement de la chapelle de Combéfa qui a été retrouvé en Espagne dans une réalisation datée de vers 1420. La peinture du Jugement Dernier est, quant à elle, comprise par rapport au statut de l’évêque en tant que juge ecclésiastique et seigneur temporel de la ville, notamment après la révolte des Albigeois en 1491 contre le prélat, en tant que réformateur de la justice en Languedoc dans les années 1480. Les commandes sont alors l’occasion pour Louis d’Amboise d’affirmer son autorité en tant qu’évêque et seigneur d’Albi et d’insister sur son rôle d’intermédiaire entre son peuple et Dieu. La multiplication des armes familiales à la vue de tous serait, selon l’auteur, un moyen de signifier sa présence pendant ses nombreuses absences. Tels sont quelques-uns des points forts, qui sont nombreux, de l’étude de Mme Faiers.
Le texte est agréable à lire avec des parties bien construites, terminées par des transitions bien amenées. Néanmoins, il souffre de quelques répétitions et l’appareil de notes, par rapport à un travail français, mériterait d’être enrichi car parfois un peu lapidaire. Dans le chapitre historiographique et en ce qui concerne les œuvres, curieusement, seule la cathédrale est évoquée ; rien sur Combéfa ou la Berbie pour lesquels les références sont pourtant analysées plus tard dans le manuscrit. Enfin, quelques petits problèmes méthodologiques peuvent être signalés, comme l’absence d’approche stylistique pour l’étude des peintures de la galerie d’Amboise par exemple, peintures aujourd’hui datées de vers 1600, ou comme la restitution critiquable des dispositions de la chapelle castrale de Combéfa à partir de plans dressés en 1777.
Quoi qu’il en soit, le travail proposé par la candidate est de grande qualité et mériterait une reconnaissance.
Trois autres travaux n’ont pas été retenus :
![]() Léonard Granier, Criminalité de misère, criminalité contre les mœurs : les femmes face à la justice royale roussillonnaise dans la première moitié du XVIIIe siècle. Mémoire de master II en histoire sous la direction de Patrice Poujade, soutenu à l’Université de Perpignan-Via Domitia en 2022 ;
Léonard Granier, Criminalité de misère, criminalité contre les mœurs : les femmes face à la justice royale roussillonnaise dans la première moitié du XVIIIe siècle. Mémoire de master II en histoire sous la direction de Patrice Poujade, soutenu à l’Université de Perpignan-Via Domitia en 2022 ;![]() Valentin Girounès, Les artisans de Cordes-sur-Ciel du XIIIe au XVe siècle, mémoire de Master II « Mondes médiévaux » sous la direction de Sandrine Victor, maître de conférence habilitée à diriger des recherches à l’Institut National Universitaire Champollion d’Albi, soutenu à l’Université Toulouse 2 Jean-Jaurès ;
Valentin Girounès, Les artisans de Cordes-sur-Ciel du XIIIe au XVe siècle, mémoire de Master II « Mondes médiévaux » sous la direction de Sandrine Victor, maître de conférence habilitée à diriger des recherches à l’Institut National Universitaire Champollion d’Albi, soutenu à l’Université Toulouse 2 Jean-Jaurès ;![]() Mariana Burasovitch, Entre art et entreprise : approche matérielle des peintures murales du Midi exécutées par des décorateurs italiens itinérants (v. 1820-1870), master en histoire de l’art moderne et contemporain sous la direction de Sophie Duhem et de Virginie Czerniak, soutenu à l’Université de Toulouse 2 Jean-Jaurès en 2022.
Mariana Burasovitch, Entre art et entreprise : approche matérielle des peintures murales du Midi exécutées par des décorateurs italiens itinérants (v. 1820-1870), master en histoire de l’art moderne et contemporain sous la direction de Sophie Duhem et de Virginie Czerniak, soutenu à l’Université de Toulouse 2 Jean-Jaurès en 2022.
Le classement est soumis au vote des membres ; il est accepté à l’unanimité. Virginie Czerniak rappelle que les prix seront remis lors de la séance publique qui se tiendra dimanche 26 mars.
La parole est enfin donnée à Valérie Rousset pour une communication longue qu’elle assurera avec notre Présidente, L’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Toulongergues (Aveyron).
Raymond Laurière, qui connaît l’édifice depuis longtemps, rappelle qu’il a mis au jour dans les années 1975 une partie des peintures dont il a été question. Il dit avoir apprécié un certain nombre des hypothèses présentées, sans en partager pour autant la totalité. Il y a quelques années de cela, à l’occasion d’une communication à la Société, il avait présenté quelques propositions d’interprétation auxquelles il reste fidèle. En premier lieu, concernant la baie couverte d’un arc en gouttière qui s’ouvre sur la façade, il retient l’hypothèse de Marcel Durliat, qui en faisait le lieu où on pouvait loger une cloche, en référence à ceux qui se trouvent sur les églises wisigothiques d’Espagne. Par ailleurs, à l’occasion de fouilles menées par Laurent Fau, des monnaies ont été trouvées ; elles pourraient dater d’avant l’an Mil, en particulier un denier du Puy. Quant à la colonne sculptée d’un personnage, il retient la proposition que notre Trésorier avait faite, lors de son passage à Toulongergues, d’y voir plutôt que Pierre et Paul, le sacrifice d’Abraham. Abraham serait sur la colonne de gauche avec Isaac, sur la colonne de droite le quadrupède qui serait l’animal sacrifié à la place d’Isaac. Concernant les peintures, il s’étonne que le nom de Matthieu n’ait pas été cité en face de Jean lorsqu’il a été question du tétramorphe. Notre Présidente répond qu’elle pense l’avoir cité en présentant ce décor. Raymond Laurière se dit intéressé par l’hypothèse d’un collège apostolique faite pour la première fois par Marcel Durliat dans les années 1970. Pour lui cependant ces personnages, très semblables et sans attributs, doivent évoquer les 24 vieillards de l’Apocalypse, d’autant que le reste de l’iconographie lié à une évocation de l’Apocalypse permet de les associer. Par ailleurs, il ne voit pas où pourrait prendre place le Christ en Majesté dont elle a parlé. Notre Présidente répond qu’il a pu être peint sur la voûte. Raymond Laurière évoque ensuite le mur du chevet actuellement bétonné et cimenté là où se trouvait une ouverture moderne. Il rappelle que l’église a été désacralisée en 1921 puis achetée par M. Jonquière qui a transformé l’édifice en bâtiment agricole. Il a pu recueillir plus tard le témoignage de Mme Jonquière, qui avait vu représentés sur ce mur « des chevaux à tête d’homme ». Pour la partie inférieure située entre les colonnes, il reste persuadé qu’il s’agit d’un trône vide. Notre Présidente lui fait remarquer que le travail de restauration a permis de faire apparaître les plis d’un vêtement. Raymond Laurière évoque les hétimasies représentées dans le monde byzantin qu’il faut mettre en relation, selon lui, avec les personnages représentés de part et d’autre : Saint Jean et la Vierge ou Adam et Ève. Il se dit enfin très intéressé par l’analyse du personnage couché.
Notre Présidente remercie Raymond Laurière et donne la parole à Quitterie Cazes pour d’autres remarques. Notre consœur remercie les conférencières pour cette présentation et voudrait proposer une autre interprétation pour le personnage couché. Elle se demande en effet s’il ne s’agit pas du songe de saint Jean de l’Apocalypse car le bâtiment représenté derrière montre trois portes et la Jérusalem céleste en compte douze, trois sur chaque côté. Le personnage est bien figuré en train de dormir, c’est la raison pour laquelle on a pu penser qu’il s’agissait de la Dormition de la Vierge. Virginie Czerniak fait remarquer que le bâtiment représenté à l’arrière montre des lacunes dans ses parties hautes et qu’il reste donc difficile à interpréter. Selon elle, l’identification de Paul, confortée par les lanières représentées sur le corps, lui paraît séduisante par rapport à la titulature de l’église et l’interprétation que Jean-Claude Fau avait faite des sculptures. Louis Peyrusse pense que Paul sortant de sa geôle ne devrait pas avoir une position allongée. Virginie Czerniak évoque l’autre hypothèse d’interprétation imaginée par Jacques Lacoste qui serait celle du moment où Pierre, emprisonné, est désespéré d’être abandonné et implore le Christ de le sortir de sa cellule. Toutes ces hypothèses sont à discuter, mais il faut, selon elle, exclure la Dormition de la Vierge. Daniel Cazes fait remarquer que, dans toutes les représentations de la descente de saint Paul de sa tour, il est dans un panier ; ici le personnage est allongé, il donne l’impression d’être endormi et que rien ne le porte. Virginie Czerniak rappelle que les yeux ne sont pas visibles et, même si le personnage semble allongé, le traitement spatial de la scène n’est pas fiable. Par ailleurs les deux lanières représentées au-dessus semblent selon elle le retenir. Elle note enfin que le sujet traité n’est pas fréquent et on peut imaginer un cycle hagiographique dédié à Pierre et Paul, ce qui reste dans la tradition narrative de la peinture romane.
La Présidente donne à nouveau la parole à Valérie Rousset pour une communication courte intitulée Église Saint-Côme et Saint-Damien de Saint-Côme-d’Olt (Aveyron) : une signature du XVIe siècle ?
Après avoir montré un motif gravé à la base d’un escalier, notre consœur sollicite l’assemblée pour interpréter celui-ci. Louis Peyrusse demande si Antoine Salvan n’aurait pas laissé à Rodez des traces similaires. La visite du clocher de Rodez n’a rien donné répond Valérie Rousset. Celle-ci certifie par ailleurs qu’il ne s’agit pas d’une marque de tâcheron et qu’aucune autre trace de ce type n’a été trouvée dans l’édifice.
Virginie Czerniak donne enfin la parole à Daniel Cazes pour un compte rendu de sa visite à Chiragan.
Notre confrère rappelle que le sentier « Garona », initiative du département de la Haute-Garonne, relie à pied Toulouse au Val d’Aran. Ce sentier est désormais presque en place, hormis quelques obstacles administratifs et ponctuels qui se dressent encore sur la voie. Le Département veut développer cette voie par des boucles et nous sommes concernés par l’une d’elle qui part de Mauran, traverse la Garonne et une partie de notre site archéologique de Chiragan pour rejoindre ensuite le quartier de Saint-Vidian. Elle traverse après à nouveau la Garonne par le barrage EDF et retrouve la voie principale. Daniel Cazes rappelle l’inondation importante survenue l’année dernière. À cette occasion, le Département s’est rendu compte que l’itinéraire passant sur nos terres devait être modifié. La réunion à laquelle M. Cazes a participé avait pour but de discuter de la variation de celui-ci. Il rappelle qu’il y a six partenaires : la Société Archéologique, la Mairie de Martres, le Département de la Haute-Garonne, la Direction Départementale des Territoires, un nouveau Service de l’État appelé Natura 2000 et la Communauté de Communes Cœur de Garonne, dont fait partie Martres-Tolosane. Retenons l’intervention de Natura 2000, qui a découvert le site archéologique mais aussi le site naturel extraordinairement préservé où un certain nombre d’espèces de plantes et d’oiseaux, de reptiles et autres ont été inventoriées. Au vu de ce patrimoine naturel, ce Service s’est opposé au premier projet du Département, craignant que le passage ne nuise à celui-ci. Il a donc proposé de faire passer le sentier ailleurs. En conclusion : pour éviter le passage dans les zones inondables et riches en biodiversité, et réduire les problèmes d’entretien du sentier (dont le Département est responsable), le promeneur arrivera sur notre terrain, en passant sur l’écluse du canal du Moulin, sur laquelle le Département va poser une passerelle métallique, et au lieu de faire le tour du site, il se contentera de le longer. Il a été estimé par ailleurs que trois panneaux didactiques suffiraient, l’information étant donnée de telle sorte qu’elle soit utilisable dans les deux sens. Cette modification d’itinéraire sera ratifiée par notre Présidente en juin-juillet. L’inauguration serait prévue pour le mois d’octobre, la Société sera bien sûr invitée. La Présidente remercie notre confrère de suivre ce dossier.
Au titre des questions diverses, Louis Peyrusse annonce que Mme Marie-Laure Le Brasidec, numismate et une des commissaires de l’exposition Cartailhac, a adressé à notre confrère, ainsi qu’à Christian Péligry, un article sur les jetons et les médailles du Canal du Midi. Celui-ci est consultable sur le site de la revue électronique de la Région, Patrimoine du Sud. Notre Trésorier pense qu’il s’agit d’une étude beaucoup plus globale portant sur l’eau puisqu’il a vu un autre article sur les puits à Toulouse. Laure Krispin a fait un recensement de tous les puits publics et privés de la ville avec cartographie consultable également sur ce site.
Pour information également, Virginie Czerniak dit avoir reçu un lien pour effectuer une visite virtuelle de l’exposition « Toulouse 1300-1400 » au Musée de Cluny ; elle pense qu’il serait opportun de le mettre sur notre site. Il faudra également signaler le petit film diffusé sur You tube sur le site du Scribe accroupi ajoute Louis Peyrusse. Cela permettra aux membres qui n’ont pas pu visiter l’exposition de s’en faire une petite idée.

Séance du 14 février 2023
Communication longue de Gilles Séraphin, L’église abbatiale de Conques, une histoire en discussion.
Lire le compte-rendu
L’abbatiale de Conques a fait l’objet récemment de deux études importantes l’une due à Éliane Vergnolle, Nelly Pousthomis et Henri Pradalier, l’autre à LeÏ Huang. En prenant le contrepied des thèses anciennes, elles convergent quant à l’interprétation de l’édifice et quant à sa place dans l’histoire de l’architecture. Ont-elles pour autant épuisé les questionnements que suscitent les nombreuses discordances qui semblent résister encore à l’analyse. En bref, le scénario historique consensuellement retenu aujourd’hui est-il le seul possible ?
Présents : Mme Czerniak, Présidente, M. Péligry, Bibliothécaire-archiviste, Mmes Napoléone, Secrétaire générale, Machabert, Secrétaire-adjointe ; Mmes Andrieu, Cazes, Jaoul, Pradalier-Schlumberger, MM. Cazes, Garland, Garrigou Grandchamp, Lassure, Peyrusse, Pradalier, Sournia, Stouffs, Testard, membres titulaires ; Mmes Ledru, Rolland Fabre, MM. Bru, Dubois, Kerambloch, Pousthomis, Rigault, Séraphin, membres correspondants.
Excusés : MM. Ahlsell de Toulza, Cabau, Tollon ; Mme Hénocq.
La séance ouverte par la Présidente débute par l’élection d’un nouveau membre correspondant. Jacques Dubois présente le rapport de candidature de Mme Lannie Rollins.
Quitterie Cazes souligne le dynamisme de la candidate, et Virginie Czerniak confirme l’excellence de son travail et l’intérêt de son parcours. Lannie Rollins est élue membre correspondant de notre Société à l’unanimité des 15 suffrages exprimés.
Henri Pradalier nous informe ensuite que Jacqueline Carabia a fait don de 72 volumes des Dossiers de l’archéologie et d’Archéologia, qui viennent compléter ceux qu’elle avait déjà donnés. Au nom de la Société, la Présidente remercie la donatrice.
Elle donne ensuite la parole à Gilles Séraphin pour sa communication longue sur : L’église abbatiale de Conques, une histoire en discussion.
La Présidente remercie notre confrère pour l’intérêt de sa présentation. Louis Peyrusse souhaite savoir pourquoi Jacques Bousquet n’a pas été mentionné dans l’historiographie ? Gilles Séraphin répond qu’il n’a pas été cité lors de la communication mais qu’il est évident que, dans le cadre d’une publication, Jacques Bousquet et ses travaux sur la sculpture du Rouergue seraient incontournables. Louis Peyrusse rappelle que l’historien a proposé des dates hautes. Il était d’ailleurs sur ce point en désaccord avec Marcel Durliat, son directeur de thèse, complète Gilles Séraphin. Quitterie Cazes souligne l’intérêt des questions soulevées par notre confrère. Elle remarque cependant que certaines affirmations sont, de façon inexacte, attribuées à Lei Huang, auteur de la thèse L’abbatiale Sainte-Foy de Conques (XIe-XIIe siècles). Par exemple, ce dernier n’a pas dit que les traces de tailles anarchiques ou obliques se succédaient dans le temps. Il ne fait pas des traces de taille un argument chronologique, en revanche il en fait un argument de géographie artistique, c’est-à-dire qu’il opère un rapprochement avec l’Auvergne. Gilles Séraphin, reprend : il fait référence pour la taille alternée en épis à l’architecture auvergnate en expliquant que, puisqu’à Conques on est au XIe siècle, l’architecture auvergnate date donc de la même période. Quitterie Cazes poursuit : la datation tardive des églises auvergnates avancée par Bruno Phalip, suivi par David Morel, est très discutée ; les études de Jean Wirth, notamment, sont importantes. Elle insiste ensuite sur la nécessité de mettre en perspective cette étude de Conques avec une observation de Compostelle. Par exemple, Bernardus, mentionné sur un chapiteau à Conques, est également présent sur deux chapiteaux à l’entrée de la chapelle d’axe de Saint-Jacques de Compostelle parfaitement datés de 1075. Le sculpteur de Conques intervient également sur les tympans de Compostelle, mis en place au plus tard en 1108 (même s’il y a des remaniements du portail, ils sont en place tels que décrits par l’auteur du Guide du pèlerin au plus tard en 1130). Ainsi, en se rendant à Compostelle, les problèmes de datation seront complètement réévalués.
Henri Pradalier souhaite revenir sur l’évolution de la recherche ces vingt dernières années concernant les chronologies. Le constat est fait qu’il y a eu une tendance, à l’époque de Marcel Durliat et un peu avant, à dater trop bas, tant pour la fin du Xe siècle que pour le XIe siècle. Cette vision a évolué, l’idée que l’an 1000 marque le début de l’art roman a été déconstruite, puisque l’on peut remonter facilement à 975 pour voir commencer à apparaître cette renaissance d’une architecture nouvelle que l’on appellera romane au XIXe siècle. Des exemples fréquents sont connus en Catalogne en particulier. Aussi, il y a eu une remontée générale des chronologies depuis 25 ans, c’est le cas pour Saint-Sernin comme à Conques. Henri Pradalier revient ensuite sur le réemploi des chapiteaux du déambulatoire et des chapelles de l’abbatiale de Conques. S’il est d’accord avec l’hypothèse de ces réemplois, pour lui cela ne signifie pas que le chevet a été reconstruit dans son intégralité. Il mentionne Éliane Vergnolle qui considère que les « fameuses » fissures ont effectivement entraîné une reconstruction, mais, selon elle, il s’agit de la reconstruction du rond-point du déambulatoire et de l’abside, pas des chapelles rayonnantes ni du reste du chevet. Le remploi de chapiteaux, éventuellement destinés à conférer au monument un air de plus grande ancienneté, peut s’être produit à des moments divers de l’avancement de la construction. La récupération et la réutilisation de chapiteaux des origines peut ainsi apparaître parfois au sommet du clocher, comme c’est le cas à Uzès et à Saint-Sernin, explique Henri Pradalier. Il se dit également gêné par la méthode qui consiste à dater systématiquement les motifs signalés quelque part par la date la plus récente. Or, ce n’est pas parce qu’un motif, de détail qui plus est, est observé sur un édifice en 1180, qu’il date de cette même période à Conques. L’approche chronologique peut être inversée : il est possible de penser qu’il date de 1100 à Conques, et qu’en 1180 il est encore exécuté ailleurs. Puis il revient sur l’étude, extrêmement complexe, du massif occidental. Éliane Vergnolle postule qu’à l’origine une tour-porche était prévue et, qu’au cours des travaux, un changement est opéré, entraînant les bouleversements décrits lors de la présentation (passages pour remplacer les tribunes, retombées des arcs décalées…). Il y a eu un changement de parti dans l’extrême partie occidentale, de façon à faire arriver la nef jusqu’au revers de la façade, alors qu’à l’origine la première travée de la nef est beaucoup plus large que les autres. Au sujet de la largeur de la première travée, Gilles Séraphin ajoute qu’un double portail était prévu. Puis Henri Pradalier s’intéresse à la coupole de la croisée du transept et note qu’il y a, aux trompes d’angles, des sculptures qui s’apparentent à celles du tympan – de moindre qualité, en particulier les têtes des évangélistes – mais cela permet de dater cette partie (au moins les trompes) d’une même phase que le tympan. La partie datée plus tard se retrouve-t-elle au portail de Beaulieu ? demande Henri Pradalier. Gilles Séraphin explique que Beaulieu n’est malheureusement pas daté avec certitude ; en revanche Aubazine l’est : la date de la pose de la première pierre est connue.
Henri Pradalier poursuit : pour Conques il existe aussi les textes qui disent qu’Odolric avait bâti la majeure partie de l’édifice, ce qui laisse supposer qu’il y avait déjà son enveloppe. La construction débutant par l’Est, l’édifice antérieur a dû être englobé, avec les difficultés qui peuvent expliquer les « chameaux » visibles à l’extrémité orientale de l’abbatiale. Virginie Czerniak et Gilles Séraphin relèvent que les incohérences détectées sont néanmoins très nombreuses. Pour Henri Pradalier elles tiennent aussi au plan choisi. Il pense qu’au départ les problèmes du chantier ne sont pas maîtrisés. Cette partie de l’édifice date d’avant 1065. Après avoir commencé par les parties orientales, il a fallu bâtir le pourtour pour pouvoir procéder à la dédicace de l’église. En effet, le rituel pour cette cérémonie est précis : l’évêque doit faire un cheminement à l’intérieur de l’édifice qui implique que l’enveloppe soit déjà construite, voire les premières bases des colonnes. Gilles Séraphin répond : si les murs périphériques sont implantés d’abord, comment expliquer les erreurs pour les portails du transept ? Henri Pradalier en revient au plan pour plus de clarté : le chevet est divisé en trois chapelles dédiées à la Vierge, au Sauveur et à saint Pierre. Il y avait un accès direct pour les pèlerins aussi bien pour la chapelle de la Vierge que pour la chapelle Saint-Pierre. Au niveau du bras sud se trouve l’accès pour les moines. Gilles Séraphin s’interroge : si le mur de la nef est déjà mis en place, pourquoi la corniche du portail du bras sud le percute-t-elle ? Henri Pradalier répond que le mur de la nef n’est peut-être pas mis en place sur cette hauteur. Compte-tenu du travail, de qualité, que représente la taille des ouvrages de cette zone, leur implantation a nécessairement été réfléchie, ajoute Gilles Séraphin. Henri Pradalier évoque ensuite la chronologie du portail. Quitterie Cazes rappelle que, si Marcel Durliat proposait une date entre 1130 et 1140, c’est qu’il pensait que les tympans de Compostelle étaient plus anciens car d’exécution plus approximative ; que la réalisation de la porte Miègeville, où l’expression est plus claire, intervenait ensuite ; et que Conques clôturait la série, car l’édifice est bien ordonné et plus grand. Cependant, il a été montré que les tympans de Compostelle ont été conçus et réalisés dans les années 1100-1108 poursuit Quitterie Cazes.
Gilles Séraphin réaffirme deux convictions sur le début et la fin de la construction. Il est convaincu que le chantier se clôture par la tour-clocher ; or son terminus ante quem se situe plutôt en 1160-1180, le chantier n’est donc pas fini à cette date. Pour la borne de début, il s’appuie sur les réemplois des chapiteaux du XIe siècle relevés en nombre dans le chevet et qui impliquent qu’ils sont postérieurs à l’église du XIe siècle dont ils sont issus. Quitterie Cazes souligne que ces chapiteaux peuvent être du Xe siècle, ce qu’approuve Henri Pradalier. Dans ce cas on est en contradiction totale avec toutes les estimations chronologiques de ce type de chapiteaux des autres églises, répond Gilles Séraphin. Quitterie Cazes précise que pour ces chapiteaux à entrelacs on est dans des types qui durent très longtemps ; il n’est donc pas possible de dater cette sculpture avec précision car il y a une permanence. Cette sculpture est caractéristique de la grande floraison carolingienne, qui est un moment très prestigieux, si bien qu’elle est reprise et répétée. Henri Pradalier appuie : il y a d’ailleurs un exemple à Conques puisque dans un des chapiteaux avec entrelacs (4e support de la nef), il y a une citation de ce qui se trouve dans l’abside. Gilles Séraphin considère qu’il s’agit plutôt d’une citation de chapiteaux auvergnats qui présentent la même référence, notamment à Issoire. Pourquoi Conques aurait imité Issoire et pas l’inverse, demande Henri Pradalier. Gilles Séraphin n’est pas d’accord avec cette possible antériorité, les mêmes débats se posent sur les liens entre Moissac et l’architecture limousine. Certes il est possible de discuter de la place dans l’histoire de l’art roman auvergnat, concède Gilles Séraphin ; lui s’est fondé sur les travaux de Morel et Phalip. Si leur théorie est exacte, cela pose question, surtout que l’on a un chantier qui part d’une église reconstruite après destruction vers 1100 et s’achève en 1180, argumente-t-il. Il ne lui semble pas impossible que la sculpture soit de 1110-1120, toutefois il ne croit pas qu’elle puisse être de 1170 en raison de l’état du chevet. En revanche Gilles Séraphin n’exclut pas qu’une grande partie du chantier soit exécutée dans la partie haute de la fourchette chronologique. Il cite comme références Duravel, dont des chapiteaux très proches datent d’après 1055, et Aurillac, où il y a des chapiteaux également proches qui sont actuellement datés de 1090-1100. Pour conclure, Gilles Séraphin clarifie sa position : il n’affirme pas que les chapiteaux de Conques sont de 1100 mais souhaite mettre en évidence un problème de cohérence. Pour le massif occidental, il faut absolument discuter avec Éliane Vergnolle, conseille Henri Pradalier. Selon elle, la tour-porche disparaît au profit d’une façade monumentale avec deux clochers. Gilles Séraphin indique qu’il dispose de relevés précis de cette zone, sur laquelle il se concentrera dans la perspective d’une publication. Henri Pradalier conclut : c’est un édifice extrêmement compliqué ; les discussions pourraient se poursuivre longuement ! Emmanuel Garland signale un élément fondamental et unique à Conques : le dessin à l’intérieur est différent du schéma à l’extérieur. Cela signifie que, dès l’origine, la conception a été pensée pour que l’édifice soit perçu différemment, de l’intérieur et de l’extérieur.

Séance du 31 janvier 2023
Communication courte de Gilles Séraphin, Herment en Auvergne et Saint-Amand de Coly en Périgord, un cousinage architectural
Lire le compte-rendu
Des pérégrinations en Auvergne ont permis de découvrir à Herment, une église médiévale dont le parti architectural et la modénature reproduisent exactement mais hors contexte, les formes caractéristiques d’un groupe d’églises des confins du Périgord et du Quercy.
Présents : Mme Czerniak, Présidente, MM. Cabau, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier, Péligry, Bibliothécaire-Archiviste, Mmes Napoléone, Secrétaire générale, Machabert, Secrétaire adjointe ; Mmes Bessis, Fournié, Jaoul, Pradalier-Schlumberger, MM. Cazes, Macé, Penent, Peyrusse, Pradalier, Surmonne, Suzzoni, Testard, membres titulaires ; Mmes Dumoulin, Jiménez, Ledru, Rolland Fabre, MM. Kérambloch, Séraphin, membres correspondants.
Excusés : MM. Garland, Scellès, Sournia, Tollon.
La Présidente ouvre la séance et rappelle qu’une partie de celle-ci sera consacrée à l’Assemblée générale. Elle donne la parole à Louis Peyrusse pour deux informations brèves. Celui-ci nous annonce tout d’abord que Maurice Prin a été inhumé dans la chapelle du Crucifix, dans l’église des Jacobins, jeudi 19 janvier à 11h00, conformément à la demande que celui-ci avait faite à la Mairie de Toulouse. Bien qu’ayant été informé tardivement, notre confrère a pu cependant se rendre à la cérémonie avec Henri Pradalier et représenter la Société. Il semble que la pierre tombale sous laquelle il repose, représentant une croix dominicaine entourée d’inscriptions, ait été dessinée par Maurice Prin lui-même. M. Henri Pradalier signale que Mme Sire a fait remarquer qu’en obtenant que sa tombe soit installée dans l’église des Jacobins, Maurice Prin a fait son dernier cadeau au monument. En effet en creusant sa tombe là l’emplacement qu’il avait expressément désigné on a découvert une partie du mur goutterot du XIVe siècle.
Il nous apprend ensuite que l’Hôtel de Lestang, situé face au segment de l’enceinte romaine de la rue Bida, dont il a été question dernièrement, est aujourd’hui mis en vente par la Mairie. Cet hôtel du XVIIe siècle est protégé par les Monuments Historiques.
Il nous annonce enfin que la caserne Vion va aussi être mise en vente. Située sur les allées Charles-de-Fitte, elle n’est plus occupée par le Service d’Incendie et de Secours. L’édifice a été construit à partir de 1967 par Pierre Debeaux comme un exemple presque parfait de ce que devait être une caserne de pompiers, c’est-à-dire : un hall d’où partaient les camions, un petit Service d’administration, un bâtiment d’habitation et un centre d’entraînement pour les pompiers, ainsi qu’un centre sportif ; une sorte d’unité d’habitation corbuséenne. C’est aussi un des chefs-d’œuvre de l’architecture de béton : béton brut, béton en voile, utilisé pour les murs, les voûtes et les escaliers. L’édifice a reçu le label « architecture remarquable du XXe siècle » et il aurait fallu qu’il reste public ; mais sa mise en vente laisse augurer le pire. Le journal Libération a publié la semaine dernière une tribune demandant la protection de l’édifice, signée par de grands architectes. Louis Peyrusse voudrait que la Société s’associe à cette demande. La Présidente ajoute qu’une pétition circule en ce moment et qu’il serait bon que la Société la signe ; elle propose de l’envoyer à tous les membres. Martine Jaoul dit avoir lu un article dans la revue Sites et Monuments qui annonçait la destruction prochaine de la caserne (n° 229, 2022). Henri Pradalier pense qu’il faut proposer rapidement l’édifice à l’inscription. Daniel Cazes, quant à lui, rapporte qu’il est écrit dans le journal Actu Toulouse que la Mairie ne sait que faire de ce monument, car il n’est pas réutilisable : la piscine par exemple n’est pas aux normes… Pour avoir bien connu Pierre Debeaux, notre confrère affirme que cet édifice était celui dont l’architecte était le plus fier.
Puis la Compagnie se constitue en Assemblée générale et l’on procède à la lecture des rapports.
La Présidente donne le texte de son rapport moral pour le procès-verbal de la séance.
Au terme d’une première année de présidence, il me revient d’établir le rapport moral de cette année écoulée et de mettre en lumière les diverses activités de la Société Archéologique du Midi de la France.
La publication annuelle des Mémoires de la SAMF demeure notre plus belle vitrine et les anciens numéros sont accessibles en ligne, marquant de fait notre attachement au bien commun que représente la recherche scientifique. En raison de la crise sanitaire et de difficultés internes aujourd’hui réglées, nous avions pris du retard dans la publication de nos Mémoires 2019 et 2020-2021, mais ce retard est en train d’être compensé grâce à la formidable mobilisation de nos forces vives, tout particulièrement celles d’Anne-Laure Napoléone. Nous avons à cœur de veiller à publier aussi rapidement que possible et avons de ce fait instauré des délais de remise des textes plus contraints.
Outre notre contribution à la connaissance scientifique et à sa diffusion, notre action s’applique aussi à l’acquisition d’œuvres. Des acquisitions « Pour Mémoire ». Ainsi, au printemps dernier notre Président honoraire Louis Peyrusse et notre Trésorier Guy Ashell de Toulza ont acquis pour notre Société deux dessins préparatoires de Bénézet datés de 1878 Bernard Bénézet a été membre de la SAMF jusqu’à sa mort en 1897. Ces dessins ont été réalisés pour la décoration de la chapelle Sainte-Germaine à la cathédrale de Toulouse et représentent sainte Germaine en train d’enseigner l’Évangile aux petits enfants (scène déjà peinte pour une église de Loubens-Lauragais) et l’Apothéose de sainte Germaine, avec une belle série d’anges. Nos collections, qui s’enrichissent donc régulièrement, sont volontiers prêtées, comme nos statues-menhir souvent convoitées et qui, après Zurich l’année passée, sont exposées au Musée Henri-Prades de Lattes depuis le mois d’octobre.
La SAMF est aussi une vigie : tel un marin placé en observation dans la mâture ou à la proue d’un navire, notre Société alerte lorsque le patrimoine est en danger. Cela justifie que la Société Archéologique du Midi de la France ait été déclarée d’utilité publique en 1850. Il nous revient de veiller à la conservation de cette honorable et belle institution. Conserver ne veut pas dire figer et la Société Archéologique du Midi de la France peut s’enorgueillir d’être un véritable trait d’union entre les générations de chercheurs, des plus jeunes aux plus vénérables – notre Bureau le prouve – mais aussi un reflet des évolutions de notre monde au sens large. Ainsi sommes-nous exemplaires avec un Bureau respectant une parfaite parité : une secrétaire adjointe, une secrétaire générale, une présidente, un bibliothécaire, un trésorier, et un directeur. Au vrai, en dépit de son âge canonique, la SAMF est de son temps.
Elle prouve son adéquation à l’actualité de la recherche scientifique, par le biais de la publication des Mémoires, mais aussi avec la participation de ses membres à de prestigieuses manifestations. Ainsi, l’exposition Toulouse 1300-1400, l’éclat d’un gothique méridional, qui s’est tenue au Musée national du Moyen Âge – Cluny à Paris du 18 octobre 2022 au 22 janvier 2023 s’est révélée être un vrai satisfecit pour la SAMF. En effet, cette exposition, la première depuis la réorganisation complète du Musée de Cluny réouvert en mai 2022, a permis la mise en lumière du dynamisme des membres de la SAMF. Fruit du partenariat entre le grand musée parisien et le Musée des Augustins de Toulouse, l’exposition s’appuie sur les travaux mis en lumière à la faveur du colloque organisé en 2017 grâce au partenariat entre le Musée des Augustins, l’UT2J, le laboratoire TRACES et la SAMF, dont les actes ont été publiés aux PUM en 2021 (V. Czerniak et C. Riou (dir.), Toulouse au XIVe siècle. Histoire, Arts et Archéologie). Les commissaires de l’exposition, Béatrice de Chancel-Bardelot pour Cluny et Charlotte Riou pour les Augustins, ont associé trois membres de la SAMF, (Jean Catalo, Virginie Czerniak et Émilie Nadal) en co-commissariat et sollicité un certain nombre de consœurs et confrères pour la rédaction du catalogue (Michelle Fournié, Sophie Brouquet, Laurent Macé, Jacques Dubois, Anne-Laure Napoléone, Hiromi Haruna-Czaplicki, Véronique Lamazou-Duplan)
Quant aux centres d’intérêt de la SAMF, ils sont assurément multiples et ils traversent les âges, comme l’attestent les différents sujets des travaux universitaires primés chaque année, de même que les communications proposées à la faveur de nos séances bimensuelles. Ainsi cette année avons-nous bénéficié, à titre d’exemples, de communications consacrées aussi bien à des manuscrits du Moyen Âge qu’à des épitaphes antiques, des céramiques du XVIIIe siècle ou bien encore de l’évocation de la vie artistique à Toulouse dans les années 1950. Une pluralité thématique toujours au programme de l’année académique en cours.
Le Bibliothécaire-Archiviste donne lecture de son rapport, après avoir rappelé que l’année prochaine il faudra lui trouver un successeur.
Des chercheurs, qu’ils soient membres ou non de la Société archéologique, ont fait observer qu’un certain nombre de pages avaient été oubliées lors de la numérisation de notre Bulletin par la Bibliothèque nationale de France. J’ai donc identifié les quatre fascicules correspondants (environ 300 pages) et les ai remis le 11 janvier dernier au chef de la mission de la coopération régionale, à la BNF, pour qu’ils soient numérisés et intégrés dans Gallica. Dans le courant de l’année 2023, il ne devrait donc plus y avoir de lacunes dans la couverture numérique de notre Bulletin.
Lorsque nous avons entrepris, en 2019, la refonte complète du catalogue pour le rendre consultable en ligne, nous nous étions fixés un objectif, devenu notre priorité : faire en sorte que tous les documents déjà répertoriés dans l’ancien catalogue se retrouvent dès que possible dans le nouveau. C’est chose faite aujourd’hui. Nous y avons rajouté quelques centaines de dessins, aquarelles, estampes, cartes et tirages photographiques encore non classés dans le meuble à plans. Vous pouvez donc accéder à ces ressources de façon très simple en interrogeant la grille de recherche par nom d’auteur, par titre ou mots du titre, par date, ou même en sélectionnant au préalable le type de documents que vous souhaitez consulter. Le logiciel que nous avons retenu nous imposait de réécrire une à une toutes les unités bibliographiques en adoptant un format utilisé par de grandes bibliothèques, en particulier la Bibliothèque nationale de France. Cela signifie que si l’on devait un jour changer de système informatique, les notices que nous venons de rédiger seraient récupérables. Le catalogue en ligne comporte aujourd’hui 11.520 notices ; à titre de comparaison, il y avait deux fois moins de fiches papier dans les années 1920, lorsqu’Alexandre Biscons-Ritay veillait sur la bibliothèque, sous la présidence du chanoine Auriol. Ce projet doit beaucoup à Jacques Surmonne sans qui il n’aurait pu voir le jour ni être conduit à son terme, et à Geneviève Bessis dont l’expérience professionnelle nous a été précieuse. Il s’agit bien d’une œuvre collective où chacun a su trouver sa place et jouer sa partition. Je vous induirais en erreur si je disais qu’il ne reste plus rien à faire, car on ne saurait oublier les plaques de verre photographiques (même si nombre d’entre elles ont été déjà numérisées et figurent sur le site de la Société) ; il faudrait aussi décrire les objets ainsi que plusieurs cartons d’archives qui bénéficient déjà d’un pré-classement mais que nous n’avons pas eu encore le temps d’intégrer dans ce corpus. Nous allons y remédier au cours des mois qui viennent. Malgré une incomplétude toute relative et de rares dysfonctionnements, le catalogue en ligne, tel qu’il se présente aujourd’hui, donne accès à une documentation riche, variée, où l’on trouve, à côté de nombreux ouvrages de référence, des livres conservés en peu d’exemplaires, des pièces uniques et même parfois de véritables pépites. Cet outil mis à votre disposition s’inscrit dans la lignée des inventaires et des fichiers manuscrits qui l’ont précédé ; il se substitue au dernier répertoire informatisé qui apparaît comme un jalon important dans l’histoire de la bibliothèque ; nous conservons pieusement les uns et les autres, car ils constituent autant de témoignages sur le travail effectué par nos prédécesseurs. En réalité il n’y a jamais rupture, mais continuité avec, de loin en loin, un saut qualitatif, lié aux exigences de la recherche, aux normes de catalogage ou aux progrès technologiques. En dernière analyse, ce catalogue est moins celui des bibliothécaires que celui de la Société archéologique ; ce n’est pas le nôtre, c’est le vôtre, désormais, il vous appartient ; c’est à vous de lui donner du sens et de le faire vivre en l’exploitant pour vos propres recherches.
Comme j’ai pris l’habitude de le faire, depuis deux ou trois ans, j’aimerais vous montrer quelques documents pour illustrer ce petit rapport d’activité.
Imprimés, manuscrits, tapuscrits, photographies :
Promenade avec les fantômes du passé
Mémoire de Bernard Villenaissague) — RES 10077
Ce mémoire d’un certain Bernard Villenaissague, né à Toulouse dans la paroisse de la Daurade en 1764, est le récit poignant d’un homme qui n’a connu que des malheurs tout au long de son existence et qui décide, un jour, de mettre par écrit les épreuves qu’il a endurées : maltraitance lorsqu’il était enfant et adolescent, difficulté à trouver sa place dans la société, maladies, échecs, mauvaises affaires, procès, vilenie de certaines personnes auxquelles il avait fait confiance. Il perdit très tôt son père qui exerçait la profession de luthier et fut placé par sa mère dans des orphelinats ou chez des parents qui ne lui ne lui ont guère prodigué d’affection ; on le suit de Toulouse à Vabre en Albigeois, à Castres, à Bordeaux, puis à Rochefort, à Villeneuve-la-Comtesse, non loin de Saint-Jean-d’Angély, où il passe, avec femme et enfants, quelque 26 ans de sa vie. Il fut tour à tour tailleur d’habits, gérant d’un bureau de tabac et acquit, semble-t-il, une réelle compétence dans l’art de l’horlogerie. C’est en 1819, à l’âge de 55 ans, qu’il publie à Niort cette brochure de 80 pages que j’ai découverte récemment sur les rayons de notre bibliothèque et dont je n’ai trouvé aucun autre spécimen dans les bibliothèques publiques ou universitaires ; elle ne figure pas dans le Catalogue collectif de France qui recense plus de 40 millions de documents. Ce témoignage imprimé, aux accents un peu picaresques et d’une grande rareté, me semblait digne de retenir quelques instants votre attention.
La halle de Montréjeau — MSS 324
Cette carte postale, éditée par les frères Labouche au début du XXe siècle, ne fait pas partie des collections de la Société archéologique ; mais elle restitue fidèlement l’aspect et l’atmosphère de la place centrale de Montréjeau à l’époque où existait encore la halle du XVIe siècle qui fut entièrement détruite par un incendie, le 24 décembre 1944. En revanche nous possédons une lettre dactylographiée de Jean Cazes, architecte en chef des Monuments Historiques, adressée au Président de notre Compagnie, le 6 janvier 1945 ; elle a été publiée dans le Bulletin de la Société archéologique ; ce document, accompagné de deux photographies (avant et après le sinistre) fournit de précieuses informations à la fois sur l’intérêt architectural de l’édifice et sur les circonstances dans lesquelles se produisit ce dramatique évènement. Classée Monument Historique quelques années auparavant (en 1938), la halle de Montréjeau abritait au rez-de-chaussée les commerçants et les paysans qui venaient vendre leurs marchandises les jours de foire ou les jours de marché ; elle comportait au-dessus une superstructure en bois surmontée d’un lanternon, où l’on avait aménagé deux petits bureaux, vestiges de l’ancienne mairie, ainsi qu’un local affecté aux archives. Malgré l’intervention rapide des pompiers de Montréjeau, de Saint-Gaudens et de Lannemezan, la halle fut ravagée par le feu ; la municipalité n’ayant pas souhaité la reconstruire à l’identique, il ne nous reste plus que des témoignages photographiques de cette halle du XVIe siècle qui a disparu à tout jamais du patrimoine commingeois.
Convocation à la séance du 19 mars 1946 (adressée à Joseph Rozès de Brousse) — MSS 279
Lorsque n’existaient ni Internet ni les téléphones portables, les membres de la Société archéologique recevaient autrefois une convocation dans leur boîte aux lettres ; celle-ci fut adressée à Joseph Rozès de Brousse en vue de la séance du 19 mars 1946, fixée à 17 heures précises. C’est, en effet, 25 ans plus tôt (le 25 novembre 1921), que l’on prit la décision de fixer les séances le 1er et le 3e mardi du mois, à 5 heures du soir. Depuis un siècle nous restons fidèles à cette tradition. La guerre était terminée depuis quelques mois : si la Société avait poursuivi son activité, en se réunissant régulièrement et en continuant de publier Bulletins et Mémoires, en revanche la publication du Bulletin fut interrompue pendant plus de dix ans, à partir de 1946, pour des raisons financières. Cette convocation dactylographiée comportait l’ordre du jour, à savoir le rapport de Michel Labrousse relatif au concours, et une communication de Charles Higounet concernant la commanderie et l’église de Montsaunès. La présence de notes griffonnées au crayon a tout de suite éveillé ma curiosité : Joseph Rozès de Brousse était assis à côté de Léon Dutil à qui il écrivit, pour éviter de troubler la séance, même en parlant à voix basse : « M. Dutil, avez-vous reçu ma lettre David de Beaudrigue » ? Le confrère dut acquiescer par un signe de tête ; il faut savoir que Léon Dutil avait publié, deux ans auparavant, dans les Mémoires de l’Académie des Sciences, un article intitulé « Un capitoul perpétuel : David de Beaudrigue (1745-1765) », qu’il offrit à notre Société et qui se trouve toujours dans nos collections. Puis Rozès de Brousse revient à la charge, quelques instants plus tard : « Comment s’appelle et qui est votre voisin de gauche ? » Le papier glisse sur la table, apportant la réponse : Mais c’est « M. Higounet, professeur d’histoire à Montauban » ! En réalité, Charles Higounet n’a pas dû enseigner longtemps dans cette ville car en 1946 il soutint, à Toulouse, une thèse sur le comté de Comminges au Moyen Âge et fut chargé de cours, la même année, à l’Université de Bordeaux. Brillamment reçu à l’Agrégation d’histoire et de géographie à l’âge de 22 ans, il en avait alors 35. Son parcours était d’autant plus remarquable qu’il venait de passer trois ans de captivité en Silésie, dont il revint en 1943 ; Michel Labrousse, lui, resta prisonnier pendant cinq ans en Allemagne, de 1940 à 1945. Si l’on retourne à présent la convocation, on peut lire d’autres notes manuscrites : on y apprend que le prix de Clausade fut attribué à un certain Hauerbach pour son travail sur l’église de Fleurance ; le lauréat avait été conservateur-adjoint du Musée d’art industriel, à Oslo, en Norvège. Nous possédons encore aujourd’hui ce mémoire dactylographié. L’abbé Ajustron, curé de Saint-Plancard, Georges Fouet, instituteur, et l’abbé Jean Laffargue obtinrent une médaille d’argent pour les découvertes d’objets antiques et de peintures médiévales qu’ils firent à Saint-Plancard. Le résultat de leurs recherches fut publié par Edouard Privat en 1948. Enfin Rozès de Brousse évoque la conférence qui devait être prononcée par Robert Mesuret lors de la prochaine séance publique, fixée au 7 avril suivant ; elle avait pour titre : « l’art d’identifier les tableaux ». Mais les conférences n’étant pas publiées, nous n’en connaîtrons jamais la teneur… Voilà les commentaires que m’inspire ce morceau de papier (mesurant 13 cm par 21) conservé sous la cote : MSS 279.
Marcel Durliat, Saint-Sernin de Toulouse — MSS 322
L’ouvrage que Marcel Durliat publia sur la basilique Saint-Sernin, en 1986, devait inaugurer une collection dirigée par Bruno Tollon et Louis Peyrusse, chez l’éditeur toulousain Éché. Il s’agissait de faire de chaque volume à la fois un précis qui replaçait les édifices dans leur contexte historique, social et artistique et un guide qui en permettait la visite approfondie. Au moment où l’architecte en chef Yves Boiret entreprenait la restauration de Saint-Sernin, ce livre venait enrichir de façon opportune et presque providentielle, aussi bien la bibliographie déjà considérable de Marcel Durliat que l’historiographie d’un monument majeur de l’art roman, avant la parution, en 2008, de la grande monographie signée par Quitterie et Daniel Cazes. La bibliothèque de la Société archéologique du Midi conserve aujourd’hui ce tapuscrit grâce à Bruno Tollon qui fut alors un intermédiaire précieux entre l’auteur et l’éditeur et porta en quelque sorte le « Saint-Sernin de Toulouse » sur les fonts baptismaux. Le document se compose de 183 feuillets que viennent compléter les 87 photographies originales en noir et blanc ayant servi à l’illustration du livre et qui font désormais partie d’un même dossier, répertorié sous la cote : MSS 322. En voyant les nombreuses ratures de l’ouvrage dactylographié, ses corrections, ses repentirs, ses ajouts, on perçoit avec émotion, page après page, la mystérieuse alchimie de l’écriture, la quête incessante du mot juste et de la formulation la plus adéquate. Enfin, trois lettres de Marcel Durliat adressées à Bruno Tollon éclairent la genèse d’un livre qui fait toujours autorité : l’une d’entre elles mentionne une référence qui manquait à l’auteur et que celui-ci attendait avec impatience (la note 69 renvoie en effet à un article que Daniel Cazes venait tout juste de publier dans le Bulletin monumental) ; dans une autre lettre, datée du 11 septembre 1985, il souhaitait modifier sa conclusion : « Vous trouverez ci-joint, écrit-il, le texte qui doit supprimer ce qu’avait d’abrupt la manière dont je prenais congé du lecteur. Peut-être le trouverez-vous trop romantique. C’est l’état de mon âme aujourd’hui ». Après avoir évoqué Stendhal qui visita la basilique en mars 1838, il terminait par ces mots : « Bien d’autres depuis ont suivi ses traces. Comme aux temps lointains des pèlerins de Compostelle, Saint-Sernin demeure un des édifices élus pour être le siège des émotions de l’âme. » La dernière phrase du tapuscrit a été soigneusement raturée, mais j’ai quand même réussi à la déchiffrer ; voici donc la dernière phrase qu’il avait écrite puis biffée en parlant de ce monument qu’il chérissait par-dessus tout : « Nul doute qu’il n’ait droit de figurer parmi les lieux où souffle l’esprit ».
Portrait de Gaspard de Daillon du Lude, êvêque d’Albi (de 1636 à 1676) — 3 Fi 2 (19)
Gaspard de Daillon du Lude, dont on voit ici le portrait, a été au XVIIe siècle (de 1636 à 1676), le dernier évêque d’Albi, juste avant que la cité épiscopale ne devienne le siège d’un archevêché. D’abord évêque d’Agen, il fut nommé à Albi où il succéda à Alphonse d’Elbène, l’un des instigateurs de la révolte du Languedoc, qui dut s’enfuir en Italie après l’exécution du duc de Montmorency. Épris de luxe et de faste, Gaspard de Daillon agrandit le palais de la Berbie, notamment l’aile d’Amboise, et aménagea de magnifiques pièces de réception, comme le « Salon doré » où se trouve encore aujourd’hui, au-dessus d’une porte, ce tableau exécuté, vers le milieu du XVIIe siècle, par le peintre Roland Couplet ou Coupelet. Un médaillon ovale, que supportent six angelots, entoure le portrait de l’évêque décoré de l’Ordre du Saint-Esprit (cela permet d’ailleurs de dater plus précisément l’œuvre, peinte de toute évidence après 1661) ; à l’arrière-plan se profile la ville d’Albi avec ses murailles d’où émergent la cathédrale Sainte-Cécile, la tour de la collégiale Saint-Salvy et quelques autres monuments. À gauche, l’église des Cordeliers, partiellement dissimulée derrière le feuillage d’un arbre. On remarque surtout, au centre de la composition, entourée de vastes jardins et bien mise en valeur, une construction récente qui était devenue la nouvelle résidence d’été de l’évêque ; on l’appelait le Petit Lude, par opposition au château du Grand Lude, berceau de la famille, qui existe toujours dans la Sarthe. Le Petit Lude abrite aujourd’hui la Fondation du Saint-Sauveur qui gère un hôpital de jour. L’image que vous avez sous les yeux est due au photographe toulousain Louis Aillaud. Celui-ci publia, chez Édouard Privat, en 1882, un album consacré à la cathédrale Sainte-Cécile, orné de 93 planches photographiques ; on peut donc supposer que la reproduction du tableau conservé au palais de la Berbie date également des dernières années du XIXe siècle.
Visite de Cordes, juin 1905 — 3 Fi 2 (10)
La bastide de Cordes-sur-Ciel, qui s’appelait tout simplement Cordes jusqu’à la fin du XXe siècle, ne pouvait échapper à la curiosité de Viollet-le-Duc et de Prosper Mérimée ; elle fit l’objet d’une savante étude publiée par Charles Portal, archiviste du Tarn, en 1902. Mais c’est au moment de la Deuxième Guerre mondiale, sous l’influence de quelques écrivains, notamment de Jeanne Ramel-Cals, et d’artistes, comme Yves Brayer, qu’elle suscita un réel engouement et attira de plus en plus de visiteurs. La Société Archéologique du Midi de la France n’attendit pas les hordes de touristes pour s’intéresser à ce joyau du pays albigeois. En juin 1905, les membres de notre Compagnie jetèrent leur dévolu sur la petite cité médiévale pour y effectuer leur excursion annuelle. « La porte de la Jane, écrit Lahondès dans le compte rendu qu’il fit de cette promenade, a surtout attiré l’attention, puisque la Société archéologique l’a sauvée par son initiative de la destruction qui la menaçait. Grâce à sa subvention, à celle de la Société française d’archéologie, à celle du Touring-Club devenu une puissante institution protectrice des sites et des monuments, grâce surtout au don du Ministère des Beaux-Arts, la tour de la Jane a été achetée, et de même les murs de la tour de l’Est dont le propriétaire s’est réservé la jouissance intérieure, sans qu’il ait le droit de rien modifier. La Société a transmis ses droits de propriété à la Société des Amis du Vieux Cordes qui s’est formée aussitôt et qui est mieux en état de diriger et de surveiller les travaux de consolidation » (fin de citation). La photographie du groupe où l’on voit les membres de la Société archéologique, leurs épouses et même des enfants, a été prise par Jean-Henri Depeyre non pas devant la porte de la Jane mais devant la porte de Rous, qui date du XIIIe siècle. On y reconnaît, entre autres, Rodolphe de Champreux et Jules Lahondès. « La journée, conclut celui-ci, s’est accomplie à la satisfaction de tous, par un temps radieux. »
Un tympan et un linteau de La Barousse, de la fin du Moyen Âge — 3 Fi 2 (24) et 3 Fi 2 (25)
Ces deux photographies, bien qu’elles ne comportent aucune indication de date, de lieu ni de personne, ont été prises sans nul doute en 1913 par Adolphe Couzi, alors Secrétaire-adjoint de la Société archéologique. L’une donne à voir le tympan de l’église située à Sainte-Marie-de-Barousse, à la limite de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées. Couzi, qui se passionnait pour la photographie, publia à ce sujet une note dans le Bulletin du 24 juin 1913 : « De la voie ferrée unissant Montréjeau à Luchon, écrit-il, on aperçoit dans la direction de Siradan un mamelon couronné de quelques maisons, d’une église et d’un clocher à arcades ; c’est le hameau de Sainte-Marie, commune de Bagiry ». Il nous a laissé une description de cette église construite dans les dernières années du XVe siècle, à la suite d’une apparition de la Vierge à une jeune gardienne de moutons. Son tympan sculpté (1,08 m x 0,45 m) représente, à droite, le Christ crucifié entre la Vierge et saint Jean, et à gauche saint Pierre tenant une énorme clef. On distingue sur l’écu martelé la présence de trois fleurs de lys ainsi que la date de 1498. Lors de la visite d’Adolphe Couzy, en 1913, ce bas-relief venait d’être nettoyé mais au détriment, semble-t-il, de la polychromie existante.
L’autre photographie est d’autant plus exceptionnelle que l’œuvre photographiée ne se trouve plus sur le lieu même où elle a été créée, mais, par-delà les océans, à des milliers de kilomètres de la Barousse. Il s’agit du linteau d’une maison médiévale ornée d’une scène de chasse à l’ours, avec deux archers situés de part et d’autre de la composition et deux cerfs encadrant un écu martelé. Le thème n’est guère surprenant dans cette zone du piémont pyrénéen ; sa datation paraît proche de celle du tympan dont je viens de parler ; je serais même tenté de suggérer que les deux bas-reliefs ont été réalisés par le même artiste, si l’on en juge par la façon dont il a représenté les feuillages. Ne parvenant pas à localiser ce linteau, j’ai eu recours, sur les conseils d’Anne-Laure Napoléone, au réseau des membres de la Société archéologique et j’ai pu bénéficier du propre réseau d’Émilie Nadal qui a très vite apporté une réponse à mes vaines investigations. Le linteau que vous avez sous les yeux surmonte désormais une porte du Musée des Beaux-Arts, à Philadelphie, à l’entrée de la salle des armes anciennes. D’après les informations communiquées par Émilie, la maison d’où provient le linteau sculpté se trouvait dans le petit village d’Ore, à deux ou trois kilomètres de Bagiry, en bordure de la route nationale 125 qui longe la Garonne ; la maison n’existe plus, mais, par chance, on en connaît l’aspect extérieur, grâce à un dessin exécuté sans doute au début du XXe siècle. Il met en évidence deux portes, dont celle de droite qui nous intéresse ici, trois fenêtres à meneaux à l’étage et des motifs sculptés qui agrémentent la façade. Cette maison a été démolie et les pierres de taille sûrement récupérées, ainsi que tout ce qui contribuait à son décor. Que s’est-il passé ? Grâce aux travaux de Géraldine Mallet, de Jacques Lapart ou de Céline Brugeat, nous savons que les monuments du Moyen Âge, souvent à l’abandon et en perdition dans le Midi de la France, au début du XXe siècle, attisèrent la convoitise d’un collectionneur américain, Georg Grey Barnard (1863-1938), qui fut particulièrement actif entre 1910 et 1930. Il choisissait lui-même les pièces qui l’intéressaient, mais disposait aussi sur place d’un réseau de marchands plus ou moins scrupuleux, comme le toulousain Fernand Pifteau, et fit expédier aux États-Unis nombre de cloîtres, de chapiteaux et autres vieilles pierres chargées d’histoire. C’est ainsi que les ensembles de Saint-Michel-de-Cuxa, Saint-Guilhem-le-Désert, Bonnefont-en-Comminges, Trie-sur-Baïse, arrachés au terroir qui les avait vus naître, constituent aujourd’hui le Musée des Cloisters, à New-York. Mais bien d’autres échantillons de notre patrimoine méridional (colonnes, portails, fenêtres, chapiteaux romans et gothiques) suivirent le même chemin et furent proposés à des institutions ou des collectionneurs américains. Bien que nous ne connaissions pas dans le détail les conditions d’un tel transfert, il n’est pas surprenant que ce linteau, après le démantèlement probable de la maison seigneuriale d’Ore, dans la Barousse, ait franchi l’Atlantique pour commencer une nouvelle vie au Musée des Beaux-Arts de Philadelphie. En tout cas, sans la photographie d’Adolphe Couzi, nous n’aurions pas soupçonné l’existence de cette curieuse scène de chasse à l’ours du XVe siècle et encore moins sa surprenante destinée.
Ainsi s’achève cette promenade un peu nostalgique avec les fantômes du passé ; nous la poursuivrons, si vous le voulez bien, l’année prochaine, avec d’autres documents.
Notre Trésorier présente enfin le bilan financier de l’année passée :
Quitus est donné au Trésorier pour la bonne gestion des comptes de la Société.
Les rapports précédents sont approuvés à l’unanimité.
Puis le renouvellement des postes de Directeur, de Secrétaire adjointe et de Trésorier est soumis aux votes des membres titulaires. Ils sont tous les trois réélus.
Avant la communication annoncée par l’ordre du jour, la Présidente montre un plan ancien du Musée des Augustins pour replacer précisément les vestiges de la chapelle Renaissance de l’Ecce Homo découverte à la faveur des fouilles effectuées par le Service archéologique de Toulouse-Métropole (en décembre 2021) et dont il a été question lors de la séance du 3 janvier dernier. La DRAC ayant refusé la destruction de ces vestiges, il a été projeté de les déplacer car ils gênent l’aménagement du futur Service d’accueil du Musée prévu l’architecte Aires Mateus. Personne ne semble savoir si ce déménagement aura lieu ou si le projet sera modifié.
Daniel Cazes rappelle qu’après la construction du bâtiment de Viollet-le-Duc et de Darcy, inauguré en 1896, devait suivre la reconstruction de l’aile sud, à l’étage de laquelle on aurait accédé par l’escalier monumental que l’on venait de construire ; mais le projet a été abandonné. Dans les années 1950-1960, l’architecte-en-chef Sylvain Stym-Popper voulait reprendre ce projet. En partie entamé, la Mairie en abandonne la majeure partie en 1976-1980, pour préserver des arbres et la vue des habitants d’un immeuble de la rue de Metz… Stym-Popper avait conscience des vestiges de la chapelle de l’Ecce Homo et de la cage d’escalier qui menait au premier étage où se trouvait la célèbre bibliothèque du couvent. Daniel Cazes regrette profondément qu’actuellement on oublie tout ce qui avait été l’objet des projets antérieurs, qui auraient donné plus de surface d’exposition au musée et permis de meilleures circulations intérieures, pour un musée qui, de toute façon, est aujourd’hui trop petit pour présenter ses riches collections médiévales et des beaux-arts. Virginie Czerniak déclare qu’il est étonnant que la Mairie ou l’architecte n’ait pas eu idée d’intégrer dans le dernier projet des vestiges qui étaient connus par les documents.
Louis Peyrusse fait remarquer que les choses se sont sans doute passées de façon plus complexe. Quand la Mairie a demandé l’accord de l’État pour refaire l’entrée du Musée, il y a eu un accord signé par le Préfet à condition que des fouilles archéologiques soient faites. Une fois celles-ci effectuées, le Conservateur régional des M.H a refusé que le projet aille plus loin sans que soient traités les vestiges. On devine un contentieux entre les parties.
Notre Directeur voudrait également revenir sur les vestiges de la muraille romaine dégagés rue Bida et projette un plan mis en ligne sur le site Urban-hist.toulouse.fr juxtaposé avec le plan cadastral des années 1970, où figurent encore les bâtiments détruits en 1971. Le terrain vaccant couvre environ 2000 m2 ; or seuls 1152 m2 sont mis en vente selon le document présenté par Daniel Cazes le 3 janvier. Des informations provenant d’un Service municipal indiqueraient par ailleurs qu’il y aurait eu un détachement de parcelle : le terrain aurait été ainsi découpé. Enfin, le panneau d’information appliqué sur la clôture précise que les vestiges seront préservés, mis en valeur et éventuellement offerts à la visite. Nous n’aurions donc aucune inquiétude à avoir quant au devenir du site antique, les constructions à prévoir devant être effectuées en retrait. Un second plan dessiné par notre consœur Quitterie Cazes est projeté. Il montre les vestiges de l’enceinte romaine reconnus dans ce secteur. D’après un document du XIVe siècle que Patrice Cabau vient de transcrire, le duc Louis d’Anjou, frère du roi Charles V et son lieutenant « en toute la languedoc », étant à Toulouse dans le premier trimestre 1374, s’émeut de l’état de l’enceinte entre les Hauts-Murats et la porte Saint-Étienne ; les chanoines de la cathédrale avaient profité de l’arasement des fortifications et, ignorant « la clausure antique », avaient construit au-dessus ainsi que sur les fossés comblés, ce qui devenait problématique pour la mise en défense de la ville pendant la Guerre de Cent Ans. Le duc d’Anjou donne donc ordre de détruire tous les bâtiments élevés par les chanoines dans cette zone et d’en revenir aux fondements antiques sur lesquels les capitouls sont chargés d’élever de nouvelles fortifications.
Michelle Fournié se réjouit des informations très intéressantes fournies par ce texte car il s’agit d’actions peu connues du duc d’Anjou. Par ailleurs, le duc d’Anjou, gouverneur en Languedoc, mène la reconquête sur les territoires perdus face aux Anglais entre 1370 et 1374. Il est donc parfaitement logique qu’il s’intéresse à l’état de l’enceinte et à sa réfection. De plus, jusque dans les années 1380, Toulouse est la base militaire de la reconquête. Louis d’Anjou séjourne fréquemment à Toulouse, où deux de ses enfants sont nés. C’est aussi un grand mécène, donc un personnage très important pour notre ville.
La Présidente demande à Patrice Cabau de nous proposer une communication à partir de ce texte qui semble en effet particulièrement intéressant.
Puis elle donne la parole à Gilles Séraphin pour sa communication courte : Herment en Auvergne et Saint-Amand de Coly en Périgord, un cousinage architectural.
Virginie Czerniak remercie notre confrère et demande s’il existe des liens entre les édifices présentés, autres que la plastique et la grammaire ornementale. Il n’y en a aucun actuellement connu répond Gilles Séraphin. La question de la circulation et de la formation des artistes se pose ; notre confrère déclare qu’il commence à penser que ceux-ci ont une connaissance très fine de ce qu’ont fait leurs prédécesseurs et pas nécessairement dans la même région que celle où ils officient. Il prend pour exemple le portail de l’église de Mauriac et montre le décalage entre les moulures de la voussure, qui accusent la fin du XIIe ou le début du XIIIe siècle, et le tympan sculpté proche de celui de la cathédrale de Cahors ; il en conclut que malgré les similitudes des tympans, l’église de Mauriac est postérieure au portail nord de la cathédrale de Cahors. Mais de combien de temps ? Il pense en revanche que la chronologie est plus resserrée entre la construction des églises de Saint-Amand-de-Coly et d’Herment (élevée sans doute vers 1232, ce qui correspondrait à la création du collège de chanoines). Pour lui, les édifices de Saint-Amand-de-Coly, Paunat, Comarque et la lanterne des morts de Sarlat seraient achevés entre 1220 et 1250. La Présidente trouve cette datation tardive. Henri Pradalier pense qu’on pourrait la remonter jusqu’à 1200 car les formes dont il a été question existaient déjà. Revenant sur la question de la circulation des artistes, il pense que ce sont plutôt les carnets de dessins qui circulent plus que les hommes : les œuvres sont donc connues à travers les dessins qui sont faits et recopiés. Gilles Séraphin déclare qu’il ne s’appuie pas sur la création du collège d’Herment pour proposer ses datations, mais sur l’article qu’il avait fait sur les croisées d’ogives où il avait conclu que les voûtes de Saint-Amans de Coly, de Paunat et de la lanterne des morts de Sarlat ne pouvaient dater que des années 1230. Ce qui est intéressant à Herment, c’est que l’on trouve dans la construction des éléments inspirés des parties les plus anciennes et les plus récentes de Saint-Amans-de-Coly. Le même phénomène peut être noté au portail de l’église de Mauriac et d’autres exemples peuvent être donnés. C’est cette pratique originale d’inspiration qui a particulièrement intéressé notre confrère, et les réflexions qui en découlent restent des hypothèses.
« Obazine est un centre cistercien, qu’en est-il des autres ? » demande Laurent Macé. Les autres sont bénédictins répond Gilles Séraphin.

Séance du 17 janvier 2023
Deux communications courtes de Dominique Watin-Grandchamp![]() Un Christ du XVIIe siècle intégré dans un groupe en terre cuite de Virebent à Saint-Nicolas
Un Christ du XVIIe siècle intégré dans un groupe en terre cuite de Virebent à Saint-Nicolas![]() Dans la hotte de Saint-Nicolas
Dans la hotte de Saint-Nicolas
Lire le compte-rendu
Un Christ du XVIIe siècle intégré dans un groupe en terre cuite de Virebent à Saint-Nicolas
Les élévations latérales de la chapelle sainte Croix de l’église toulousaine de Saint-Nicolas a été redécorée dans les dernières années du XIXe (après 1890) par des groupes de terre cuite de la manufacture Virebent. Ces modèles de la célèbre manufacture ne se retrouvent pas dans ses catalogues et sont, relativement, inédits. Une scène de Crucifixion réemploie un grand Christ en croix datable des premières années du XVIIe siècle (?). Aucun des documents d’archives consultés ne mentionne cet aménagement et ne renseigne sur l’origine du Christ. Seul l’inventaire de 1906 nous informe que le Christ qui faisait partie, primitivement, du groupe était en terre cuite. Il est actuellement conservé dans la sacristie. Le grand crucifix, actuellement en place, n’est pas documenté à part une mention marginale de Paul Mesplé dans un article de l’Auta, en 1963, qui est le premier à signaler sa présence. L’origine de cette œuvre de grande qualité est, actuellement, inconnue.



![]() Dans la hotte de saint Nicolas : un « modello » inédit du peintre toulousain Despax pour le tableau central du retable de chœur : « Mort et apothéose de saint Nicolas »
Dans la hotte de saint Nicolas : un « modello » inédit du peintre toulousain Despax pour le tableau central du retable de chœur : « Mort et apothéose de saint Nicolas »
Les trois tableaux de chœur de l’église saint Nicolas sont réalisés par Jean-Baptiste Despax ( 1710-1773) pour orner un grand retable auquel collabore le sculpteur marbrier Etienne Rossat. La grande qualité des toiles peintes a justifié leur protection au titre des objets mobiliers le 11 septembre 1906. Les inventaires de mobilier, actuellement en cours, dans Toulouse, ont permis de découvrir un « modello » du tableau central. Il illustre la « Mort et apothéose de saint Nicolas ».
Oublié au fond d’un placard de sacristie, ce modèle n’était pas connu et n’a fait l’objet d’aucune étude. Il n’est ni signé, ni daté mais les restaurateurs consultés ne doutent pas de l’attribution à Despax. Le musée Paul Dupuy conserve un dessin d’exécution de l’ensemble du retable mais…sans illustration du panneau central. Ce dessin est contresigné de Despax et porte la date de 1768 alors que les toiles de chœur, signées, sont datées de 1759.



Présents : MM. Cabau, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier, Mmes Napoléone, Secrétaire générale, Machabert, Secrétaire-adjointe, M. Péligry, Bibliothécaire-archiviste ; Mmes Cazes, Pradalier-Schlumberger, Watin-Grandchamp, MM. Cazes, Peyrusse, Pradalier, Scellès, Surmonne, Testard, Tollon, membres titulaires ; M. Kerambloch, membre correspondant.
Excusés : Mmes Czerniak, Balty, Fournié, Rolland, MM. Balty, Garland, Garrigou Grandchamp, Séraphin, Sournia.
En l’absence de la Présidente, le Directeur ouvre la séance avec la présentation de deux ouvrages offerts à la bibliothèque par Maurice Scellès : Marcel Durliat, L’art dans le royaume de Majorque, Toulouse, Privat, 1962 ; Les grandes étapes de la sculpture romane toulousaine : des monuments aux collections, Toulouse, Musée des Augustins, 1971.
Puis Louis Peyrusse nous informe que l’Académie des Jeux Floraux, qui s’apprête à fêter son septième centenaire, appartient désormais au Patrimoine culturel immatériel de la France.
Le Directeur donne ensuite la parole à Dominique Watin-Grandchamp pour sa première communication courte : Un Christ du XVIIe siècle intégré dans un groupe en terre cuite de Virebent à Saint-Nicolas.
Remerciée pour sa présentation, Dominique Watin-Grandchamp rappelle que ce travail est en cours, aussi toutes les réflexions pouvant permettre de compléter les pistes avancées sont-elles bienvenues. L’inventaire qu’elle a engagé est indispensable et permet de révéler des éléments importants. Au-delà de ce cas, Dominique Watin-Grandchamp souhaiterait que les crucifix, souvent oubliés et méconnus, présents dans les églises de notre région, puissent lui être signalés. Quitterie Cazes signale qu’un de ses étudiants en Master de l’Université Toulouse Jean-Jaurès pourrait, dans le cadre d’un stage, travailler sur ce sujet. Louis Peyrusse revient sur l’explication de la présence de ce Christ du XVIIe siècle au centre du groupe du XIXe. Puisqu’il y avait un calvaire en terre cuite, un curé, au début du XXe siècle, a pu décider de placer au centre une œuvre jugée plus importante. Quant à la provenance du Christ, sans doute n’était-il pas présent dans l’église Saint-Nicolas au moment de la commande à Virebent. S’il y avait déjà un crucifix, la fabrique Virebent aurait pu n’offrir que la Vierge et saint Jean. Dominique Watin-Grandchamp confirme que l’inventaire de 1906 fait état d’un groupe composé de trois statues de terre cuite : la fabrique Virebent a donc bien livré un ensemble complet, dont un Christ. Néanmoins, Dominique Watin-Grandchamp a pu constater dans les pratiques toulousaines que, souvent, lors de remaniements dans les édifices, il n’y a pas de disparition complète des œuvres. Elle s’est donc intéressée aux artistes ayant produit des retables et du mobilier pour Saint-Nicolas, car il y a des rapports de dilection entre les commanditaires religieux et certains artistes. Ainsi, on retrouve quasiment le même milieu artistique travaillant pour les mêmes commanditaires. Cette recherche est à poursuivre. Daniel Cazes remarque les traits fins du visage et la forme très aigüe du nez. Dans un contexte castillan, ces éléments, ajoutés au traitement de la chevelure, renverraient notamment à Berruguete ou ses condisciples et à une production de l’extrême fin du XVIe siècle. Dominique Watin-Grandchamp avait aussi pensé à une datation de l’extrême fin du XVIe siècle, à la césure et, au vu de la forme de la couronne d’épines, du traitement de la chevelure et de la barbe très frisée, la référence outre-pyrénéenne est envisageable. Dans ce cas, qui dans le milieu toulousain véhicule cette influence ? s’interroge-t-elle. Louis Peyrusse renvoie à la statuaire de Rieux, alors visible. Maurice Scellès demande si un traitement aussi accusé de l’anatomie est fréquent à cette époque. Dominique Watin-Grandchamp répond qu’il y a alors une volonté de réalisme dans la représentation du corps. Maurice Scellès se demande s’il faut parler de réalisme devant un traitement anatomique aussi accentué. Dominique Watin-Grandchamp pense que le sculpteur a effectué des études anatomiques et a travaillé sur du vivant, pas uniquement sur des modèles. Maurice Scellès se dit surpris en particulier par le traitement des jambes, qui lui semble peu réaliste. Ce n’est pas exactement réaliste, ajoute Quitterie Cazes : la manière dont le mollet est souligné n’est pas anatomique, par contre elle traduit une volonté de détail pour montrer qu’il s’agit d’un vrai corps humain. Bruno Tollon complète : l’œuvre est réalisée pour être vue de loin. Selon Louis Peyrusse, le traitement n’est pas éloigné de celui observé pour le Christ en croix de Thibaud Maistrier à Saint-Exupère. Le périzonium est similaire et le type de représentation est semblable. Dominique Watin-Grandchamp note que la chevelure avec des boucles ondées le rapproche, pour ce qui est du visage, du Christ (non attribué) de Saint-Martin-du-Touch. Néanmoins la stature est différente, le corps plus râblé, et la qualité d’exécution n’est pas comparable. Maurice Scellès demande s’il y a eu une visite épiscopale avant la Révolution. Dominique Watin-Grandchamp n’a pas trouvé de description précise des éléments de décor et de mobilier. Les visites sont essentiellement faites pour vérifier que tout est en règle pour la desserte de l’édifice.
Dominique Watin-Grandchamp présente ensuite sa seconde communication courte intitulée : Dans la hotte de saint Nicolas.
Louis Peyrusse félicite notre consœur pour cette passionnante présentation de ce modello parfaitement daté. Le panneau se décompose en deux parties, une qui pourrait être qualifiée de « baroque », dans l’esprit du maître de la peinture religieuse de l’époque, Jean Restout ; tandis que la partie inférieure, figurant la mort de saint Nicolas, reprend le thème du lit de mort, thème absolu du néo-classicisme. En outre, son coloris gris-bleuté se rapproche de certaines œuvres de Jean-Baptiste Greuze. Le traitement est entre deux mondes de la peinture, confirme Dominique Watin-Grandchamp. Il est dans les conventions de l’époque, et même s’il ne s’agit pas d’une œuvre majeure, certains éléments singuliers peuvent apparaître comme précurseurs. En cela, ce modello est un jalon intéressant. Interrogée sur son devenir, Dominique Watin-Grandchamp souhaite sa mise en sécurité. Après un nettoyage, son accrochage dans la sacristie pourrait être envisagé. Étant une propriété de la Ville de Toulouse, peut-être sera-t-il décidé, à terme, de son dépôt au Musée des Augustins. Louis Peyrusse évoque la possibilité que le modèle soit resté dans l’atelier de Jean-Baptiste Despax et que, après sa mort, la famille en ait fait don à la paroisse. Dominique Watin-Grandchamp dit avoir trouvé des mentions fugaces de confréries très conservatrices à Saint-Nicolas : il devait y avoir des archives importantes, il est donc aussi possible que le panneau ait été conservé sur place. Despax a pu également en faire don lui-même, poursuit Louis Peyrusse. Maurice Scellès demande si les trois toiles du retable sont datées ? Bruno Tollon indique que, lors de son étude effectuée en 2012 et 2014, il avait constaté que seule la toile centrale était signée. Maurice Scellès fait remarquer que l’on aurait là une possible explication du décalage entre la date de 1759, figurant sur la toile centrale, et celle de 1768, apposée sur le dessin d’exécution de l’ensemble du retable conservé au Musée Paul-Dupuy. Louis Peyrusse approuve l’hypothèse avancée durant la présentation : la date de 1768 correspond à la fin du chantier. Dominique Watin-Grandchamp appuie : il était fréquent que les commandes soient suspendues ou en partie abandonnées et les chantiers s’étendaient ainsi parfois sur presque 10 ans. Ce délai n’est pas dû au rythme de travail des marbriers, sculpteurs ou peintres, c’est une question d’organisation du travail et de financement.
Au titre des questions diverses et faisant suite à la nouvelle communiquée par Daniel Cazes lors de la précédente séance (3 janvier 2023), le Directeur revient sur la mise en vente, annoncée dans la presse fin novembre 2022, du terrain vacant situé place Saint-Jacques, à l’extrémité des rues Sainte-Anne et Bida. C’est en 1970 que décision fut prise de détruire les immeubles qui s’élevaient sur cet emplacement. La démolition s’effectua au mois de septembre 1971 et, en dépit des préconisations qui recommandaient de s’arrêter à une certaine hauteur, les bâtiments de la zone furent arasés au niveau de la chaussée de la rue Bida. La Commission des Sites de la Haute-Garonne s’en émut le 4 novembre, ainsi que L’Auta en décembre (n° 386). À l’époque, le Rectorat voisin cherchait à agrandir ses locaux ; le Ministère de l’Éducation nationale décida d’acheter le terrain, qui devint ainsi propriété de l’État. En 1973, sous l’impulsion de Michel Labrousse, Directeur de la Circonscription archéologique, des sondages eurent lieu (mars), suivis d’une fouille menée par Michel Vidal assisté de Patrick Marchand (7-14 septembre). Les vestiges dégagés restèrent ensuite offerts à la vue du public. À partir des articles publiés en 1974 dans les revues Gallia (32, p. 470-471) et Pallas (21, p. 99-109), Patrice Cabau présente les principaux éléments qui avaient alors été mis au jour. Revenu sur les lieux en décembre 2022 pour un reportage photographique, le Directeur montre à l’assemblée l’état actuel des vestiges de la tour et de la courtine de l’enceinte gallo-romaine. Il met en évidence les éléments nouvellement découverts, dont de grosses masses de blocage qui paraissent avoir été éversées, basculées. Ces éléments ne sont pas mentionnés en 1974 puisque la zone la plus au Nord n’avait pas été fouillée. De nombreuses questions apparaissent maintenant. Un travail doit s’engager afin de comprendre comment s’est effectuée la démolition, manifestement à l’époque de la croisade contre les Albigeois – on ne conserve des destructions effectuées entre 1214 et 1229 que des mentions générales et au fond assez vagues – ; puis la reconstruction, à l’initiative des capitouls soutenus par le pouvoir royal, à partir de 1345. Les différentes étapes restent à éclaircir, le démantèlement de la muraille a dû se faire de manière à « édenter », sans tout raser, mais d’autres problèmes demeurent, posés par les découvertes récentes. Daniel Cazes signale la présence d’un panneau explicatif à destination du public, positionné contre la tour. Il nous donne des indications sur le devenir de la zone. Il nous apprend que l’ensemble du terrain vendu par l’État va faire l’objet d’une fouille au cours de l’année 2023. Cette fouille sera visitable. Ces vestiges devraient être protégés, mis en valeur et rendus accessibles au public. Daniel Cazes est cependant dubitatif, la zone concernée représentant le tiers du terrain, comment un promoteur pourra-t-il construire en conservant les vestiges et en les laissant accessibles au public ? Par ailleurs, Daniel Cazes a pris contact avec M. Jean-François Latger, membre du Conseil d’administration des Toulousains de Toulouse et architecte urbaniste de l’État. Il ressort que l’enceinte aurait fait l’objet d’une inscription à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Dominique Watin-Grandchamp confirme que ce travail est réalisé par Marie-Emmanuelle Desmoulins, avec pour objectif de protéger la totalité de l’enceinte gallo-romaine. Elle poursuit : sur le chantier de la place Saint-Jacques, l’intérêt majeur est la découverte du mode de démolition de l’enceinte. L’autre point intéressant est celui de la réoccupation de ce secteur dans le cadre du quartier canonial de Saint-Étienne. L’occupation du XIXe siècle est paradoxalement moins bien renseignée. Dominique Watin-Grandchamp va effectuer un récolement iconographique, notamment à partir de nombreux clichés pris par Jean Dieuzaide lors de ses campagnes pour La Dépêche du Midi. D’autre part, un travail de couverture photographique peut être effectué sur la partie en direction de la cathédrale, où les remparts jusqu’aux courtines sont encore en place. Les plans de maisons construites au moment de la création de la rue Bida constituent également un matériel précieux à exploiter pour le rapport de fouille. Quitterie Cazes ajoute que des mâchicoulis sont aussi conservés dans quelques maisons. Les vestiges antiques sont conservés sur une importante hauteur à ce niveau puisque les ouvertures du chemin de ronde antique sont même visibles. Quitterie Cazes revient sur la démolition qui aurait été effectuée durant la croisade contre les Albigeois ; la zone se situe dans le quartier canonial, il lui semble donc impossible qu’une destruction ait été opérée sur une partie de l’enceinte qui protégeait la plus importante communauté ecclésiastique du diocèse. Daniel Cazes signale qu’une photographie de Jean Dieuzaide est reproduite sur le panneau explicatif. Prise depuis la place Saint-Jacques, elle montre comment, avant la démolition, la tour était intacte et dépassait du toit du bâtiment. Entre 1970 et 1973, la courtine et la tour ont donc été détruites sur la quasi-totalité de leur élévation. Daniel Cazes réaffirme son étonnement devant le fait qu’un monument public, en l’occurrence l’enceinte romaine de Toulouse, devenu propriété de l’État, soit ensuite revendu par celui-ci à un promoteur privé. Lorsqu’il compare à ce qui se passe à Milan, à Barcelone, à Saragosse, il observe des opérations inverses, c’est-à-dire que la Commune rachète au secteur privé des vestiges pour les sauver et les mettre en valeur… Quitterie Cazes remarque que, toutefois, une fouille préalable à la reconnaissance des vestiges a été effectuée, ce qui va dans le bon sens. Les résultats de l’étude d’archéologie du bâti réalisée pour la partie du rempart visible sont particulièrement attendus par les membres de la Société.

Séance du 3 janvier 2023
Communication longue de Gilles Séraphin, De Saint-Emilion à Duravel, la migration des formes saintongeaises vers le Quercy occidental (fin XIIe – milieu XIIIe siècle).
Lire le compte-rendu
Un repérage du patrimoine architectural dans la moyenne vallée du Lot, aux limites du Quercy et de l’Agenais, a permis de mettre en évidence une vingtaine d’églises médiévales, caractérisées par la présence de dalles percées entre les modillons des corniches. A partir de l’une d’entre elles, une enquête fondée sur l’étude comparée de la modénature a permis d’identifier, autour de Duravel et de Monsempron, la signature de plusieurs ateliers locaux. L’enquête a permis également de jalonner la pénétration jusqu’en Quercy occidental d’un vocabulaire formel emprunté à la Saintonge méridionale par l’intermédiaire des grands chantiers du Libournais et de l’Entre-deux Mers : Saint-Emilion, Saint-Ferme et la Sauve-Majeure.
En logo et ci-dessous : Gavaudun, église Saint-Sardos-de-Laurenque (47)
Présents : Mme Czerniak, Présidente, MM. Cabau, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier, Péligry, Bibliothécaire-archiviste, Mmes Napoléone, Secrétaire générale, Machabert, Secrétaire-adjointe ; Mmes Bessis, Fournié, Jaoul, Pradalier-Schlumberger, Watin-Grandchamp, MM. Cazes, Garland, Garrigou Grandchamp, Penent, Peyrusse, Pradalier, Surmonne, Testard, Tollon, membres titulaires ; Mmes Henocq, Ledru, Rolland Fabre, MM. Carraz, Kérambloch, Pousthomis, membres correspondants.
Excusés : Mmes Balty, Cazes, Lamazou-Duplan, MM. Balty, Scellès, Sournia, Stouffs.
La Présidente salue l’assemblée en réitérant tous ses vœux pour cette nouvelle année 2023 et accueille au nom de tous les membres Carline Henocq nouvellement élue membre correspondant de notre Société. Elle rappelle ensuite qu’il est d’usage de régler sa cotisation à la première séance de l’année civile et invite chacun à le faire. Le Trésorier ajoute que celle-ci s’élève à 50 euros et qu’il détient la liste des membres qui ne sont pas à jour de leurs contributions.
Puis on nous présente un ouvrage donné à la bibliothèque de la Société par Pierre Garrigou Grandchamp :![]() Philippe Araguas, D’Ausone à Montaigne, Bordeaux au Moyen Âge, la ville et ses monuments, éd. Entre deux mers, 2022.
Philippe Araguas, D’Ausone à Montaigne, Bordeaux au Moyen Âge, la ville et ses monuments, éd. Entre deux mers, 2022.
Virginie Czerniak passe ensuite la parole à Daniel Cazes pour évoquer la mémoire de Monique Gilles, notre consœur, décédée le 8 décembre dernier.
Monique Gilles a été très peu de temps membre de notre Société avant d’avoir été à sa demande élue membre libre car elle ne pouvait plus assister à nos séances en raison de son état de santé. Je rappellerai qu’elle était l’épouse d’Henri Gilles qui a été très longtemps membre très fidèle de notre Compagnie. Tous deux étaient très attachés à notre Société. Ils s’étaient connus à l’École des Chartes. Monique Gilles est donc décédée le 8 décembre dernier, c’est pour cela que nous n’avons pas pu en faire état depuis notre dernière séance, et ses obsèques ont eu lieu en l’abbatiale de Moissac le 13 décembre. J’ai pu m’y rendre pour représenter la Société et je dois vous transmettre à tous les remerciements d’Anne-Véronique Gilles, leur fille. Quelques jours plus tard, il y a eu une autre cérémonie à l’église de la Dalbade et d’autres membres de notre Société ont pu y assister. Monique Gilles était née à Saïgon le 12 mai 1928 et devenue archiviste-paléographe dans la promotion 1952 de l’École des Chartes. Elle avait été ensuite promue ingénieur au CNRS à partir de 1954, puis rattachée à plusieurs laboratoires au cours de sa carrière, entre 1954 et 1989. Elle a publié plusieurs ouvrages, dont La guerre de Cent ans à travers les registres du Parlement avec Pierre-Clément Timbal, puis Odoranus de Sens : Opera 0mnia en 1972, une Chronique de Saint-Pierre-le-Vif de Sens dite de Clarius, en 1979, en collaboration avec Robert-Henri Bautier. Puis, Les coutumes de l’Agenais en deux tomes en 1976 et Les Forts anciens du Béarn en 1990 en collaboration avec Paul Ourliac. Sa thèse de l’École des Chartes portait sur Le chemin dans la toponymie du Midi de la France. C’était une personne très agréable, très cultivée, et nous avons eu grand plaisir à l’accueillir au sein de notre Société ; malheureusement ce fut pour peu de temps. Elle est décédée à Moissac au milieu des siens.
La Présidente propose d’observer une minute de silence en la mémoire de notre consœur décédée.
Elle donne ensuite la parole à Gilles Séraphin pour une communication longue intitulée De Saint-Émilion à Durave : la migration des formes saintongeaises dans le Quercy occidental entre la fin du XIIe siècle et le milieu du XIIIe siècle.
La Présidente remercie notre confrère pour cette présentation qui illustre l’adage de Daniel Arasse : « tout est dans le détail ». Son propos met par ailleurs en lumière les problèmes que tout le monde se pose, à savoir la circulation des « artistes », leur formation et l’existence éventuelle de carnets de modèles. Elle demande ensuite s’il a été possible de faire des liens de féodalité et de vassalité ou de rattachement à une abbaye entre les édifices présentés, ou encore s’il existe des données prosopographiques. Notre confrère avoue avoir essayé de chercher des correspondances de ce type, sans succès. En revanche, ajoute-t-il, les formes qui décorent cette dizaine d’église situées à l’extrême ouest de la vallée du Lot ne se trouvent nulle part ailleurs en Quercy (et toutes les églises ont été visitées dans le cadre de la publication de l’ouvrage sur les églises du Lot). Louis Peyrusse se dit très admiratif à la vue du corpus déployé, mais il se demande si l’on peut tirer des conclusions chronologiques d’un vocabulaire de formes. Gilles Séraphin répond qu’en effet, le fait de trouver les mêmes formes de modénature dans deux édifices différents ne prouve rien. En revanche, si l’on observe une combinaison de deux à trois moulures reproduites dans plusieurs édifices, on est face à une convergence qui peut paraître intéressante. Intéressante pour la circulation des formes, reprend Louis Peyrusse, mais pas pour la datation. Pourtant, insiste Gilles Séraphin, quand on étudie un édifice comme Saint-Amand-de-Coly, dont la construction s’étire sur trois ou quatre campagnes, on voit que les tailleurs de pierre n’ont aucun scrupule à changer les profils de moulures et qu’ils ne cherchent pas à les raccorder. On observe qu’à chaque campagne on respecte le projet initial sur le plan architectural mais qu’il n’y a aucun souci d’harmonisation du détail de la modénature (Saint-Ferme et La Sauve-Majeure). Par ailleurs, lorsque les moulures sont faites d’avance par les tailleurs de pierre ; on peut penser qu’il y a déjà un début de mécanisation. Gilles Séraphin reconnaît qu’il est parti d’un principe, qui peut être discutable, qui est que les grands édifices ont précédé les plus modestes ; la chapelle de Pestilhac est donc vraisemblablement plus récente que ses modèles supposés (La Sauve-Majeure et Saint-Ferme). Une fois ce principe admis, il y a donc, selon lui, deux façons de voir les choses : comme Dubourg-Noves, penser que tout est contemporain du premier quart du XIIe siècle en déconnectant ceux d’apparence précoce de ceux d’apparence tardive ou, comme certains archéologues et historiens de l’art actuels, admettre des datations tardives (fin XIIe-début XIIIe), ce qui serait plus cohérent pour ce groupe d’édifices, en accord avec les plus récents d’entre eux. Enfin, ces formes ne sont pas présentes sur toutes les églises du Sud-Ouest. Ils se répartissent sur une diagonale, de Saintes à l’Ouest du Quercy, qui exclue une grande partie de la région.
Michèle Pradalier se dit étonnée par la rareté du motif des entrelacs. Seul un chapiteau montre ce décor dans l’ensemble des églises présentées, alors que dans le proche Rouergue il est le motif par excellence et il est, en outre, assez bien daté. Gilles Séraphin pense avoir déterminé deux types de motifs à entrelacs : le premier daté des environs du milieu du XIe siècle et le second de la fin du XIIe-début XIIIe. Ce dernier semble vouloir reproduire volontairement le plus ancien sans pouvoir respecter cependant la symétrie parfaite mise en œuvre sur les originaux (par exemple Saint-Pierre-Toirac). Notre Présidente demande si l’histoire de ces édifices est étayée par des textes. Aucune source n’a été trouvée par les universitaires toulousains sur ces églises répond Gilles Séraphin. Virginie Czerniak propose à notre confrère de consulter également les travaux universitaires soutenus à la faculté de Bordeaux. Pour en avoir parlé avec Philippe Araguas, Gilles Séraphin confirme qu’aucune étude n’a été faite de ce côté-là non plus.
Henri Pradalier félicite notre confrère pour le périple effectué dans le cadre de cette étude et souscrit à la datation basse qu’il a proposée. Ses références se situent en Espagne et plus particulièrement à Salamanque où il a pu noter une influence tout à fait surprenante de la Saintonge et du Poitou dans les thèmes décoratifs, le traitement des chapiteaux et certaines formes de moulures (dans les années 1190-1230). L’influence du monde Plantagenêt est sensible dans le León et la partie occidentale de la Castille ; il invite donc notre confrère à prendre en compte les édifices de cette région. Par ailleurs, dans le dernier groupe d’églises présentées – celui de Saint-Ferme -, la sculpture des chapiteaux évoque également celle de Saint-Sernin : les animaux contournés, affrontés sont en effet des thèmes communs à la basilique toulousaine et à d’autres églises proches de la vallée de la Garonne. Il en est de même de petits détails de forme auxquels notre confrère s’est intéressé, comme les palmettes grasses s’achevant sur les angles par de petites têtes. Gilles Séraphin fait remarquer qu’il s’agit là en effet de thèmes très répandus qui ne sont sans doute pas probants si on les isole des autres formes ; en revanche, associés aux volutes en colimaçon, par exemple, ils paraissent plus intéressants. En revenant sur la question des datations basses, il évoque le caractère tardif des premières réalisations gothiques de Cahors, à la cathédrale et à Saint-Urcisse, dans les années 1260-1270, et se demande quelles étaient alors les formes des édifices bâtis jusqu’à cette époque : romane ?. De plus, en passant d’un style à l’autre, on peut penser qu’il y a eu une phase de chevauchement.
Pierre Garrigou Grandchamp remercie notre confrère de mettre en évidence une fois de plus la possibilité d’avoir deux langages contemporains différents. L’exemple de l’église Saint-Urcisse à Cahors est sans doute le plus probant, mais on en trouve d’autres ailleurs, éventuellement avec des architectures produites par des milieux sociaux différents. En Limousin par exemple, les demeures bâties en ville adoptaient les formes gothiques dès la seconde moitié ou le dernier tiers du XIIIe siècle, alors que dans le même temps on construisait en milieu rural des tours maîtresses avec des fenêtres géminées de style roman. Il faut donc être à la fois vigilant et humble car on peut avoir deux langues qui coexistent, soit qu’il y ait des vieux et des jeunes qui cohabitent, soit qu’il y ait des milieux qui, pour des raisons politiques, économiques ou autre, s’expriment avec un vocabulaire différent. Gilles Séraphin ajoute qu’il y a aussi des différentiels de culture. Par exemple le Bauhaus (1925-1930) par exemple n’a pas pris en milieu rural. Cela est valable également pour la peinture monumentale, ajoute Virginie Czerniak, entre les espaces cultuels et les espaces civils. Ainsi, à la Commanderie de Soulomès dans le Lot, les peintures du deuxième quart du XVIe siècle qui décorent le chevet sont médiévales par la forme et par l’esprit, en revanche, celles qui décorent la maison du commandeur des Hospitaliers sont franchement modernes ; les deux ensembles ont été exécutés par le même atelier.
Pierre Garrigou Grandchamp demande encore si des charpentes ou des bois susceptibles de faire l’objet d’analyses de dendrochronologie sont conservés dans les édifices cités. Gilles Séraphin répond qu’il est peu probable que ceux qu’il a vus puissent dater de l’époque de la construction des édifices.
Michèle Pradalier voudrait faire une remarque au sujet des Mémoires. Elle rappelle qu’un comité de lecture avait été mis en place dans les années 2000 pour la publication des Mémoires. Pour le Moyen Âge, elle avait proposé Éliane Vergnolle. Cette dernière lui a dit qu’elle recevait très peu d’articles, un certain nombre d’entre eux paraissent donc dans les Mémoires sans être relus. Elle y voit une baisse de qualité pour les Mémoires qui ont une réputation internationale. La Présidente répond que tous les articles sont relus deux fois, y compris ceux concernant cette période, même s’ils ne sont pas forcément envoyés en relecture à Éliane Vergnolle.
Au titre des questions diverses, la parole est donnée à Daniel Cazes qui nous signale un petit article publié fin novembre dans un journal local gratuit intitulé Côté Toulouse. Cet article au titre de « Toulouse, une ville où il fait bon investir » s’achève par un avis de vente : « A vendre à Toulouse. Terrain à bâtir de 1152 m2 au cœur du quartier Saint-Etienne ». C’est une vente publique qui se tiendra les 19 et 20 janvier ; première offre possible : 3,6 millions d’euros. Il s’agit d’un terrain qui est vacant depuis 50 ans entre la place Saint-Jacques, la rue Bida et la rue Saint-Anne. Il appartient à l’État qui l’avait acheté et avait fait démolir les constructions qui se trouvaient dessus pour l’agrandissement du Rectorat. Finalement le Rectorat a été installé sur les terrains de la Caserne Niel, tandis que le premier est resté terrain vague. Celui-ci est cependant très intéressant puisqu’il conserve une section importante de l’enceinte romaine de Toulouse du Ier siècle avec une première tour, dont les bases sont conservées en élévation sur près de deux mètres. Daniel Cazes rappelle que personne n’a voulu depuis le milieu du XXe siècle, sauf décision récente dont nous n’aurions encore connaissance, prendre de mesures de protection pour les vestiges archéologiques de l’enceinte romaine de Toulouse, alors qu’il s’agit d’un monument d’un intérêt considérable en France et en Europe. L’État vend donc le terrain avec le vestige à l’intérieur. Il est tout de même regrettable que la puissance publique (État ou Ville) ne conserve pas et ne mette pas en valeur elle-même ce monument. En retournant sur les lieux, Daniel Cazes a pu constater que la DRAC avait repris des fouilles sur ce site. Elle a fait nettoyer l’ensemble et dégager la suite de la courtine. On voit bien désormais l’amorce de la seconde tour qui n’était jusque-là connue que par les plans et documents graphiques. On voit également que l’on avait tiré des blocs de la partie supérieure du rempart, retrouvés basculés hors les murs et à leur pied. Notre confrère suppose que la DRAC va imposer des contraintes au promoteur pour la conservation, la mise en valeur, l’intégration de ce vestige dans le programme immobilier. Dans ce cas, il serait bon qu’il soit visible depuis la voie publique. Louis Peyrusse rappelle que le Rectorat avait renoncé à investir ce terrain en raison de son incapacité à traiter les vestiges archéologiques, alors que le projet de construction était très avancé. Par ailleurs, le portail du XIXe siècle néo-Louis XIII de l’entrée de l’hôtel de Lestang étant classé, il y aura donc au moins un problème de co-visibilité avec un Monument Historique. Virginie Czerniak demande aux membres s’il leur semble judicieux que la Société envoie un courrier pour exprimer son inquiétude quant au devenir de ces vestiges. On s’accorde pour envoyer un courrier au Préfet avec copie à la conservation des Monuments Historiques.
Daniel Cazes se dit accablé par ce climat d’indifférence générale face à ce monument majeur qu’est l’enceinte romaine de Tolosa, que l’on détruit par petits bouts à chaque fois qu’il y a des travaux. À Nîmes, poursuit-il, l’enceinte n’est pas forcément mise en valeur, mais elle n’est jamais détruite ; nous sommes pourtant dans le même pays avec les mêmes lois. Gilles Séraphin rappelle que Nîmes est connue pour ses vestiges antiques, ce qui n’est pas le cas de Toulouse. Pourtant reprend Daniel Cazes, depuis la thèse de Michel Labrousse en 1968, l’Antiquité toulousaine est connue des spécialistes du monde entier et ses vestiges méritent d’être présentés au public, comme cela est fait dans bien d’autres villes d’origine romaine d’Europe. Dominique Watin-Grandchamp nous propose de prendre contact avec Marie-Emmanuelle Desmoulins qui a travaillé à étendre la protection du rempart romain de Toulouse ; elle pourra sans doute nous donner plus d’informations à ce sujet. Gilles Séraphin demande si le terrain en question est sur le secteur sauvegardé ; c’est effectivement le cas mais sa création n’a pas été validée. Dominique Watin-Grandchamp rappelle qu’à partir du moment où celui-ci est cartographié et qu’un périmètre a été posé, même si la Ville retarde l’échéance pour le voter, il s’applique. Olivier Testard précise encore que le périmètre a été validé, mais que c’est le règlement du secteur sauvegardé qui n’est pas encore approuvé en Conseil d’État. Donc, dans le temps de l’instruction, c’est l’architecte des Bâtiments de France et le chargé d’étude qui sont décisionnaires.
Une seconde question d’Actualité nous est présentée par notre Trésorier au sujet d’un article concernant le Musée des Augustins (https://www.lejournaldesarts.fr/patrimoine/les-complications-du-chantier-du-musee-des-augustins-164322). En travaux depuis 2017, celui-ci est ouvert ponctuellement et partiellement, notamment lors de quelques expositions temporaires. Il ne devrait pas retrouver son activité normale avant 2025. La première phase du chantier s’est achevée avec la remise en état des verrières, l’accessibilité des lieux, l’aménagement des locaux affectés au personnel, des travaux de peinture ; on devait poursuivre par la construction du pavillon d’accueil. Des fouilles archéologiques préventives entamées en novembre 2020 « ont retardé considérablement l’aménagement de cette extension car les archéologues ont fait une découverte majeure en mettant au jour les vestiges d’une chapelle renaissance à l’emplacement même du futur pavillon d’accueil » ; les travaux devaient initialement être achevés en 2022. Notre Présidente fait remarquer que l’on savait très bien que cette chapelle existait puisqu’elle est visible sur les plans anciens. Guy Ahlsell de Toulza poursuit la lecture de l’article : « la DRAC d’Occitanie interdit alors la construction au-dessus de ces vestiges, parmi les options discutées entre la ville et la DRAC, c’est le déplacement de la chapelle près de son contexte de découverte qui a été retenu. Le lieu précis doit être encore techniquement validé… ce sera à proximité des Augustins, peut-être à l’intérieur du Musée… ». Virginie Czerniak précise que cette chapelle n’est pas « renaissance », elle est du début XVIe siècle et pleinement médiévale dans sa forme. Elle pense par ailleurs que ce déménagement de vestiges n’a aucun sens ; n’aurait-il pas été possible de mettre un plancher de verre ou d’aménager une structure pour les rendre visibles ?

Séance du 6 décembre 2022
Communication courte de Laurent Macé, Quand les Picard portaient des peaux de bêtes à Toulouse.
Communication courte de Dominique Watin-Grandchamp, Des franciscains dans un tiroir.
Lire le compte-rendu
Communication courte de Laurent Macé, Quand les Picard portaient des peaux de bêtes à Toulouse.
La galerie lapidaire du musée des Augustins de Toulouse recèle un certain nombre de trésors lapidaires. L’une de ces inscriptions, présentée dans le cadre de l’exposition Toulouse 1300-1400. L’éclat d’un gothique méridional qui se tient en ce moment-même au musée de Cluny (Paris), mérite tout particulièrement l’attention. Tout d’abord, parce qu’elle est demeurée inédite jusqu’à ce jour ; ensuite, parce qu’elle livre l’épitaphe d’un marchand de fourrures ; enfin, parce que ce document, en apparence bien anodin, est singulier à bien des égards. Une simple notice de quelques lignes dans un catalogue d’exposition ne suffira donc pas à livrer la totalité des informations qui se dégage de cette inscription gravée dans la pierre.
Communication courte de Dominique Watin-Grandchamp, Des franciscains dans un tiroir.
Des Franciscains dans un tiroir
A l’occasion de la restauration d’un meuble de sacristie à l’église de la Daurade, à Toulouse, le restaurateur et la conservatrice du Patrimoine de la ville de Toulouse Marie-Dominique Labails ont découvert que les fonds de tiroir du meuble étaient constitués de planches peintes en réemploi. Elles représentent des personnages, crucifiés, en habit de moine. Les cartels qui sont sur les croix portent des noms, « latinisés », qui ont permis d’identifier quatre des six frères franciscains figurant parmi les vingt-six victimes d’un massacre de religieux à Nagasaki (Japon), en 1597. Les martyrs de Nagasaki ont été béatifiés en 1627 par le pape Urbain VIII puis canonisés, en 1862, par le pape Pie IX
L’iconographie de cet épisode se diffuse dans la chrétienté par des gravures, comme celle de Jacques Callot (1627), qui ont fortement inspiré le décor peint datable du XVIIe siècle.
Le meuble de sacristie semble réalisé au début du XIXe siècle et il utilise des bois de récupération. Nous n’en avons plus que des vestiges fragiles mais il est possible que cet ancien décor de lambris ou de petit retable provienne du couvent des Cordeliers de la Grande Observance de Toulouse, dépecé entre 1790 et 1802.


1-Meuble de sacristie XIXe à la Daurade (Toulouse)
2-Moine franciscain crucifié, peint sur une planche de fond de tiroir (réemploi)
3-Martyre de 6 franciscains, parmi 26 religieux, à Nagasaki (Japon) en 1597
(Gravure de Jacques Callot en 1627)
Présents : Mme Czerniak, Présidente, MM. Cabau, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier, Mme Machabert, Secrétaire-adjointe, M. Péligry, Bibliothécaire-archiviste ; Mmes Fournié, Jaoul, Watin-Grandchamp, MM. Cazes, Garland, Macé, Peyrusse, Scellès, Sournia, Surmonne, membres titulaires ; Mmes Dumoulin, Ledru, Rolland, M. Carraz, membres correspondants.
Excusés : Mme Napoléone, Secrétaire générale ; Mmes Cazes, Lamazou ; MM. Garrigou Grandchamp, Kerambloch, Penent, Tollon.
La Présidente ouvre la séance en évoquant la mémoire de notre confrère Jean-Luc Boudartchouk, dont nous avons appris la disparition avec une immense tristesse. En hommage, la Présidente lit le texte de Dominique Garcia, Directeur de l’INRAP, retraçant la brillante carrière de Jean-Luc Boudartchouk. Virginie Czerniak ajoute qu’il était un des piliers de notre Société, très actif, disponible pour proposer des communications passionnantes, et répondant toujours présent aux sollicitations. Jean-Luc Boudartchouk était un conférencier exceptionnel, un collègue fabuleux, qui nous manquera considérablement. Pour Daniel Cazes, Jean-Luc Boudartchouk était un membre très important de notre Société, qui a procuré des publications nombreuses, toujours brillantes. Ses qualités humaines sont unanimement rappelées. Nombreux sont ceux, au sein de la Société, à le compter comme un ami, trop tôt disparu. Daniel Cazes l’avait rencontré à Toulouse, lors de la fouille, déterminante dans la carrière de notre confrère, du palais des Wisigoths à Larrey, en 1988. Après ce chantier, il s’est passionné pour cette période et il a participé à des découvertes sensationnelles : celle du podium du temple du Capitole place Esquirol reste la plus importante. Son apport en matière archéologique est considérable. La Présidente revient sur son rôle déterminant dans la connaissance de la Toulouse antique : les fouilles de la place Esquirol, les travaux sur l’hagiographie de saint Antonin… Nombreux sont les chercheurs qui ont pu bénéficier de son travail scientifique exemplaire et de son sens du partage, au service du bien commun. Après ces quelques mots, c’est, submergée par une vive émotion, que l’assemblée observe une minute de silence. En cet instant bouleversant, nos pensées sont tournées vers les proches de Jean-Luc Boudartchouk et en particulier vers sa compagne, Anne-Laure Napoléone. Nous lui témoignons tout notre soutien et l’accompagnons de notre sincère affection dans cette épreuve.
La Présidente souhaite la bienvenue à Damien Carraz, nouveau membre. Puis elle signale les dons d’ouvrages faits par Maurice Scellès pour la bibliothèque : Camille Enlart, Manuel d’archéologie française depuis les temps mérovingiens jusqu’à la Renaissance. Première partie : Architecture. II Architecture civile et militaire, Paris, Picard, 1904 ; Sébastien Poignant (dir.), L’habitat médiéval de Comble Male, Nadillac (Lot), 2 vol., SRA-DRAC Midi-Pyrénées, 1999 ; Marcenaro Mario, Il battistero paleocristiano di Albeng ; le origini del cristianesimo nella Liguria, Recco (Genova), 1994 ; Albert Gleizes, Vers une conscience plastique, la forme et l’histoire, Paris, Jacques Povolozky, 1932, exemplaire numéroté.
Notre Présidente donne ensuite la parole à Laurent Macé pour sa communication courte : Quand les Picards portaient des peaux de bêtes à Toulouse. À propos d’une inscription lapidaire du XVe siècle.
Virginie Czerniak remercie notre confrère pour sa présentation. Elle rappelle que les armes de Dominique Grima dans la chapelle Saint-Antonin du couvent des Jacobins sont également très personnelles et allusives puisqu’il introduit en partie inférieure la barque qui fait référence à la translation miraculeuse des reliques de saint Antonin, le saint patron de l’évêché de Pamiers, dont il occupe le siège épiscopal à la fin de sa vie. La structure est ainsi similaire à celle présentée ici. L’exemple est donc intéressant : l’usage ne diffère pas pour les clercs.
Michelle Fournié intervient au sujet de la représentation de saint Jacques sur l’épitaphe présentée à titre de comparaison (musée de Brive). Elle signale que saint Jacques a été figuré en apôtre avant de l’être en pèlerin. Emmanuel Garland mentionne une première trace dès 1210 à Mimizan. Michelle Fournié poursuit en précisant que le lien de Jacques le Majeur avec la mort est très développé dans les travaux de Denise Péricard-Méa, auteure d’une thèse sur le culte de saint Jacques. Cette dernière développe notamment l’idée d’un saint Jacques psychopompe, conducteur des morts ; aussi, s’il s’agit bien de saint Jacques, l’iconographie présentée ici peut y faire référence. D’autre part, dans le Registre d’inquisition de Jacques Fournier (1319-1323) certains témoins racontent que les défunts accomplissent post mortem un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, ce qui est une croyance bien répandue dans le Midi de la France. Par ailleurs, il existe à Toulouse plusieurs confréries Saint-Jacques, dont les archives sont conservées : le registre de la confrérie Saint-Jacques du Bourg ne concerne malheureusement pas le secteur de Saint-Michel, mais 1 200 noms de confrères de la fin du XIIIe et du début XIVe siècle y sont énumérés. Le registre de Saint-Jacques de la Cité est, quant à lui, conservé à Cracovie, mais il est numérisé. Ce sont peut-être des pistes pour retrouver des traces de ce « Guilheume de Paris ». Daniel Cazes demande si la « marque de marchand » peut avoir un caractère monogrammatique ? Laurent Macé par la négative, elle lui semble plutôt ressortir du domaine des seings de notaires. Concernant la date, Daniel Cazes remarque que souvent dans des écus médiévaux se retrouvent des marques de ce genre, chantournées, mais plutôt monogrammatiques avec des éléments de croix, des lettres enlacées… Il signale, par exemple, celles présentes sur deux écus de la sacristie des Augustins, des années 1320. En étudiant les collections du Musée des Augustins et en opérant des comparaisons, Daniel Cazes avait remarqué que ces signes monogrammatiques étaient surtout très fréquents dans le premier quart du XIVe siècle. Maurice Scellès se souvient en avoir trouvé dans les édifices religieux du Quercy et il ajoute que les albums de l’armorial général de Charles d’Hozier en donnent de nombreux exemples. Laurent Macé précise qu’il en existe aussi beaucoup sur les plafonds peints au XVIe siècle. Valérie Dumoulin indique qu’il existe une très nombreuse série de plafonds peints avec des marques de marchands pour l’année 1492, qui est une année-clé. Il y en a, dès 1450, à Pont-Saint-Esprit, puis après à Pomas et à Lagrasse, où beaucoup de commerces étaient installés. En l’absence de répertoire, ces marques n’ont pu être identifiées. La seule étude connue sur le sujet est un article de Géraud de Lavedan sur les marchands-pasteliers. En raison de l’absence de date, notre Directeur demande si l’exécution de cette épitaphe est antérieure ou postérieure à la mort ? Au vu du développement iconographique, il semble que le commanditaire en ait surveillé l’exécution. La réalisation aurait donc été effectuée de son vivant conclut Patrice Cabau. D’autres cas sont recensés. À titre d’exemple, notre confrère mentionne une épitaphe de Saint-Bertrand-de-Comminges, qu’il a revue la veille, sur laquelle seul manque le millésime de la mort.
La parole est ensuite donnée à Dominique Watin-Grandchamp pour la seconde communication courte du jour : Des Franciscains dans un tiroir.
La Présidente remercie notre consœur pour sa présentation passionnante. Elle revient sur la datation de ces peintures, probablement du XVIIe siècle. Dominique Watin-Grandchamp confirme cette hypothèse : pour elle, elles ont été exécutées peu de temps après la béatification en 1627. Il y a alors une circulation d’informations et une correspondance très vive entre les établissements franciscains, y compris d’un continent à l’autre. Aussi, l’iconographie se diffuse-t-elle très vite. Par ailleurs, le style des peintures est aussi caractéristique du XVIIe siècle. Les grisailles évoquent le travail d’un illustrateur ou d’un graveur, plutôt que celui d’un peintre. En effet, les positions des personnages sont un peu hiératiques, mais la minutie dans le détail est perceptible. Les flots de sang font penser aux stigmates, note Virginie Czerniak. La mise en parallèle iconographique n’est sans doute pas anodine dans le contexte franciscain. Ce sang apparaît blanc, renvoyant au sang des êtres pieux, ajoute Dominique Watin-Grandchamp. Cet élément est accentué par le fond rouge. Ces peintures sont, chromatiquement, très étudiées. Ainsi, elles auront été réalisées dans le deuxième quart du XVIIe siècle conclut Emmanuel Garland. « Que vont devenir ces panneaux ? », demande notre Présidente. Dominique Watin-Grandchamp répond que le meuble ne sera pas protégé ; par contre l’existence des panneaux est signalée et une restauration a été demandée afin d’éviter la disparition, à l’usage, d’un autre personnage peint. Les tiroirs sont actuellement condamnés et les peintures invisibles. Leur dépose n’est pas encore envisagée. Les panneaux auraient toute leur place au Musée des Augustins. Dominique Watin-Grandchamp revient sur le travail du menuisier, qui semble avoir volontairement rabouté les planches, même lorsqu’elles étaient incomplètes. Des traces au-dessus du chapelet de saint François montrent qu’un nœud de bois a été rebouché, ce qui signifie que la restauration a été « restaurée » dans les dernières années du XIXe siècle ou dans le courant du XXe. D’évidence, l’auteur du meuble a voulu conserver les panneaux peints, sinon la coupe ne serait pas aussi propre, complète Maurice Scellès, Leur positionnement en fond de tiroir n’est sans doute pas innocent, ajoute Dominique Watin-Grandchamp. Louis Peyrusse s’intéresse à la gravure de Sadeler montrée lors de la présentation. Le paysage et le positionnement des croix de cette composition rend crédible la proposition faite par une stagiaire pour restituer l’organisation des panneaux peints. Cet ensemble n’est pas nécessairement un décor de chapelle : il peut s’agir d’un décor à l’intérieur du couvent, dans un lambris. Dominique Watin-Grandchamp confirme : ces planches, par leur épaisseur et leurs cloutages, constituaient un lambris de petit module. Louis Peyrusse suggère qu’il peut s’insérer dans un couloir du couvent, au-dessus d’un meuble. Ou alors au-dessus d’un meuble de sacristie, complète Virginie Czerniak. La gravure est la source indirecte de ces peintures selon Louis Peyrusse. Notre Trésorier rappelle la présence, dans la sacristie de la cathédrale de Castres, d’un meuble composé de deux éléments ; dans sa partie supérieure sont intégrées des peintures ; la partie haute, en dosseret, permet d’éviter d’avoir les objets contre le mur. Cela expliquerait aussi les traces d’éclaboussures de cierges. Dominique Watin-Grandchamp poursuit en ce sens : le bas d’une des planches est laissé brut, ce qui permet d’imaginer une baguette de lambris et une planche encochées dans quelque chose qui les dissimule. Y-a-t-il des traces d’assemblages, des queues d’aronde, demande alors Virginie Czerniak ? Il n’y en a pas sur les planches ; d’ailleurs aucune n’est vraiment cohérente, répond Dominique Watin-Grandchamp. Par exemple, la planche figurant saint Pierre-Baptiste a été raboutée mais pas entièrement, et une partie de la représentation a été gommée. Ce qui irait dans le sens d’une volonté de conservation, souligne Maurice Scellès. Louis Peyrusse résume : d’une part le menuisier faisait des économies en réemployant ces planches, d’autre part il sauvait ces éléments peints sacrés. Daniel Cazes note un autre point intéressant, celui du choix de la grisaille, qui était à la mode au XVIIe siècle. Ainsi en est-il des peintures de François Fayet illustrant la vie de saint Bruno encore en place dans le chœur de l’église des Chartreux de Toulouse. Dominique Watin-Grandchamp constate que, malgré ces éléments stylistiques, il est difficile de savoir qui, dans le milieu toulousain de la période, travaillait de la sorte. Louis Peyrusse précise que si le modèle de la commande était la gravure de Sadeler, le peintre a dû s’y conformer. Tout dépend donc du marché passé. La qualité de la facture est indéniable : la représentation des pieds sur les sellettes et les jeux d’ombres jusqu’au choix de la polychromie. Guy Ahlsell de Toulza signale qu’un film retrace l’histoire de ces moines à Nagasaki. Mme Watin-Grandchamp rappelle le contexte : dès leur arrivée, les Franciscains ont une action sociale et de conversion immédiatement très efficace ; en 1596, ils sont arrêtés une première fois, accusés de préparer la venue de marchands ibériques ; un an plus tard, ils sont crucifiés à Nagasaki, sur le côté de la colline devant la mer, face à l’Occident – force du symbole !
Au titre des questions diverses, Maurice Scellès relaie un message de Jacques Lapart, Président de la Société archéologique du Gers, ancien membre de la Société archéologique du Midi de la France. Celui-ci nous transmet ces quelques lignes extraites d’un acte de notaire d’Auch et pouvant intéresser certains de nos membres :
« Le 27 mars 1672, accord entre Joseph Lacroix architecte et tailleur de marbre de St-Bertrand de C pour sr Gervais Drouet me architecte d’Auch … de luy faire un tombeau de marbre bien noir meslé de qque peu de blanc conformément au profil qui y a esté présentement bailhé … et lesd tombeau led Lacroix promet et s’oblige de l’avoir fait et parfait pour la feste de St Jean B prochain, poly, lustré et mis en place ds la ville de Thle dedans l’église du couvent des pères Cordeliers de la grande observance pour le tombeau de feu Monsieur le président Dauneville … pour 160 l » ( 3 E 2424 f° 76 v°, Me Desquac notaire d’Auch.)
Avant de clore la séance, la Présidente rappelle qu’une visite de l’exposition Toulouse 1300-1400, l’éclat d’un gothique méridional au Musée national du Moyen Âge – Cluny est au programme de nos activités, le samedi 14 janvier 2023. Celles et ceux qui souhaitent y assister sont invités à s’inscrire directement auprès d’elle.

Séance du 22 novembre 2022
Lire le compte-rendu
Présents : Mme Czerniak, Présidente, MM. Cabau, Directeur, Ahlsell de Toulza, Trésorier, Péligry, Bibliothécaire-archiviste, Mme Machabert, Secrétaire-adjointe ; Mmes Fournié, Jaoul, Merlet-Bagnéris, Watin-Grandchamp, MM. Cazes, Garrigou Grandchamp, Lassure, Macé, Peyrusse, Tollon, membres titulaires ; Mmes Dumoulin, Rolland, MM. Dubois, Pousthomis, membres correspondants.
Excusés : Mmes Balty, Cazes, Napoléone ; MM. Balty, Garland, Sournia.
La Présidente ouvre la séance et effectue pour commencer un point sur les dons d’ouvrages.
Notre Trésorier offre trois documents : Le Gaillac, vin de ville, vin des champs, « Cahiers du Patrimoine, 108 », Paris, l’Inventaire, éditions du Patrimoine, 2015, 320 p., distribué par la Région à l’occasion du colloque sur « La peinture monumentale en Occitanie » (28-30 septembre 2022). Deux ouvrages proviennent de l’ancienne bibliothèque de Madame Enjalbert : un opus Ville de Toulouse, Construction d’un nouveau théâtre du Capitole, étude et avant-projet par L. Sainmartin, impr. du Centre, [1913] et Capella M.L., Mousseigne A., Papillaut R., Stinco A., Les Abattoirs : histoires et transformation, Toulouse, les Abattoirs, 2000, 116 p.
Notre Présidente présente également un ouvrage reçu accompagné d’un courrier de la Directrice du site archéologique Lattara – musée Henri Prades, Diane Dusseaux : Les statues-menhirs et la fin du néolithique en Occitanie, collection DUO, Service régional de l’archéologie d’Occitanie-DRAC, 2022, 104 p. Il s’agit du catalogue de l’exposition pour laquelle la Société a prêté deux statues-menhirs (également disponible en ligne).
La Présidente invite ensuite Louis Peyrusse à faire un compte rendu de la réunion du 21 novembre organisée par Ana Debenedetti, nouvelle Directrice de la Fondation Bemberg, avec les Présidents des Sociétés savantes et académiques de l’Hôtel d’Assézat. Une discussion a été engagée au sujet de la plaque présentant l’Hôtel d’Assézat et les Académies et Sociétés savantes qui y sont installées. Rédigée par Paul Féron, elle mérite une nouvelle écriture. Louis Peyrusse, qui a représenté notre Société lors de cette réunion, fait également état du problème rencontré par la Fondation Bemberg au sujet de la mise aux normes incendie des bâtiments nécessitant l’installation de portes coupe-feu entre le corps du bâtiment et l’aile Ozenne. La question est à aborder avec l’Architecte en chef des Monuments historiques, Jean-Louis Rebière, en charge du chantier. Il a été assuré par Madame Debenedetti que l’escalier d’honneur resterait accessible pour l’usage. Par ailleurs, elle a rencontré Mme Debenedetti qui s’est montrée enthousiaste et pleinement ouverte à toutes les collaborations avec les Sociétés savantes. Louis Peyrusse fait circuler une version de l’avant-projet de muséographie de la Fondation Bemberg emprunté au Président Pech. La Directrice de la Fondation souhaiterait voir les travaux achevés pour la fin du printemps. Virginie Czerniak rappelle l’expérience de Madame Debenedetti, qui a œuvré pendant presque quinze ans au Victoria & Albert Museum ainsi qu’au Musée Jacquemart-André ; il s’agit d’une conservatrice très aguerrie qui souhaite faire de la Fondation un musée didactique avec une présentation modernisée. La réouverture, prévue pour le printemps prochain, est attendue avec intérêt.
Notre Présidente donne ensuite la parole à Laurent Macé pour présenter la candidature de Mme Carlyne Henocq au titre de membre correspondant.
Notre Présidente ajoute que la candidate appartient à une équipe très brillante de jeunes doctorantes de l’Université Jean-Jaurès et qu’une des raisons d’être de la Société est justement d’offrir une tribune à de jeunes chercheurs. Pierre Garrigou Grandchamp soulève la question de l’absence de publications de la candidate : son élection constituerait-elle une jurisprudence pour la Société ? Il est rappelé que les candidats au titre de membre correspondant, qui ont été primés par la Société, sont dispensés du dossier scientifique depuis 2007.
Il est procédé au vote : Carlyne Henocq est élue membre correspondant de notre Société.
Suivant l’ordre du jour, notre Présidente cède ensuite la parole à Jacques Dubois pour sa communication : L’ensemble conventuel des Augustins de Toulouse, enquête de chronologie : des premiers travaux aux réfections et modifications des années 1500 :
Bien connu du paysage toulousain, l’ensemble conventuel des Augustins, un des mieux conservés de la ville et de la région, ne bénéficiait pas encore de toute l’attention qu’il méritait et d’une étude renouvelée. L’histoire du monument ne se résume dans la plupart des cas qu’à quelques lignes reposant sur un discours uniquement fondé sur les textes, sans analyse ni confrontation avec la construction. Cette communication courte se propose donc de présenter sous le prisme de l’étude du bâti, croisée aux données des quelques sources manuscrites contemporaines des travaux, les premiers résultats d’une enquête en devenir. Ainsi, seront évoquées les différentes phases de construction et d’élaboration du couvent, entre la première campagne des années 1310 et celle des années 1500.
La Présidente remercie notre confrère pour ces observations. Elle demande s’il est possible de produire une frise reprenant les étapes de construction. Jacques Dubois explique que cela est encore difficile, le phasage obtenu à ce stade reste à clarifier et, surtout, certaines de ces phases sont délicates à dater. Virginie Czerniak revient sur les deux hypothèses d’interprétation : la première, celle d’un chantier étendu dans le temps jusqu’à la fin du Moyen Âge, que notre confrère repousse, et la seconde hypothèse : celle d’une reprise au niveau du gouttereau sud et de toutes les chapelles à la fin du Moyen Âge, après l’incendie de 1463. Le gouttereau des chapelles est édifié au XIVe siècle et celui de la nef plutôt après 1464 indique Jacques Dubois. Virginie Czerniak demande s’il en est de même pour le traitement de la modénature, ce qui concerne les arcs, les chapiteaux, pour l’accès aux chapelles. Notre confrère confirme ce point. Donc le gouttereau de la nef a bien été repris, il ne s’agit pas d’une fin de chantier. Virginie Czerniak s’interroge ensuite sur les traces de combustion visibles sur le morceau de poutre au niveau de l’entrée : une analyse dendrochronologique pourrait aider à affiner les datations. Le sujet est passionnant et notre Présidente saisit l’ampleur du travail pour parvenir à retracer et établir les différentes phases de constructions. Des contrats restent-ils à étudier ? Le retour aux sources archivistiques est indispensable. Dominique Watin-Grandchamp signale que Pierre Salies avait commencé ce travail et en a publié une partie. Jacques Dubois précise que son ouvrage n’inclut pas les contrats. Pierre Garrigou Grandchamp demande si les charpentes sont toutes neuves ou si des parties anciennes ont été trouvées. Elles sont toutes neuves répond Jacques Dubois. Un membre rappelle que l’ensemble a été restauré par Sylvain Stym-Popper. Valérie Dumoulin revient sur le voûtement du chœur. Cette partie qui a été financée par le marchand pastellier Pierre Buisson correspond à la partie de travaux de 1494, mais qu’y avait-il avant cette couverture : l’église était-elle plus vaste, y avait-il une toiture qui a brûlé ? Jacques Dubois indique que les indications dans le testament de 1316 sont difficiles à interpréter : il est prévu d’édifier entre les chapelles des voûtes ou des arcs en pierre. S’agit-il simplement d’une charpente sur arc diaphragme ? Daniel Cazes intervient : ayant passé dix ans au Musée des Augustins il a pu observer beaucoup des éléments montrés par notre confrère et convient qu’il est nécessaire de reprendre une analyse en archéologie du bâti, avec des relevés, ce qui constitue un travail colossal. Il rappelle qu’en arrivant aux Augustins il n’a pas eu l’impression que rien n’avait été fait pour la connaissance du bâtiment. À son sens, par rapport aux autres édifices, il existait au contraire de nombreux documents. Pierre Salies avait travaillé en archives, il existe également la précieuse chronique du Père Simplicien Saint-Martin, il y a donc beaucoup d’informations, qui ont été utilisées et publiées. Jacques Dubois reprend : à la différence des Jacobins, pour les Augustins il y a peu et aucune étude architecturale avec l’étude du bâti. Daniel Cazes ne partage pas ce bilan. Lors de son arrivée au musée, des textes avaient été trouvés, le testament de Jean de Mantes qui est un document extraordinaire a été publié trois fois, dont deux par Marcel Durliat. Il y a également des découvertes concernant les travaux de Jacques Maurin au cloître. Jacques Dubois ajoute que toutefois ces lectures sont anciennes. Daniel Cazes revient ensuite sur la question du chevet. Il n’est pas convaincu par la démonstration et pense que Marcel Durliat avait raison. Au départ le chevet était plat avec une chapelle principale, Saint-Augustin – ce qui est clair dans le texte – et deux chapelles adjacentes étaient prévues de chaque côté. Le testament n’a pas été exécuté, d’ailleurs cela se voit avec le changement de vocable puisque, côté nord, saint Pierre n’était pas mentionné dans le testament de Jean de Mantes. Daniel Cazes réaffirme donc que deux chapelles adjacentes étaient bien prévues de chaque côté du sanctuaire principal ainsi que Marcel Durliat et Sylvain Stym-Popper l’avaient observé. Jacques Dubois répond que l’étude du bâti montre le contraire, cette hypothèse est impossible. Daniel Cazes renvoie à l’observation des photographies effectuées lors des travaux de Stym-Popper, un changement de parti est visible avec l’amorce d’une autre chapelle après celle de saint Jean. D’ailleurs ce chevet est très particulier et le changement de parti est radical. Le premier parti est caractérisé par un chevet plat avec une particularité intéressante qui n’a pas été évoquée : la présence de piliers de briques octogonaux avec des passages entre les chapelles. Ce premier parti évoque à Daniel Cazes les constructions traditionnelles des Ordres mendiants d’Italie centrale, où se trouvent les plus grands édifices avec ce plan : Santa Croce de Florence, Santa Maria Novella mais aussi San Francesco de Pise… Il ne faut pas oublier que les Augustins arrivent d’Italie, c’est-à-dire que le parti de leur église n’a absolument rien à voir avec ce qui a été un peu avant conçu à Toulouse, aux Cordeliers ou aux Jacobins. Ce qui apparaît donc intéressant aux Augustins, c’est qu’après avoir eu un premier plan, on a décidé de revenir à un système toulousain plus traditionnel de nef unique avec des chapelles latérales entre les contreforts. À ce moment-là, au Sud comme au Nord, la première des chapelles de chaque côté est raccordée en prenant appui sur le premier ouvrage, datable des années 1316-1317. Le changement de parti intervient plus tard, dans les années 1320-1330. Daniel Cazes considère qu’une analyse du bâti différente peut être effectuée, notamment au sujet des éléments visibles rue Antonin-Mercié. Selon lui ils ne peuvent pas indiquer la continuité du glacis, puisqu’aucun décalage entre les deux surfaces murales n’apparaît. Notre confrère revient ensuite sur un autre point abordé, celui de l’absence de chapelle sur le côté de la rue des Arts. Or, la chapelle dite Notre-Dame-de-Pitié, qui n’est autre que la première salle capitulaire, a dès l’origine une chapelle d’axe, comme la salle capitulaire des Jacobins et celle des Cordeliers. La démolition du remplissage du XIXe siècle de l’arc d’entrée de cette chapelle d’axe a révélé des maçonneries en continuité parfaite ; il y avait un enfeu de chaque côté de la chapelle. Jacques Dubois répond que l’étude effectuée avec Bastien Lefevre montre que la chapelle d’axe de la salle capitulaire est postérieure. Le travail d’analyse se poursuit et pourra donner lieu à d’autres communications. Bernard Pousthomis demande si une photogrammétrie ou des relevés ont été réalisés ? Ce travail reste encore à effectuer.
Notre Présidente donne ensuite la parole à Dominique Watin-Grandchamp pour la seconde communication du jour sur « Les dessous » des Vierges noires de la Daurade et de Notre-Dame du Taur :
La nécessité d’effectuer un constat d’état sur deux statues de Vierge à l’Enfant, conservées dans l’église du Taur et dans celle de la Daurade, à Toulouse, a autorisé le déshabillage de ces « objets » historiques protégés. La qualité de la réalisation technique, de ce qui n’est pas vu des foules de fidèles, est médiocre. Les restaurations successives dont elles ont fait l’objet n’ont jamais été de grande qualité. Elles attestent, peut-être, une volonté de transmettre une image en conservant « l’âme » d’un objet chargé d’histoire et de symboles sacrés. Ces statues ne sont livrées aux regards et offertes à la dévotion qu’après avoir été parées de riches atours et de bijoux scintillants qui assurent leur entrée dans le monde du « merveilleux » et de l’émotion.
 .
.


À l’issue, la Présidente remercie notre consœur pour cette présentation fascinante. Quant à savoir si le remploi est à caractère économique ou emblématique, Dominique Watin-Grandchamp confirme qu’il ne peut être qu’économique. Virginie Czerniak revient sur le principe du « sosie » de Notre-Dame de la Daurade, qui a aussi été constaté à Rocamadour où il y avait deux vierges au Moyen Âge. Michelle Fournié précise que toutefois elles n’étaient pas de la même époque et ne se ressemblaient pas totalement, leur taille différant notamment. Elle renvoie aux études de Marlène Albert-Llorca qui a beaucoup travaillé sur les vierges habillées en Espagne. Interrogée par la Présidente au sujet du vestiaire dont s’est chargé Maurice Prin, Dominique Watin-Grandchamp explique que le conservateur a lui-même cousu les robes. Il achetait les tissus à Rome. Il est regrettable que l’on n’ait plus les archives personnelles de Maurice Prin : ses notes auraient été extrêmement précieuses pour la connaissance des objets mobiliers toulousains. Daniel Cazes intervient à propos de la sculpture de Jean-Louis Ajon datée de 1806. Il est intéressant de remarquer la source pour cette réalisation : une tête romaine plutôt du IIIe siècle. Ce type correspond à des séries très à la mode dans les collections romaines des XVIIe et XVIIIe siècles mélangeant authentiques et quantités de copies. En 1830, Bernard Lange, sculpteur-restaurateur à l’École du Louvre et au Musée de Toulouse, faisait des envois de sculptures à Du Mège, parmi lesquelles deux têtes en marbre noir qui ont fasciné. Mérimée s’est notamment inspiré de l’une d’elles pour écrire La Vénus d’Ille. Ajon n’a pas pu connaître ces têtes mais a sans doute vu des modèles de ce type. Il n’avait pas besoin de faire le voyage à Rome pour connaître des portraits de ce genre, précise Louis Peyrusse : il y avait les gravures. Dominique Watin-Grandchamp poursuit sur l’aspect stylistique de la Vierge de la Daurade. Elle a une forme de chignon que l’on retrouve sur les bustes antiques, la référence est évidente. Cependant le chignon a été limé et l’état originel de la création d’Ajon est détérioré. Louis Peyrusse confirme que les visages s’inscrivent bien dans le néo-classicisme. Sans doute lui a-t-il été demandé lors de la commande de faire « ancien ». L’enfant reprend les schémas des portraits d’enfants du XVIIIe siècle de Pajou. Ainsi la réalisation est caractéristique de la période, associant une tête antique et une tête contemporaine d’enfant. Dominique Watin-Grandchamp souligne la complexité de l’interprétation stylistique. En effet, Ferradou et les auteurs qui ont écrit sur la Daurade racontent que : « Ajon ayant connu la sculpture ancienne, il devait respecter la commande des paroissiens en reproduisant aussi fidèlement que possible les traits de la figure vénérée ». De là à parler de la Vierge médiévale qui aurait pu être antique… Louis Peyrusse remarque la différence de qualité entre la Vierge de la Daurade, exécutée par un sculpteur, et la Vierge du Taur, médiocre. Martine Jaoul revient sur les morceaux de bois délabrés de la sculpture originelle du Taur visibles sous la structure restaurée. Comme il s’agit d’une Vierge miraculeuse, les éléments n’ont sans doute pas été détruits car ils faisaient presque partie des reliques et du caractère sacré de la statue. Dominique Watin-Grandchamp ajoute que la grande statuaire peut être retrouvée au pied des façades de bâtiments remaniés, ou enterrée en terres consacrées complète Virginie Czerniak. Cependant, dans ces cas, ce sont des images de la vierge et non des statues miraculeuses rappelle Martine Jaoul. Celle du Taur ne devient miraculeuse que quand elle est appelée Notre-Dame de la Délivrance, quand les protestants passent par la porte Villeneuve pour sortir de Toulouse, indique Dominique Watin-Grandchamp. Michelle Fournié ajoute que celle de la Daurade n’est probablement pas miraculeuse au Moyen Âge mais le devient dans la seconde moitié du XVIe siècle.
Pour compléter, Michelle Fournié prend la parole pour une brève communication intitulée : Vierges sans dessus-dessous.
Concernant les proportions du « pseudo-corps », trapu, de la Vierge du XIXe siècle, Dominique Watin-Grandchamp pense qu’Ajon a en fait reproduit les proportions d’un personnage assis, selon la forme du modèle d’origine. Il n’y avait en effet pas de raison de donner à la Vierge actuelle cette forme magot. D’ailleurs, le sosie est une statue très élancée, filiforme. Michelle Fournié résume ses observations sur la statue ancienne. Elle date vraisemblablement de la fin du XIIIe siècle ou du début du XIVe siècle en se fiant à la datation paléographique du dessin du relevé d’inscription (du bas de la statue) réalisé par le moine du Mas-Grenier. Par conséquent, si cela est bien exact, c’est cette statue qui continuellement, jusqu’à sa destruction en 1799, a été utilisée pour les processions. Michelle Fournié pense ainsi que cette statue, si elle date de la fin du XIIIe siècle ou du début du XIVe siècle, était certes vénérée mais n’est devenue miraculeuse et n’a été « processionnée » qu’à partir de la seconde moitié du XVIe siècle, aucune attestation n’ayant été trouvée auparavant. D’autre part cela correspond à la chronologie générale de ces vierges noires miraculeuses. Dominique Watin-Grandchamp poursuit : si son positionnement dans le chœur indique son importance, le Livre des miracles est tardif (1637) au moment où les Mauristes réorganisent les dévotions et se réapproprient le chœur de la Daurade. Il ne subsiste pas de mention plus ancienne. Michelle Fournié ajoute qu’il existe des mentions antérieures de procession, de 1665 voire peut-être 1655 d’après Étienne Raymond (publication de 1965) mais les cotes d’archives qu’il cite semblent erronées. Michelle Fournié conclut son intervention en rappelant la seule représentation de ce qu’il reste du retable de Nicolas Bachelier à Saint-Étienne. Ce retable se compose de deux étages : en bas la mort de la Vierge et au deuxième niveau une statue qui est aussi une Vierge noire habillée. Elle semble proche de celle de la Daurade. Notre consœur n’a jamais trouvé de mention de Vierge noire à Saint-Étienne. Pourrait-il s’agir de celle de la Daurade ? cela semble peu probable. Laurent Macé souhaite revenir sur le dessin de l’inscription. Des lettres enclavées permettraient de confirmer une datation vers 1280-1290. Patrice Cabau demande : la transcription « Rainaldus » est-elle erronée, faut-il lire « Raymundus » ? La bonne transcription est la première, répond Michelle Fournié. Notre consœur précise que dans le Livre des miracles, il y a trace d’un don dans les années 1620 à Notre-Dame de Bethléem, ce qui atteste de la présence d’une statue sur l’autel dans la crypte. Il y a au moins six à huit statues de la Vierge utilisées à la Daurade dans les différentes confréries.

Séance du 8 novembre 2022
Lire le compte-rendu
Présents : Mme Czerniak, Présidente, M. Cabau, Directeur, Mmes Napoléone, Secrétaire générale, Machabert, Secrétaire-adjointe ; Mmes Fournié, Jaoul, Merlet-Bagnéris, Pradalier-Schlumberger, MM. Cazes, Lassure, Penent, Peyrusse, Surmonne, membres titulaires ; Mmes Ledru, Rolland-Fabre, MM. Dubois, Kérambloch, membres correspondants. Excusés : MM. Guy, Ahlsell de Toulza, Trésorier, Péligry, Bibliothécaire-archiviste ; Mmes Balty, Cazes, Lamazou-Duplan, MM. Balty, Garland, Garrigou Grandchamp, Macé, Scellès, Sournia, Stouffs, Testard, Tollon.
Invité : David Madec, conservateur de la chapelle de la Grave, de la basilique de Saint-Sernin, du castelet de la prison Saint-Michel, du Monument de la Résistance et de la chapelle des Carmélites.
La Présidente ouvre la séance en accueillant l’invité du jour : David Madec.
Elle fait ensuite passer aux membres deux ouvrages pour information : le premier est de nos consœurs Michelle Fournié et Sophie Brouquet (dir.), Reliques, reliquaires et culte des saints dans le sud-ouest de la France, colloque tenu en 2016 et publié récemment aux PUM, faisant suite au colloque tenu à Rocamadour. Le second est de notre confrère Jean-Michel Lassure, Potiers et poteries du groupe de Cox (Haute-Garonne). Brignemont – Cox – Lagranlet – Puysségur, 2022 (2 volumes publiés à compte d’auteur). Enfin, Virginie Czerniak fait don à la bibliothèque du catalogue de l’exposition qui se tient actuellement à Paris au Musée de Cluny : Toulouse 1300-1400. Elle fait remarquer que tous les Toulousains qui ont écrit dans ce catalogue sont membres de notre Société, à l’exception de Charlotte Riou.
Suivant l’ordre du jour, nous procédons à l’élection d’un membre correspondant. Il revient à Michelle Fournié de présenter aux membres le parcours scientifique de M. Damien Carraz, actuellement Professeur d’histoire médiévale à l’Université de Toulouse 2 – Jean Jaurès..
La Présidente précise que le candidat habite Toulouse et qu’il a attendu d’avoir une charge de travail moins importante pour présenter sa candidature à la Société, ce qui laisse présager qu’il assistera de temps en temps à nos séances.
Il est procédé au vote : Damien Carraz est élu membre correspondant de notre Société.
La Présidente donne ensuite la parole à Coralie Machabert pour sa communication sur La restructuration des musées de la ville de Toulouse (1946-1950) :
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, si la ville de Toulouse est réputée pour son « magnifique patrimoine muséographique », la situation de ses institutions est jugée préoccupante. L’état du musée des Augustins, établissement principal, est significatif : délabrement des bâtiments, locaux inadaptés, administration flottante, présentation des collections surannée…
Dictée par une impulsion nationale, la rénovation des musées municipaux s’impose, d’autant que le déplacement des œuvres opéré par mesure de protection dès 1939 a rendu nécessaire un réaménagement des fonds avant toute réouverture des salles au public. Cependant, les ambitions de la Direction des Musées de France à l’égard de la province se heurtent, à Toulouse, aux réticences du milieu artistique. Le projet de restructuration globale, d’envergure, se trouve entravé par de multiples controverses, querelles individuelles et affaires juridiques.
Le « plan de réorganisation des musées de Toulouse », instauré en concertation avec les autorités locales, s’oriente vers une redistribution des fonds afin de définir une identité spécifique à chaque établissement. Leur gestion est aussi reconsidérée, les salles d’exposition modernisées et les modes de présentations adaptés selon les nouvelles méthodes muséographiques. À travers ces changements amorcés après la Libération la nouvelle configuration des musées de Toulouse se dessine.
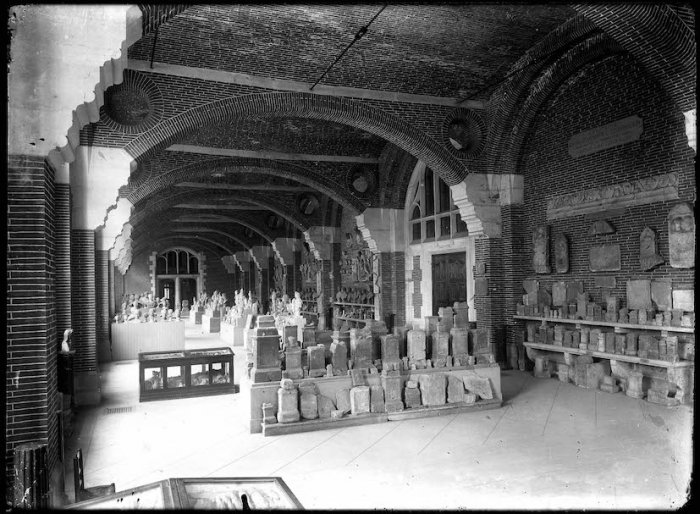
Musée des Augustins, années 1930. © Archives Municipales de Toulouse, 7Fi37.
Virginie Czerniak remercie notre consœur pour cette communication passionnante. Jean Penent déclare avoir connu Robert Mesuret et Paul Mesplé tout en étant dans l’ignorance de l’inimitié qu’ils se portaient, alors qu’ils étaient politiquement du même bord, c’est-à-dire des hommes de « droite classique ». Daniel Cazes dit que, lorsqu’il était arrivé au Musée des Augustins en 1974, Paul Mesplé était parti depuis longtemps. Il a eu quelques contacts avec lui pour des questions précises portant sur des sculptures médiévales, mais il n’a pas eu l’occasion de bien connaître l’homme. En revanche, il a bien connu Robert Mesuret et il pense que dans le portrait qui a été fait de lui dans la communication, il manquait « la flamme » qui l’habitait. C’était en effet un personnage extrêmement enthousiaste et passionné, qui, malgré le parcours semé d’embuches qui a été décrit, a bien tenu la barre. En tant que conservateur de musée, il a bien sûr géré ses collections, mais il s’est fait fort de les connaître de façon détaillée et de maîtriser le contexte culturel. Grand voyageur, il avait fait le tour de l’Europe et en connaissait tous les musées. Avec cette culture, il avait la capacité d’apprécier la valeur relative des collections des musées toulousains. Il faut rappeler qu’il avait été chargé de faire un inventaire général des collections. Daniel Cazes a eu l’occasion de travailler avec ces inventaires et de constater le travail colossal qu’il avait fait. Robert Mesuret avait bien compris ce qu’était l’intention de l’État : calquer les musées de « province » sur la réorganisation des différents départements des Musées nationaux, à commencer par ceux du Louvre. Ainsi, l’idée du Musée des Antiques, appellation aujourd’hui abandonnée, avait été donnée par Robert Mesuret et elle relève de cette politique de l’État des années 1920-1930. S’il a bien tenu la barre, il avait cependant autour de lui un milieu confus, ce qui a été regrettable pour les musées de Toulouse. Daniel Cazes voudrait également faire une petite correction au sujet de deux photographies qui ont été présentées dans l’exposé, concernant l’aménagement muséographique de la sacristie, de la salle capitulaire et de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié du Musée des Augustins. En effet, il ne s’agit pas pour la première de la présentation de Rachou, mais de celle d’Ernest Roschach, qui disposait de très peu de moyens, à la fin du XIXe siècle, d’où les tréteaux et les planches recouvertes de tissus sur lesquelles étaient posées les sculptures. Sur la seconde photographie du même lieu, il s’agit de la présentation de Rachou. Il avait plus de moyens que Roschach puisqu’il avait fait construire des socles de brique et ciment, avec des tablettes de pierre de taille. Cette présentation avait été encensée à l’époque car pour la première fois il était possible de tourner autour des chapiteaux romans, donc d’en voir toutes les faces : c’était un grand pas dans la muséographie. Cette disposition était encore en place lorsque Daniel Cazes était étudiant à Toulouse dans les années 1970 et c’est lui-même qui l’a démontée lors de la grande rénovation du Musée des Augustins, alors qu’il était responsable des collections médiévales sous la direction de Denis Milhau. En effet, les salles étant très humides, les sculptures étaient atteintes par la maladie de la pierre ; c’est entre 1930 et 1970 que la collection a le plus souffert. Louis Peyrusse se souvient que le cloître et la salle capitulaire étaient ouverts sur le carrefour, les collections étaient donc en contact direct avec la pollution de l’air.
Jean Penent rappelle qu’il y eu à la Révolution le Museum central du midi de la République, devenu ensuite « le Musée de Toulouse » installé dans le couvent des Augustins où avaient été stockées les saisies révolutionnaires. À la fin du XIXe siècle, fut créé le Musée Saint-Raymond avec une partie des collections du « musée de Toulouse » et celui-ci devint dès lors le Musée des Augustins. Plus tard, dans les années 50 du siècle suivant, sous l’autorité de la direction des musées de France, la répartition des collections se fit sur des bases scientifiques : le musée des Augustins devint le musée des peintures et des sculptures médiévales et moderne, le musée Saint-Raimond le musée des Antiques, le musée Paul-Dupuy le musée des Arts graphiques et des Arts décoratifs et le musée Georges-Labit le musée des Arts asiatiques et, faute de mieux, des collections égyptiennes. Ainsi, à travers ces « départements », chacun des nouveaux musées possédait une part du musée primitif et pouvait revendiquer la même ancienneté et la même origine. Un « détricotage » de cette organisation fut tenté dans les années 1990 : le musée des Augustins fut baptisé « musée des Beaux-Arts », une dénomination évitée jusque-là, et dès lors revendiqua avec le soutien d’une amnésique direction des musées de France le cabinet des dessins créé par Robert Mesuret et inauguré en 1951 en présence de Jean Vergnet-Ruiz inspecteur général des musées de province. Martine Jaoul fait remarquer que le Musée Paul-Dupuy, désormais appelé « Musée des Arts Précieux » conserve des objets d’Art Populaire qui n’ont rien de « précieux ». Daniel Cazes rappelle que Robert Mesuret s’était battu pour créer à Toulouse un Musée des Arts et Traditions Populaires, indépendamment du Musée Paul-Dupuy. Finalement les collections rassemblées par celui-ci, pour constituer ce Musée, sont restées pendant 40 ans au Crédit Municipal. Il y a eu également des dépôts importants faits par Musée national des Arts et Traditions populaires, reprend Jean Penent. Martine Jaoul les avait répertoriés et elle pense que les archives des Arts et Traditions Populaires (ATP), notamment des échanges de courriers, qui ont normalement dû être transférées à Marseille, peuvent être intéressantes à consulter. Jean Penent confirme qu’une partie des collections est désormais à Marseille.
Louis Peyrusse voudrait revenir sur le fond même. Le concepteur du partage des collections municipales, qui a une sorte d’aura dans le monde des musées, est Georges-Henri Rivière. Le partage qu’il avait effectué est apparemment logique ; il se faisait cependant entre quatre trop petits musées, le Musée des arts asiatiques étant à part. Il a laissé des problèmes réels qui ont amené à des guerres permanentes. En effet, à quelle date doit-on couper la collection archéologique d’Antiquité et du Moyen Âge ? Un Musée des Beaux-Arts a t-il droit à une collection de dessins avec les collections de peintures ? Ce qui est également frappant, ajoute-t-il, c’est le rapt que Robert Mesuret a fait sur des collections extérieures. En effet, que deviendrait le Cabinet des Estampes si on enlevait ce qui provient de la Bibliothèque municipale et le fonds de notre Société qui est déposé au Musée ? En revanche, poursuit Louis Peyrusse, les très bonnes idées n’ont pas été réalisées ; le Musée d’Ethnologie, Arts et Traditions Populaires n’a jamais été créé. Seul le Museum a tiré son épingle du jeu puisque personne n’y a touché, peut-être parce qu’il dépendait du Ministère de l’Éducation Nationale. Il aurait pourtant pu faire l’objet d’une réorganisation puisqu’il intègre les objets de la Préhistoire.
Jérôme Kerambloch fait enfin remarquer que si le Musée d’Ethnologie n’a jamais été réalisé c’est peut-être parce que l’on pensait que celui des Toulousains de Toulouse en faisait office. Il a par ailleurs été surpris de voir ce Musée dans la liste présentée puisqu’il n’y a jamais eu d’échange d’œuvres avec les Augustins. Jean Penent fait remarquer que dans le projet effectué après la guerre, le Musée du Vieux Toulouse était inclus, alors qu’il était privé. Cependant reprend Jérôme Kerambloch, l’installation de ce musée à l’hôtel Dumay en 1948, donc à cette époque, pourrait laisser croire qu’il faisait partie de la restructuration, alors qu’il ne s’agit que d’une coïncidence liée à l’histoire propre des Toulousains de Toulouse.
Virginie Czerniak donne la parole à Patrice Cabau pour une question d’actualité. Celui-ci projette de nouveau l’image du massif occidental de la basilique Saint-Sernin sous les échafaudages, puis une photographie du panneau explicatif situé sur le côté sud. Il s’agit donc de la « restauration des façades et toitures extérieures du massif occidental ». On apprend qu’il y a 4 lots : de la maçonnerie, de la charpente, couverture et menuiserie, la restauration des sculptures est assurée par le Service de restauration des Musées, et enfin un lot vitrail et ferronnerie qui concerne donc la rose. Louis Peyrusse s’était fait écho du projet d’une création de vitrail contemporain annoncé par la sixième adjointe au Maire de Toulouse en charge du Patrimoine. Ce projet est né en 1989, rappelle Daniel Cazes, quand fut montée l’exposition Saint-Sernin, trésors et métamorphoses, et il a été vigoureusement soutenu par l’organiste titulaire qui s’est toujours plaint des condensations de chaleurs, néfastes pour l’orgue, causées par le plexiglass qui garnit aujourd’hui la rose. L’instrument a donc été restauré de nombreuses fois sans que l’on revienne à l’origine du problème.
Notre Présidente propose de solliciter notre invité qui, en tant que conservateur de la basilique, est bien placé pour nous renseigner.
David Madec répond que les travaux évoqués sont menés par la Direction générale de l’Aménagement et la Direction du Patrimoine. Il a été associé à cette direction depuis la fin du mois de juin. Le lot « vitrail » dont il a été question concerne le traitement de l’ensemble des parties ferronnerie et verre du massif occidental, mais il y a également, en effet, un projet de vitrail pour la rose et la petite fenêtre située au-dessus. Un jury est en cours de constitution pour la création des vitraux de ces deux ouvertures ; celui-ci est de type « commande publique », comme l’État peut en former pour les cathédrales. Louis Peyrusse espère que le jury sera à la hauteur de l’intervention. David Madec assure que l’on veille à ce qu’il soit à la hauteur du bâtiment ; on pense également à la durée de vie de l’œuvre en projet. Daniel Cazes rappelle qu’en 1989 on avait débattu autour de ce problème soulevé par l’organiste et le clergé avait été associé aux discussions. Depuis longtemps celui-ci était demandeur d’un vitrail, avec la proposition de consacrer cette œuvre à Saturnin car toutes les sculptures de la façade occidentale racontant l’histoire de ce saint avaient disparu. Il s’appuyait sur l’exemple des vitraux modernes créés dans les années 1950 dans la nef de la cathédrale Saint-Étienne avec pour chacun d’eux l’évocation de personnages en lien avec l’histoire de l’édifice. Voilà donc comment le projet est né, et il était à l’époque totalement consensuel. Louis Peyrusse revient sur la nécessité d’un jury spécialisé de qualité en rappelant comment le comité mis en place par la Mairie pour surveiller les travaux engagés sur l’édifice avait omis de faire appel à des spécialistes de la peinture romane pour la restauration des enduits peints du transept nord. Daniel Cazes déclare que Saint-Sernin mérite une grande œuvre à cet endroit-là et il craint, comme il l’a vécu lors de la restauration de Saint-Pierre-des-Cuisines – où il était également question d’orner les fenêtres de vitraux contemporains –, que la Mairie n’opte pour le projet le moins coûteux. Notre Présidente propose d’attendre que le projet soit arrêté et demande à David Madec si un calendrier a été fixé. Notre invité répond que l’appel à candidature devrait être publié en février ; le reste n’est pas encore arrêté. Il nous assure qu’un gage de sécurité et de qualité est fixé avec la question technique de protection de l’orgue dont il a été question. Autrement dit, toute proposition devra tenir compte des conditions thermiques nécessaires à la conservation de l’instrument. Il faudra donc faire appel à un maître verrier reconnu qui ne travaille pas avec des artistes de moindre renom. Quant à la composition du jury, il y aura des élus, le maire assurera lui-même la présidence et il y aura enfin des personnalités qualifiées dont la liste est encore en discussion, notamment avec la DRAC, il est aussi question d’avoir des représentants d’institutions internationales de façon à avoir un regard d’envergure sur la qualité de ce qui sera proposé.
La dernière question d’actualité proposée par notre Présidente concerne un dessin ancien à la mine de plomb représentant l’intérieur d’une église. Une reproduction de ce dessin a été envoyée par Béatrice de Chancel Bardelot conservateur en chef du Musée national du Moyen Âge, Musée de Cluny, à Paris. Il a été trouvé sur le site Gallica et la légende indique qu’il s’agit d’un édifice toulousain. Celle-ci est cependant erronée puisqu’on ne peut y reconnaître aucune église de la ville. Virginie Czerniak propose d’envoyer le dessin à tous les membres pour solliciter leur connaissance des édifices de la région. Elle demande à Jacques Dubois de donner son avis sur cette représentation. Celui-ci montre la mention « Haute-Garonne » inscrite à la partie supérieure et nous indique que l’on peut également lire « Toulouse » près du bord supérieur gauche et « tombeaux » en partie inférieure. Le sol est en effet constitué de plates-tombes. Jacques Dubois confirme que cet intérieur ne correspond à aucune église toulousaine. Il s’agit d’un édifice à nef unique avec un transept d’une travée par croisillon, qui montre des caractéristiques architecturales que l’on pourrait dater de la fin du XIIe ou du XIIIe siècle. Quitterie Cazes suggérait d’y voir un édifice cistercien de la région. Louis Peyrusse demande s’il ne pourrait s’agir d’une scène d’exposition dans le style néo-médiéval de Charles-Caïus Renoux (qui n’a produit que des inventions d’architectures de fantaisie). Il pensait à la copie par les frères Virebent du jubé d’Albi réalisé en terre cuite qui est disposé dans le chœur de la cathédrale de Condom ; le fait qu’il y ait un tombeau un peu inattendu au premier plan peut donner l’impression qu’il s’agit d’une exposition disposée à l’intérieur d’une nef désaffectée. Daniel Cazes pense également que les deux fenêtres en façade peuvent évoquer un édifice cistercien. La clôture placée de manière illogique, selon Louis Peyrusse, évoque une exposition. Michelle Fournié demande si ce dessin ne pourrait pas être entièrement imaginé. Jacques Dubois avoue y avoir pensé car, de façon surprenante, le jubé montre des éléments que l’on trouve en terre d’Empire, comme ce type de remplage avec des éléments segmentés. La Présidente remercie l’assemblée pour toutes ces suggestions.

Séance du 18 octobre 2022
Lire le compte-rendu
Présents : M. Cabau, Directeur, M. Péligry, Bibliothécaire-archiviste, Mmes Napoléone, Secrétaire générale, Machabert, Secrétaire-adjointe ; Mme Jaoul, MM. Garrigou Grandchamp, Macé, Penent, Scellès, Sournia, membres titulaires ; Mmes Dumoulin, Rolland Fabre, M. Kérambloch, membres correspondants.
Excusés : Mme Czerniak, Présidente, M. Ahlsell de Toulza, Trésorier ; Mmes Bessis, Fournié ; MM. Cazes, Garland, Peyrusse.
Le Directeur ouvre la séance en l’absence de notre Présidente qui se trouve actuellement à Paris, au Musée de Cluny, pour l’inauguration de l’exposition Toulouse 1300-1400. L’éclat d’un gothique méridional.
Au titre des questions diverses, notre confrère Laurent Macé demande au Bureau de nommer – dans les convocations envoyées pour les séances–, le candidat qu’il soumet à l’élection des membres, de façon à ce que ceux-ci puissent soutenir (ou pas) cette élection, et que soit ainsi assurée une plus grande transparence de l’information. Il ajoute que cela se fait dans d’autres sociétés savantes, certaines envoyant même le curriculum vitae du candidat aux membres. Maurice Scellès rappelle que les candidatures sont habituellement annoncées en séance, raison pour laquelle l’information n’est pas reprise dans la convocation. En relisant le procès-verbal de la séance précédente, cette annonce peut être retrouvée. Il rappelle également que la candidature doit d’abord être examinée en bureau, puis être proposée à la Société et enfin être soumise à l’élection. Cependant, il est effectivement possible de faire un rappel dans la convocation.
Patrice Cabau donne ensuite la parole à notre Secrétaire-adjointe pour présenter la candidature de M. Jules Masson-Mourey comme membre correspondant de notre Société.
Pierre Garrigou Granchamp remarque que si l’intérêt de la candidature est manifeste sur le plan de la recherche, on ne peut être assuré d’une présence régulière à nos séances. Coralie Machabert précise que M. Masson-Mourey propose déjà des communications en lien avec le travail de thèse que la Société a primé, mais qu’il est actuellement dans l’incertitude du lieu où ses futurs travaux de recherches le mèneront.
La candidature de Jules Masson-Mourey est soumise au vote : M. Jules Masson-Mourey est élu membre correspondant de notre Société.
Notre Directeur signale à l’assemblée un don de Jean Penent à la bibliothèque de la Société, celui d’un ouvrage qu’il a récemment publié, Les peintures du Languedoc au XVIIe siècle (éd. Collegi d’Occitania 2022). Il remercie notre confrère au nom de tous les membres. Jean Penent déclare que, pour réaliser ce travail, il a reçu l’aide du Musée des Augustins et de tous les musées de la région sous forme de photographies gratuites et exemptes de droits. Certains tableaux, sortis de l’oubli et récemment restaurés, n’ont pas encore été présentés au public. L’ouvrage a également bénéficié pour son illustration de l’aide efficace de l’Inventaire de la région Occitanie, au-delà même de son champ d’action.
Pierre Garrigou Grandchamp signale aussi la parution prochaine d’un ouvrage de Quitterie Cazes et Chantal Fraysse, Le cloître et le portail de Moissac, en souscription jusqu’au 18 novembre 2022 au prix de 31,50 euros (éd. Sud-Ouest, 2022).
Maurice Scellès propose de faire l’annonce de ces deux ouvrages sur le site de notre Société et invite les membres à lui transmettre les références de leurs publications – où de celles qui leur ont paru importantes – pour les signaler de la même façon. Il faut alors fournir un texte de présentation et une ou deux planches pour l’illustrer.
Patrice Cabau donne enfin la parole à Bernard Sournia pour des Observations sur le chantier de la nef du cardinal Godin à l’église du couvent des Jacobins de Toulouse :
 On se propose de revenir sur le chantier des Jacobins et sur le moment où s’effectue la suture entre le chœur neuf et la nef du cardinal Godin vers 1324. Par une série de croquis en perspective axonométrique, l’on essaiera d’expliquer le principe des cloisons ayant permis la continuation de la fonction liturgique pendant la durée du chantier. On observera en particulier une importante déliaison dans les maçonneries au contact des deux étapes d’ouvrage, vestige lié au système de cloison utilisé au cours de cette phase cruciale de l’édification de l’église.
On se propose de revenir sur le chantier des Jacobins et sur le moment où s’effectue la suture entre le chœur neuf et la nef du cardinal Godin vers 1324. Par une série de croquis en perspective axonométrique, l’on essaiera d’expliquer le principe des cloisons ayant permis la continuation de la fonction liturgique pendant la durée du chantier. On observera en particulier une importante déliaison dans les maçonneries au contact des deux étapes d’ouvrage, vestige lié au système de cloison utilisé au cours de cette phase cruciale de l’édification de l’église.
Le Directeur remercie notre confrère pour cette « relecture » du monument. Il lui demande si le niveau de la naissance de l’arc dont il a été question est bien très au-dessus du sommet des retours que l’on avait conservés de l’ancienne nef. En effet, répond Bernard Sournia, les retours étaient à 13 m, qui est la hauteur des murs gouttereaux du vaisseau de 1230, et la naissance de l’arc s’élève à environ 20 m : les deux retours du vieux vaisseau ont donc bien été augmentés en hauteur comme le suggèrent les pointillés sur le croquis projeté, mais il est vrai qu’aucune vérification archéologique n’est possible sous les enduits. Maurice Scellès note que le ressaut n’est pas lié à la maçonnerie « A », à l’endroit où on peut voir une fissure, et demande si ce ressaut est ancré dans le contrefort, au moins ici ou là, en refouillant la maçonnerie. Bernard Sournia suppose qu’il doit en effet exister quelques éléments de liaison, sur la face latérale du contrefort, mais seule une investigation très rapprochée permettrait de les reconnaître. Il ajoute que l’interprétation du ressaut comme lié à la présence d’une cloison de chantier n’est qu’une tentative, purement hypothétique, d’expliquer une anomalie constructive : l’on adoptera toute autre explication s’il s’en trouve de plus satisfaisante. Cependant, reprend Maurice Scellès, pendant les 28 années qui séparent les deux chantiers, l’ancienne nef est-elle restée debout ? Les comptes signalent-ils sa démolition ? Dans ce cas le problème de l’espace serait sans doute différent, sans que cela invalide l’hypothèse proposée. Bernard Sournia pense que dès que la communauté s’installe dans le chœur, la vieille nef devient inutile et il est probable que l’on commence à la démolir. Patrice Cabau rappelle que l’église des Jacobins sert aussi d’église paroissiale. Bernard Sournia montre les traces de deux piédroits de la porte, dans le mur du chœur, qui permettait l’accès des laïques, ce qui montre que le seul accès extérieur vers cet espace se trouvait là et ce qui atteste bien que le nouveau chœur avait pris le relai de l’ancienne église pour assumer la fonction liturgique.
Donc la moitié méridionale du chœur aurait été affectée aux offices paroissiaux demande Patrice Cabau ? C’est l’évidence même, pense Bernard Sournia. Il ajoute que le couvent des Jacobins assumait aussi une fonction universitaire : le vieux vaisseau, pendant les vingt-huit années qui précèdent l’édification de la nef, n’aurait-il pas été affecté à cette fonction ? On sait, note Valérie Dumoulin, que des cours avaient lieu dans la salle capitulaire au XIVe siècle. Était-elle déjà bâtie dans l’intervalle de la construction du chœur et de la nef demande Bernard Sournia ? Si ce n’est pas le cas, il devait nécessairement y avoir une salle du chapitre fait remarquer Patrice Cabau. Dès 1229 en effet, reprend Valérie Dumoulin, des cours se tiennent dans le couvent, mais on ne sait pas si l’ancienne église était utilisée pour cette fonction. Ce qui est surprenant, poursuit notre consœur, c’est qu’une nef plus étroite que celle de la première église ait été projetée dès le début. Bernard Sournia a la conviction que le projet d’ensemble de l’église, chœur et nef, est homogène avec une largeur dans œuvre sensiblement moindre que celle du vieux vaisseau de 1230.
Hortense Rolland Fabre voudrait revenir sur la cloison que l’on suppose placée derrière la troisième colonne du chœur, avant que l’on construise la nef ; celle-ci était-elle bien adossée à la colonne ? Oui répond Bernard Sournia, elle était accolée à la colonne, sur les deux ressauts dont il a été question et sans doute fixée à ceux-ci par des tenons métalliques. Il renvoie au croquis qu’il avait présenté lors de sa précédente intervention sur le sujet. Hortense Rolland Fabre pense que la présence de cette cloison pourrait expliquer une anomalie : sur les colonnes, une frise a été peinte sous les chapiteaux et sur la troisième colonne, cette frise n’est peinte que du côté est. Bernard Sournia est enchanté de cette forte observation qui va dans le sens de son hypothèse. Cela induit que le chapiteau est pris dans l’épaisseur de la cloison, reprend Maurice Scellès. Pierre Garrigou Grandchamp demande si d’autres exemples de cloisons de chantier sont connus et développés par des publications. Bernard Sournia cite les cloisons des cathédrales de Cologne, de Narbonne et de Beauvais ; des parallèles peuvent également être établis avec la cathédrale de Bourges. On sait qu’il a existé aussi une cloison à la cathédrale de Toulouse devant la nef « raymondine » pendant que l’on construisait le chevet de Bertrand de L’Isle Jourdain. Cependant, aucun texte, aucun auteur n’a décrit le processus. Hortense Rolland Fabre revient encore sur la cloison des Jacobins car sa datation bouleverse celle des peintures ; quand peut-on situer sa mise en place ? Au moment de la consécration, en 1292, la nécessité de fermer cette partie de l’édifice s’impose, répond Bernard Sournia.
Martine Jaoul voudrait revenir sur le ressaut et sur l’arc brisé situé au-dessus. S’il repose derrière le contrefort, il n’aura pas la même largeur que s’il repose sur le ressaut, et cela crée donc forcément une dissymétrie et une rupture dans la régularité des arcs. En effet, répond Bernard Sournia, l’arc est plus étroit que les autres d’environ 45 cm, mais cela reste imperceptible. En construisant les deux cintres, on a dû tenir compte de cette différence d’épaisseur. Il y a également un changement de rythme des arcs dans le chevet. Il faudrait cependant pouvoir réfléchir à ce problème sur un relevé précis ; celui-ci est en cours d’élaboration par l’architecte chargé des restaurations. Il faudra donc le consulter.
Patrice Cabau propose de terminer avec quelques images complétant l’exposé qu’il avait fait sur l’aqueduc de Guilheméry lors de la séance du 24 mai dernier. Des éléments nouveaux ont pu être recueillis grâce aux travaux entrepris et avancés dans la région du « Monument aux Morts » (qui doit être déplacé de quelques mètres vers le Grand Rond en juillet prochain) pour la construction de la troisième ligne de métro. Reprenant le tracé de l’aqueduc, il nous montre des vestiges de la galerie en partie effondrée située dans la hauteur de Guilheméry, datée de 1546. Elle fut démolie dans les années 1970 avec la construction d’un égout. Il montre également une photographie qu’il avait pu prendre dans les caves de l’hôtel néoclassique qui s’élève au n° 26 des allées François-Verdier. Les travaux récemment entrepris aux abords, dans l’actuelle rue Sainte-Anne, ont fait apparaître une galerie qui a cessé d’être en fonction à partir des années 1820 puisque l’eau provenait dès lors du nouveau « Château d’eau ». Cette galerie présente les mêmes caractères constructifs que celle repérée sous la rue de l’Aqueduc et sous la place Saint-Étienne. Ces vestiges permettent par ailleurs de préciser le tracé de la conduite, qui restait un peu incertain dans cette zone.
Notre Directeur tient à remercier Laure Krispin, présente lors de la communication, qui lui a signalé les travaux nécessitant la surveillance du Service archéologique de Toulouse-Métropole et qui l’a mis en contact avec l’archéologue en charge de cette mission, Christophe Clamès. Celui-ci lui a communiqué des photographies et l’a informé du suivi du chantier. On s’en était inquiété lors de la communication mais notre confrère a pu constater que le suivi a été fait dans les règles.
Patrice Cabau nous montre enfin un cliché du massif occidental de Saint-Sernin, emballé dans un voile, au-dessus des échafaudages qui l’enveloppent. Il ne connaît pas le projet des travaux qui se préparent ; il avait été question à une époque de réaliser une « création contemporaine » dans la rose. Le Directeur espère que les travaux seront faits avec sens et que les maçonneries resteront « lisibles » après cette intervention. Bernard Sournia demande si la rose est actuellement visible de l’intérieur. Elle reste en effet visible, répond Patrice Cabau, même si les grandes orgues l’occultent un peu. Sera-t-elle garnie de réseaux, demande Maurice Scellès ? On espère bien que non ! Le Directeur rappelle que la porte occidentale était appelée la porte de l’« O » à cause de cette rose vide (munie cependant d’une grille et de verre blanc).
Jean Penent voudrait rappeler que deux peintres importants, Jacques Boulbène et Nicolas Tournier, avaient leur sépulture aux Jacobins, dans la chapelle Saint-Luc, saint patron des peintres. Les sols de l’église ayant été refaits que sont devenues ces tombes ? La légende dit que Maurice Prin avait recueilli pieusement les ossements. Valérie Dumoulin rappelle que tous les os qui ont été récupérés se trouvent actuellement sous la chapelle Saint-Antonin, dans l’ossuaire de la crypte. Ces os sont malheureusement en vrac ; on ne peut donc les attribuer à tel ou tel défunt. C’est Maurice Prin qui les a rassemblés à cet endroit. On a trouvé récemment de petits os sous l’autel majeur, sous la châsse de saint Thomas d’Aquin. Il y a donc encore des interventions à l’intérieur de l’église s’inquiète Patrice Cabau ? Oui, répond Valérie Dumoulin ; on prépare en ce moment l’inhumation de Maurice Prin. S’agit-il de la dernière chapelle du chœur, au Nord, là où se font des fouilles actuellement, demande Bernard Sournia ? En effet, répond Valérie Dumoulin, le dallage a été découpé avec une scieuse et une archéologue va intervenir ensuite ; ce sont la directrice et le directeur-adjoint de l’ensemble conventuel des Jacobins qui suivent cette opération.
